T. LOBSANG RAMPA
TROIS VIES
Titre Original : Three Lives
(Édition : 22/04/2020)
Trois Vies — (Initialement publié en 1977) Moly, le balayeur, travaille dans un jardin public de Toronto quand soudain une enfant tombe dans le bassin. Homme sans Dieu mais cœur fraternel, Moly se précipite, la sauve... Moly mourra d'une pneumonie, seul, misérable.
MacOgwascher est le P.D.G. de la prospère Glittering Gizmos. Israélite, il s'est converti au catholicisme par ‘politique’. Une angine de poitrine le foudroie.
Étonnant frère Arnold, moine aux travaux exemplaires mais dont l'esprit parfois se rebelle contre la Règle. Un reporter qu'il voulait écarter le blesse à mort.
Trois êtres que tout semblait séparer... Lobsang Rampa a suivi leur vol vers l'inconnu, les a retrouvés dans l'astral et nous donne ici l'opportunité de l'accompagner. Que leur arrive-t-il alors ?
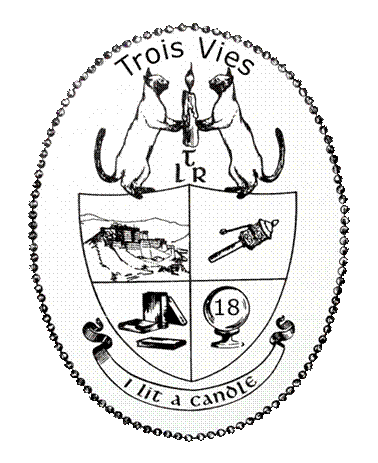
Mieux vaut allumer une chandelle
que maudire l'obscurité.
Le blason est ceint d'un chapelet tibétain composé de cent huit grains symbolisant les cent huit livres des Écritures Tibétaines. En blason personnel, on voit deux chats Siamois rampants (i.e. debout sur leurs pattes de derrière, le terme ‘rampant’ étant ici un adjectif propre à l'héraldique, c'est-à-dire, aux blasons — NdT : Note de la Traductrice) tenant une chandelle allumée. Dans la partie supérieure de l'écu, à gauche, on voit le Potala ; à droite, un moulin à prières en train de tourner, comme en témoigne le petit poids qui se trouve au-dessus de l'objet. Dans la partie inférieure de l'écu, à gauche, des livres symbolisent les talents d'écrivain et de conteur de l'auteur, tandis qu'à droite, dans la même partie, une boule de cristal symbolise les sciences ésotériques. Sous l'écu, on peut lire la devise de T. Lobsang Rampa : ‘I lit a candle’ (c'est-à-dire : ‘J'ai allumé une chandelle’).
À mes amis
Eric Tetley et Tetley Tea Bags Cat
Tables des matières
Avant-propos
Ce livre ne vous est PAS présenté comme une fiction pour une raison très spéciale : il ne s'agit PAS d'une fiction !
Bien sûr, nous pouvons facilement convenir que certains mots de cet ouvrage en ce qui concerne la vie en ce monde sont des ‘licences littéraires’, mais vous devez me croire quand j'affirme que TOUT ce qui concerne la vie de ‘l'autre côté’ est absolument vrai.
Certains d'entre nous sont nés avec un grand don musical ; d'autres sont particulièrement doués pour la peinture ; avec facilité ils charment et enchantent le monde. D'autres sont hautement doués grâce à leur propre travail acharné et à un dévouement assidu à l'étude.
Du point de vue matériel, je n'ai pas grand-chose — je n'ai ni voiture, ni télévision, ni ceci et ni cela — et ne pouvant me servir de mes jambes vu que je suis paraplégique, je suis confiné au lit vingt-heures par jour. Cela m'a donné une grande opportunité d'accroître les talents ou les aptitudes qui me furent attribués à ma naissance.
Je peux faire tout ce dont je parle dans n'importe lequel de mes livres — sauf marcher ! J'ai la faculté de faire le voyage astral et, grâce à mes études et, je suppose, à cause d'une bizarrerie particulière de ma nature, je suis capable de voyager astralement sur d'autres plans d'existence.
Les personnages de ce livre sont des gens qui ont vécu et sont morts en ce monde, et grâce à des dispositions spéciales il m'a été possible de suivre leurs ‘Vols dans l'Inconnu’.
Tout ce qui, dans ce livre, concerne la Vie après la Mort est strictement vrai, d'où la raison pour laquelle je ne le qualifierai pas de fiction.
Lobsang Rampa
Chapitre Un
— Qui est ce bonhomme ?
Se relevant lentement, Leonides Manuel Molygruber regarda l'homme qui venait de poser cette question.
— Eh bien ? Je vous ai demandé qui est ce vieux bonhomme ? répéta l'homme.
Molygruber regarda vers le bas de la route et vit un fauteuil roulant électrique qui pénétrait dans un immeuble.
— Oh ! lui ! dit Molygruber tout en envoyant au sol un crachat qui s'en alla atterrir sur le soulier d'un passant, c'est un gars qui vit par ici. Il écrit des livres ou quelque chose comme ça, il s'occupe de fantômes et autres balivernes du même genre et des histoires de gens qui sont vivants quand ils sont morts.
Il renifla d'un air supérieur et reprit :
— Tout ça, c'est des bêtises, vous savez, pas le moindre bon sens dans ces âneries. Quand on est mort, on est bien mort, comme je dis toujours. Il y a des prêtres qui vous disent qu'il faut faire une ou deux prières et qu'ensuite, peut-être, si vous dites les mots justes, vous serez sauvé et vous irez au Paradis, sinon ce sera l'Enfer. Puis c'est l'Armée du salut qui s'amène en faisant un boucan infernal, le vendredi soir, et quand ils sont partis, les gars comme moi n'ont plus qu'à venir avec leur petite brouette et balayer. Ils sont là à hurler et à taper sur leurs tambourins — ou je ne sais quoi — qu'ils fourrent sous le nez des passants, en leur criant qu'ils ont besoin d'argent pour les œuvres de Dieu.
Il regarda autour de lui et se moucha sur le trottoir. Puis se tournant vers l'homme qui l'interrogeait :
— Dieu ? Il n'a jamais rien fait pour moi — jamais. J'ai mon propre trottoir ici que je suis chargé de tenir propre ; je balaie et balaie et rebalaie, puis je prends mes deux cartons pour ramasser ce que j'ai ramené et je le mets dans ma brouette, et de temps à autre la voiture passe — nous les appelons voitures, mais ce sont des camions à dire vrai ; alors, ils prennent ma brouette et versent son contenu sur les ordures qui sont déjà dans le camion ; puis ils s'en vont et je n'ai plus qu'à recommencer. C'est un job qui n'est jamais fini, jour après jour, sans arrêt. Vous ignorez toujours si quelque conseiller municipal ne va pas passer dans sa grosse Cadillac éblouissante, et alors si vous n'êtes pas penché sur vos balais à ce moment-là, je suppose qu'il va se plaindre à quelqu'un du Conseil, et ce quelqu'un va faire du tapage auprès de mon Patron qui, à son tour, vient me sermonner : "Peu importe, qu'il me dit alors, si vous ne faites rien ; le contribuable ne le saura jamais ; mais faites un peu de mise en scène, ayez l'air de travailler."
Molygruber, ayant regardé à nouveau autour de lui, fit le geste de pousser son balai puis, s'étant mouché avec un bruit horrible sur sa manche droite, il dit :
— Vous vous demandez, monsieur, ce que pense ce balayeur que voilà ; eh bien, ce que je dis, moi, est ceci : aucun Dieu n'est jamais descendu jusqu'ici et n'a jamais fait le balayage pour moi, moi avec mon dos brisé à force d'être courbé tout le jour à pousser toute la saleté que les gens laissent tomber ! Vous ne croiriez jamais ce que je trouve dans mon secteur, des culottes et d'autres choses qui vont dedans — tout — vous ne croiriez jamais ce que je trouve aux coins des rues. Mais, comme je vous le disais, aucun Dieu n'est jamais descendu pour pousser mes balais pour moi, n'a jamais ramassé les ordures à ma place. C'est mon pauvre moi d'honnête homme qui doit le faire, vu qu'il peut pas trouver un meilleur boulot.
L'homme qui le questionnait regarda de côté Molygruber en disant :
— Un rien pessimiste, hein ? Je parie que vous êtes un athée !
— Athée ? répéta Molygruber. Non, j'suis pas athée ; ma mère était Espagnole, mon père était Russe et j'suis né à Toronto. J'sais pas ce que ça donne pour ce qui est de moi ; mais j'suis quand même pas athée ; sais pas où se trouve cet endroit, de toute façon.
L'interlocuteur éclata de rire :
— Un athée est un homme qui ne croit pas à la religion, un homme qui ne croit qu'au présent. Il est ici, et l'instant d'après il meurt, et il est parti — mais où ? Nul ne le sait ; mais l'athée croit que, dès qu'il meurt, son corps n'est rien d'autre que les détritus que vous ramassez là. C'est ce qu'on appelle un athée !
Ricanant, Molygruber répliqua :
— C'est moi ! V'là maintenant que j'suis quelque chose de nouveau ; j'suis un athée, et quand les gars qui travaillent avec moi m'demanderont ce que j'suis, j'pourrai toujours leur dire : non, j'suis pas un Russe, pas un Espagnol — j'suis un Athée. Y s'en iront en ricanant, y penseront que l'vieux Molygruber il a encore un brin de cervelle, après tout.
L'interlocuteur reprit sa marche. À quoi bon perdre son temps à parler avec un vieux minable de cette espèce, pensa-t-il. C'est curieux à quel point tous ces éboueurs — c'est le nom qu'ils se donnent maintenant — peuvent être ignorants ; et cependant, c'est fou ce qu'ils savent sur les gens qui vivent là.
Il s'arrêta soudain, se frappant le front de sa main ouverte.
— Fou que je suis ! se dit-il, j'essayais de savoir quelque chose sur ce type.
Faisant demi-tour, il partit retrouver le vieux Molygruber resté debout devant la statue de Vénus, cherchant visiblement à l'imiter — bien que sa silhouette, son sexe et ses instruments ne fussent pas ceux qui convenaient. Un balai, après tout, n'était pas exactement l'accessoire avec lequel poser. L'homme avança vers le balayeur en disant :
— Dites donc, vous travaillez par ici, vous connaissez les gens qui vivent dans le secteur. Que dites-vous de ceci ? (Il lui montra un billet de cinq dollars.) Je veux des informations sur le type qui est dans le fauteuil roulant, ajouta-t-il.
La main de Molygruber s'avança, arrachant le billet avant que l'homme ait eu le temps de le voir disparaître.
— Si j'sais quelque chose sur ce vieux type ? demanda Molygruber. Sûr que j'peux vous parler de lui. Y vit quelque part, là, en bas ; y suit cette allée et y tourne à droite ; c'est là où y vit, y a vécu depuis deux ans maintenant. On le voit pas beaucoup. Il a une maladie qui a rapport avec ses extrémités, mais paraît, à ce qu'ils disent, qu'il en a pas pour longtemps à vivre. Il écrit des livres, s'appelle Rampa, et les choses sur lesquelles il écrit, elles sont simplement ridicules — la vie après la mort. C'est pas un athée. Mais ils disent qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ses sornettes ; vous pouvez voir tout un étalage de ses livres dans la boutique, là, en bas ; ils en vendent beaucoup. Drôle comme y a des gens qui font de l'argent facilement, en écrivant quelques mots comme ça, alors que je dois m'échiner avec mon balai. Pas vrai ?
L'homme demanda :
— Pouvez-vous trouver exactement où il vit ? Vous dites qu'il habite dans cet immeuble, mais — renseignez-vous — OÙ, EXACTEMENT ? Vous me direz le numéro de l'appartement. Je reviendrai demain et si vous avez ce numéro, si vous m'indiquez vers quelle heure il sort, vous aurez dix dollars.
Molygruber rumina pendant un moment, enleva son chapeau pour se gratter la tête, puis se tira le lobe de l'oreille. Ses amis auraient dit qu'ils ne l'avaient encore jamais vu faire ce geste et, comme ceux-ci lui disaient, il ne pensait jamais beaucoup. Mais il pouvait se fatiguer à le faire quand il s'agissait de gagner dix dollars pour si peu de travail. Il cracha et dit :
— Monsieur, affaire conclue. Topez là ! Vous venez ici demain à la même heure ; je vous dirai le numéro et à quelle heure il sort — s'il n'est pas déjà sorti. Mais j'ai un ami qui connaît le concierge de l'immeuble, là-bas ; ils s'occupent des ordures ensemble. Les ordures sortent dans ces grosses choses bleues, vous voyez ce que je veux dire. Bref, mon ami trouvera pour moi ; et s'il vous plaisait de lâcher un petit supplément, je pourrais peut-être trouver un peu plus de renseignements pour vous.
L'homme leva les sourcils, avança un peu en traînant les pieds, puis finit par demander :
— Est-ce qu'il ne jette pas de déchets, des lettres, des choses comme ça ?
— Oh non, oh non ! répondit Molygruber. Je peux vous dire qu'il est le seul dans cette rue à avoir une machine à découper tous ses papiers. C'est un truc qu'il a appris en Irlande. Quelques-uns de ces gens de la presse avaient mis la main sur certains de ses papiers et c'est un type qui, à ce qu'on dit, se laisse jamais prendre deux fois. Il a un appareil qui découpe tous les papiers en petites lanières. C'est comme des rubans. Je l'ai vu moi-même dans les sacs à ordures. J'peux rien trouver pour vous d'intéressant parce qu'ils sont très prudents là-bas, ne laissent rien au hasard et ne jettent jamais rien qui pourrait être retracé.
— C'est bon, dit l'homme. Je serai là demain vers cette heure-ci et, comme promis, je vous donnerai dix dollars si vous avez le numéro de l'appartement et l'heure vers laquelle on risque de le rencontrer. À demain !
L'homme fit un vague geste de la main pour prendre congé et reprit sa route. Molygruber demeura figé sur place, si immobile qu'on aurait pu le prendre pour une statue, retournant dans sa tête ce qui venait de lui arriver, tout en essayant d'évaluer le nombre de pintes qu'on pouvait s'offrir avec dix dollars. Puis, en traînant les pieds, il poussa sa vieille brouette, faisant semblant de nettoyer la route.
C'est alors qu'un homme en vêtements ecclésiastiques déboucha du coin de la rue et faillit s'étaler sur la brouette.
— Hé là ! hé là ! s'exclama Molygruber d'un ton maussade. Allez pas bousculer mes ordures, j'ai passé la matinée à les charger dans ma brouette.
L'ecclésiastique chassa quelques petites poussières tombées sur sa soutane, puis baissa les yeux pour regarder le vieux Molygruber.
— Ah, mon brave homme, dit-il, vous êtes justement la personne qui peut m'aider. Je suis nouveau dans le district et je désire aller en visitation — enfin, rendre visite aux gens nouvellement arrivés dans le secteur. En connaissez-vous ?
Le vieux Molygruber serra ses narines entre le pouce et l'index et souffla avec un bruit terrible pour dégager son nez, manquant de justesse le pied de l'ecclésiastique, parfaitement choqué et dégoûté.
— Visitations, vous avez dit ? enchaîna le vieux balayeur. J'avais toujours cru que c'était le diable qui s'en chargeait. Il nous fait des visitations, puis on en sort couvert de boutons et de pustules ; ou alors, quand on a juste déboursé son dernier centime pour une pinte, quelqu'un vous la fait tomber des mains. Je croyais que c'était ça les visitations.
L'ecclésiastique le considéra des pieds à la tête avec un air de profond mépris.
— Mon ami, dit-il, je soupçonne que vous n'avez pas mis les pieds dans une église depuis fort longtemps, car vous n'avez pas un grand respect pour le Clergé.
Le vieux Molygruber le regarda droit dans les yeux en lui disant :
— Non, monsieur, j'suis pas un enfant de Dieu. Je viens juste d'apprendre ce que j'suis ; j'suis un athée. V'là ce que j'suis.
Et il minauda de façon inquiétante. L'ecclésiastique se dandina d'un pied sur l'autre, regarda autour de lui, puis dit alors :
— Mais, mon brave homme, vous devez avoir une religion. Il vous faut croire en Dieu. Venez à l'église dimanche et je ferai un sermon spécialement pour vous — un de mes frères infortunés contraint de ramasser les ordures pour gagner sa vie.
D'un air content de soi, Molygruber s'appuya sur l'extrémité de son balai en disant :
— Ah, révérend, vous ne me ferez jamais croire qu'il y a un Dieu. Prenez votre cas ; vous avez un beau paquet d'argent, à ce que je sais, et pour faire quoi ? Pour dire quelques paroles sur une chose qui n'existe pas. Prouvez-moi, Monsieur le Révérend, qu'il y a un Dieu ; amenez-le ici et laissez-moi lui serrer la main. Aucun Dieu n'a jamais rien fait pour moi.
Il s'arrêta, fouilla longuement dans ses poches jusqu'au moment où il en ramena une cigarette à moitié fumée ; puis, ayant trouvé une allumette, il l'enflamma d'une pichenette contre son ongle, et reprit :
— Ma mère, c'était une de ces dames qui font ça — vous voyez ce que je veux dire — pour de l'argent. Jamais su qui était mon père ; probablement tout un gang de gars responsables. Mais j'ai dû me battre depuis que j'étais un gosse haut comme trois pommes, et personne, jamais, a fait quoi que ce soit pour moi ; alors ne venez pas, vous, avec votre maison confortable, votre travail grassement payé, et votre grosse voiture, me faire un sermon. Venez d'abord faire mon travail, là, dans la rue, et alors vous verrez ce que votre Dieu fait pour vous.
Écumant de rage, le vieux Molygruber se jeta dans l'action avec une énergie inhabituelle. Il secoua son balai sur le haut de sa brouette, attrapa les poignées et se lança sur la route en trottinant. L'ecclésiastique le regarda disparaître avec un air de complète surprise ; secouant la tête, il avança en grommelant :
— Mon Dieu, quel homme impie ! Où le monde est-il donc arrivé ?
Un peu plus tard dans la journée, Molygruber tenait conciliabule avec les portiers et concierges de quelques-uns des appartements d'alentour. Ils avaient l'habitude de ces petites rencontres au cours desquelles ils échangeaient de savoureuses informations. Molygruber était, à sa manière, l'un des hommes les mieux documentés du secteur ; il était au courant des mouvements de chacun des locataires ; il savait qui entrait et qui sortait.
— Qui est donc ce vieux type dans le fauteuil roulant ? demanda-t-il à l'un des hommes. C'est bien un écrivain ?
Les concierges se retournèrent pour le regarder et l'un d'eux éclata de rire en s'exclamant :
— Me dites pas, vieux, que VOUS vous mettez à vous intéresser aux livres. Je pensais que vous étiez au-dessus de ces choses. De toute façon, ce gars-là écrit sur quelque chose qu'ils appellent ‘thanatologie’. Je sais pas très bien ce que c'est moi-même, mais j'ai entendu dire que ce qu'il écrit concerne la façon dont vous vivez après la mort. Me paraît, à moi, complètement ridicule. Oui, il habite ici, chez nous.
Molygruber fit tourner sa cigarette dans la bouche, regarda son nez en louchant puis demanda :
— Un bel appartement qu'il a, j'suppose ? Équipé de tout ce qu'il y a de plus moderne ? J'aimerais bien voir moi-même l'intérieur d'un de ces apparts.
Le concierge sourit tout en répondant :
— Vous vous trompez. Ils vivent très modestement. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qu'il écrit, mais je vous dis, moi, que sa vie est conforme à ce qu'il prêche. Il me semble, vu l'état dans lequel il est, qu'il ne tardera pas à vérifier l'exactitude de ce thanato... quelque chose, sur lequel il écrit.
— Où habite-t-il ? Je veux dire... quel appartement ? dit Molygruber.
Le concierge jeta un regard autour de lui.
— C'est très, très secret, dit-il. Les gens ne sont pas censés connaître ce numéro ; mais je le connais, moi. Que dites-vous de cela, eh ?
Molygruber garda le silence, et la conversation, pour un temps, reprit à bâtons rompus ; puis il revint à la charge.
— Vous avez bien dit que son appartement était le neuf-neuf quelque chose ? Le concierge éclata de rire.
— Je sais, dit-il, que vous essayez de m'avoir, vous, fin renard ; mais parce que c'est vous, je vais vous dire son numéro. C'est—
À ce moment précis, un des camions d'ordures apparut dans le chemin, le chargeur entra en action et le bruit de la benne couvrit la voix du concierge. Mais Molygruber, très avisé dès qu'il s'agissait d'argent, ramassa un paquet de cigarettes vide, dénicha un crayon dans ses poches et dit au concierge :
— Vous écrivez le numéro ici. J'dirai pas qui me l'a donné.
Avec obligeance, mais tout en se demandant quelle idée le vieux balayeur pouvait bien avoir derrière la tête, le concierge s'exécuta et tendit l'adresse à Molygruber qui y jeta un coup d'œil, puis glissa le paquet dans sa poche après un petit geste de remerciement.
— Il faut que je m'en aille, maintenant, dit le concierge, faut que je sorte quelques-unes de ces poubelles ; c'est notre tour maintenant. À bientôt.
Sur ces mots, il se dirigea vers le vide-ordures de l'immeuble, et le vieux Molygruber s'en alla.
Le camion des ordures arriva ; deux hommes en sortirent et, se saisissant de la brouette de Molygruber, ils la soulevèrent à l'arrière du camion.
— Monte, vieux, dit l'un d'eux, on t'emmènera jusqu'au dépôt.
Molygruber grimpa en hâte dans le camion, sans se soucier du fait que sa journée de travail n'était pas tout à fait finie, et le conducteur se dirigea vers le centre de regroupement des ordures.
— Dites donc, les gars, vous connaissez cet écrivain Rampa qu'est dans mon secteur ? demanda Molygruber.
— Oui, dit l'un d'eux. Et même qu'on ramasse un sacré paquet avec lui. Il doit dépenser pas mal d'argent avec les médicaments. C'est fou ce qu'il peut jeter comme cartons vides, bouteilles, et autres, et je vois qu'à présent on lui fait des piqûres car il jette des ampoules marquées ‘Tuberculine’. C'est ce qu'il y a d'écrit dessus. J'ai dû empêcher un concierge — un remplaçant — de prévenir la police, car il trouvait louche qu'un gars se serve de pareilles choses. Il se demandait si le vieux type ne se droguait pas.
Le ramasseur d'ordures s'arrêta pour rouler une cigarette, puis l'ayant allumée, il reprit :
— J'ai jamais été partisan de mêler la police à des affaires un peu bizarres. Je me rappelle — c'était l'année dernière — il y a eu tout un tas d'histoires au sujet d'une vieille bouteille d'oxygène qu'une nouvelle concierge avait trouvée dans les ordures et, bien que la bouteille était absolument vide, et même sans sa valve, cette concierge a contacté tous les hôpitaux avant qu'on découvre, après une véritable enquête, que tout était parfaitement légal. Après tout, si les gens étaient en bonne santé, ils n'auraient pas de bouteilles d'oxygène. C'est pas votre avis, les gars ?
Les hommes levèrent les yeux. L'heure était passée d'une minute — ils n'étaient pas payés pour faire des heures supplémentaires. S'extirpant à toute vitesse de leur salopette et enfilant leur veste de tous les jours, ils se précipitèrent à leur voiture pour aller flâner dans les rues.
Le lendemain matin, Molygruber arriva un peu en retard à son travail. Comme il entrait au dépôt pour prendre sa brouette, un homme l'appela cordialement de la cabine d'un camion :
— Hé, Moly, voilà quelque chose pour vous. Vous avez posé tellement de questions sur le gars, que je vous ai apporté quelque chose de ce qu'il écrit. Jetez-y un coup d'œil.
Ce disant, il tendit à Molygruber un livre de poche. Le titre en était ‘Je Crois’.
— Je Crois, marmonna Molygruber. Me parlez pas de ces niaiseries. Quand on est mort, on est mort. Personne va jamais venir me dire : "Hé là ! Molygruber vous avez été très bien dans la vie, aussi, mon vieux, voilà pour vous un trône spécial fait de vieilles boîtes à ordures !"
Mais il regarda le livre, le retourna, le feuilleta un peu, puis le glissa dans la poche intérieure de sa veste.
— Qu'est-ce que vous faites là, Molygruber ? Qu'êtes-vous en train de voler, maintenant ? demanda une voix rude, tandis que, d'un petit bureau, émergeait un homme trapu et solidement bâti. Donnez !
En silence, Molygruber déboutonna le haut de sa veste et en extirpa le livre qu'il tendit à l'homme.
— Hum ! dit le contremaître. Vous donnez dans ce genre de choses, maintenant ? Je pensais que vous ne croyiez à rien, sauf à vos pintes et à la paie !
Molygruber sourit à l'homme trapu qui, bien que petit, était malgré tout plus grand que lui, et répondit :
— Oui, oui, Patron, vous me dites, vous, s'il y a une vie après celle-ci. Si je vois sur mon chemin une tête de poisson dans le coin d'une ruelle et que je la ramasse, personne va jamais me dire que le poisson va vivre à nouveau.
Ayant tourné et retourné le livre, le contremaître dit lentement :
— Vous savez, Molygruber, il y a des tas de choses sur la vie et la mort, et on ne comprend pas tout. Ma femme, elle, est complètement folle de ce type-là : elle achète tous ses livres et elle jure que tout ce qu'il dit est la vérité. Vous savez, ma femme, elle est un peu une voyante ; elle a eu quelques expériences et, quand elle en parle, elle me donne une de ces frousses. En fait, il y a seulement quelques jours, elle m'a tellement fait peur au sujet des fantômes qu'elle prétendait avoir rencontrés, que je suis sorti pour prendre un verre ou deux, et puis un ou deux de trop, et en rentrant, cette nuit-là, j'avais peur de mon ombre. Mais assez parlé, mon garçon. Prenez votre travail, il est tard. C'est de ma faute ; mais ne perdez pas de temps maintenant. Mettez un pied devant l'autre un peu plus vite que d'habitude. Allez, oust !
Molygruber saisit sa brouette, s'assura qu'elle était vide, que le balai était bien le sien, et, de son allure tranquille, attaqua une nouvelle journée de balayeur.
C'était un travail parfaitement ennuyeux. Une bande de jeunes écoliers étaient passés, laissant une montagne de saletés dans le caniveau. Le vieux Molygruber marmonna un flot d'imprécations tout en se baissant pour ramasser les papiers de chocolats, caramels et autres sucreries. Sa brouette ne tarda pas à être pleine. Il s'arrêta un moment, s'appuya sur son balai et considéra un immeuble en construction. Son intérêt bien vite tombé, il s'intéressa à autre chose. Une voiture accidentée était remorquée et enlevée. Soudain, une horloge sonna ; Molygruber se redressa, joua avec sa cigarette et gagna l'abri situé dans le petit parc — l'heure du déjeuner. Il aimait se rendre dans cet abri et prendre son petit repas loin des gens qui s'asseyaient sur l'herbe, la jonchant de détritus.
Il descendit la route en poussant sa brouette ; arrivé devant le petit abri, il sortit une clef de sa poche, ouvrit la porte et entra. Avec un soupir de soulagement, il s'assit sur un tas de caisses qui avaient contenu des fleurs pour le jardin. Il était occupé à fourrager à la recherche de ses sandwichs quand une ombre apparut sur le seuil de la porte. Levant les yeux, il vit l'homme qu'il espérait voir. La pensée de l'argent le séduisit.
L'homme entra et s'assit.
— Eh bien ! dit-il, je suis venu au sujet de l'information que vous deviez m'obtenir.
Tout en parlant, il sortit son portefeuille et joua avec les billets. Le vieux Molygruber le regarda d'un air froid, en disant :
— Bon, mais qui êtes-vous, monsieur ? Nous, éboueurs, donnons pas d'informations à la première personne qui vient à passer ; nous avons besoin de savoir à qui nous avons affaire.
Cela dit, il mordit à pleines dents dans un de ses sandwichs, faisant gicler une tomate écrasée, pépins et tout. L'homme assis sur les boîtes juste en face de Molygruber se jeta de côté.
Que pouvait bien lui dire l'homme, à son sujet ? Pouvait-il dire qu'il était Anglais et un produit du Eton College (l'un des établissements scolaires les plus réputés au Royaume-Uni et dans le monde — NdT) — même s'il y avait passé à peine une semaine, et cela à cause d'une malheureuse erreur, ayant à la faveur de l'obscurité confondu la femme d'un des maîtres du collège avec une servante de l'établissement. Erreur qui avait eu les conséquences désastreuses que l'on imagine. Expulsé presque avant d'être entré, il avait par là établi une manière de record. Mais il adorait proclamer qu'il était passé par Eton ; ce qui était parfaitement exact !
— Qui je suis ? dit l'homme. J'aurais pensé que le monde entier le savait. Je suis le représentant d'une très prestigieuse publication Anglaise et je désire l'histoire complète de la vie de cet auteur. Je m'appelle Jarvie Bumblecross.
Le vieux Molygruber continua à mâchonner son sandwich qui débordait de tous côtés. Tout en grommelant, il avala une bouchée, puis tira une bouffée de la cigarette qu'il tenait de l'autre main. S'interrompant, il dit alors :
— Jarvie, hein ? C'est un nom que j'ai jamais entendu. Comment ça se fait ?
L'homme réfléchit un instant, puis décida qu'après tout il n'y avait pas d'inconvénient à dire la vérité à ce type qu'il ne reverrait probablement jamais.
— Eh bien ! dit-il, j'appartiens à une très vieille famille Anglaise. Mon arrière-grand-mère maternelle s'est enfuie avec un cocher de Londres. À cette époque, les cochers étaient appelés ‘jarvies’, et pour commémorer ce qui fut une affaire plutôt malheureuse, tous les membres mâles de la famille ont reçu, depuis, le nom de Jarvie.
Le vieux Molygruber ayant paru réfléchir à ce qu'il venait d'entendre, dit alors :
— Ainsi vous voulez écrire sur la vie de ce gars ? D'après ce que j'ai entendu, on a beaucoup trop écrit sur sa vie, Semble, d'après moi et d'après les autres, que vous — les journalistes — vous rendez la vie infernale à ce pauvre bonhomme et à ses semblables. Il m'a jamais fait aucun mal, à moi, et regardez ça maintenant !
Il montra un de ses sandwichs :
— Regardez, du sale papier journal sur le pain. Et j'suis censé manger une chose pareille ! À quoi bon acheter ces journaux si vous vous servez pas d'une encre qui tient dessus ? J'ai jamais aimé le goût du papier journal.
L'homme, de plus en plus agacé, dit à son interlocuteur :
— Vous voulez entraver le travail des médias ? Ne savez-vous pas que c'est le droit le plus absolu des journalistes que d'aller où bon leur plaît, d'entrer partout et de questionner n'importe qui ? J'étais très généreux en vous offrant de l'argent pour une information. C'est votre devoir que de la donner gratuitement à la presse.
Le vieux Molygruber eut une soudaine poussée de rage. Ne pouvant supporter cet Anglais au parler doucereux qui se croyait au-dessus de Dieu lui-même, il se leva en disant :
— Allez-vous-en, monsieur, décampez, fichez-moi le camp ! Allez, grouillez-vous si vous voulez pas que je vous charge dans ma brouette jusqu'au dépôt pour donner un petit travail supplémentaire aux gars des ordures.
Un râteau à la main, il avança sur l'homme qui se leva et recula en basculant sur les cartons et les caisses, mais qui ne fut pas long à se relever. Un simple coup d'œil au visage de Molygruber et il était sur ses pieds, franchissait la porte, et se sauvait en courant.
Le vieux Molygruber, d'un geste lent, ramassa caisses et morceaux de bois en maugréant :
— Jarvie — cocher — quel que soit le genre d'histoire à laquelle il s'attend que je croie — et s'il avait une arrière-grand-mère mariée à un cocher de fiacre, alors comment ce gars peut-il être aussi stupide ! Ah, je sais, continua-t-il le visage de plus en plus furieux, c'est sans doute parce qu'il est Anglais qu'il a ces façons d'être.
S'asseyant à nouveau, il essaya de reprendre un sandwich, mais non, le cœur n'y était pas. Trop fâché pour manger, il emballa le reste de son casse-croûte et partit boire au robinet, dans le parc.
Il s'attarda à regarder les gens. Après tout, c'était l'heure de sa pause. Au coin d'un sentier où ils étaient cachés par un arbre, deux ecclésiastiques approchaient.
— Ah, mon brave homme, dit l'un d'eux, pouvez-vous m'indiquer où sont les... heu, heu, cabinets publics pour hommes ?
— Non, répondit Molygruber toujours d'assez méchante humeur, y a pas ce genre de choses ici ; vous faut aller dans un de ces hôtels-là et dire que vous êtes pressé. Vous venez d'Angleterre où ils en ont dans les rues. Ici, y en a pas. Vous faut aller dans une station-service ou dans un hôtel.
— Extraordinaire vraiment, dit l'un des deux ecclésiastiques, certains de ces Canadiens ont vraiment l'air mal disposés à notre endroit, nous, gens d'Angleterre.
Ils se hâtèrent vers l'hôtel le plus proche.
Juste à cet instant on entendit des cris venant du petit lac situé au centre du jardin. Molygruber fit demi-tour pour aller voir la cause de ce tapage. Il descendit vers l'étang et vit un enfant d'environ trois ans au beau milieu de l'eau et dont la tête apparaissait, puis disparaissait. Aucun des passants rassemblés au bord de l'étang ne faisait le moindre geste pour essayer de sortir l'enfant de l'eau.
Le vieux Molygruber pouvait être rapide parfois. Il le fut en cet instant. Se précipitant vers l'étang en bousculant deux vieilles femmes dont l'une tomba sur le dos tandis que l'autre partait de côté en chancelant, il sauta par-dessus le petit mur de pierre et se retrouva dans l'étang où l'eau était peu profonde. Mais son pied glissa sur le sol visqueux et il s'étala la tête la première en se faisant quelques sérieuses contusions ; mais il se releva et repêcha l'enfant qu'il tint la tête en bas comme pour lui faire recracher l'eau. Cela fait, et marchant avec précaution sur le fond glissant, il escalada le petit mur et retrouva la terre ferme. Une femme se précipita vers lui en criant :
— Où est son chapeau ? Où est son chapeau ? Il était tout neuf, je venais juste de l'acheter aux Galeries de la Baie. Vous feriez bien de le trouver.
Furieux, Molygruber jeta dans les bras de la mère l'enfant tout ruisselant. La femme recula, craignant pour sa robe. Le vieux Molygruber regagna son petit abri. Il resta là pendant un moment, maussade, avec l'eau qui dégouttait de ses habits, débordait de ses chaussures en faisant une mare sur le sol. Mais pensant qu'il n'avait pas de quoi se changer, il se dit que ses vêtements sécheraient rapidement sur lui. D'un air las, il attrapa les poignées de sa brouette, sortit et referma la porte derrière lui.
Un vent froid venant du nord s'était levé. Molygruber frissonna. Chacun sait que le vent du nord est glacial. Tremblant, Molygruber reprit son travail avec plus d'ardeur, dans l'espoir de se réchauffer, ce qui sécherait ses vêtements.
Bien vite il fut en sueur, mais ses vêtements restaient mouillés. Il s'agitait, l'eau giclait de ses chaussures et il tremblait. Il lui semblait que l'heure de rentrer au dépôt n'arriverait jamais.
Elle vint enfin. Ses camarades étaient plutôt étonnés par son silence.
— Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec le vieux Moly ? demanda l'un d'eux. On dirait qu'il a perdu un dollar et trouvé un cent. Ça lui ressemble pas d'être si tranquille, pas vrai ? J'me demande ce qui est arrivé ?
Sa vieille voiture refusait de démarrer et, juste comme elle venait de hoqueter et qu'il s'apprêtait à partir, il s'aperçut qu'il avait un pneu à plat. Pestant et blasphémant, il arrêta le moteur, sortit et entreprit de changer la roue. Y étant parvenu, il remonta dans la voiture qui fit les mêmes difficultés pour démarrer. Quand, enfin, il regagna sa pauvre chambre solitaire, il en avait assez de tout, assez de sauver les gens, assez du travail, de la solitude et de tout. Il se déshabilla rapidement, se sécha avec une vieille serviette de toilette et se mit au lit sans se donner la peine de manger quoi que ce soit.
Pendant la nuit il transpira abondamment. Il lui semblait que le jour ne viendrait jamais. Il respirait avec peine et son corps était en feu. Il resta étendu dans l'obscurité, se demandant ce qui n'allait pas, mais se disant qu'à la première heure il irait à la pharmacie pour demander des comprimés contre la toux, ou quelque chose pour soulager cette gêne dans la poitrine.
Le matin fut long à venir ; puis les premiers rayons du soleil brillèrent enfin à travers la petite fenêtre pour trouver Molygruber toujours éveillé, avec un visage enfiévré et une température très élevée. Essayant de se lever, il vacilla et tomba de tout son long sur le sol. Combien de temps y resta-t-il ? Il n'aurait pu le dire, mais il fut éveillé par une agitation autour de lui. Il ouvrit les yeux et vit deux infirmiers qui le soulevaient et s'apprêtaient à le mettre sur une civière.
— Double pneumonie, mon vieux, voilà ce que vous avez, dit l'un des ambulanciers. On vous emmène au General Hospital. Vous y serez bien. Aucun parent ? Qui voulez-vous qu'on prévienne ?
Le vieux Molygruber, qui était très las, ferma les yeux et sombra dans un sommeil agité. Il n'eut pas conscience du moment où on l'installa dans l'ambulance, et pas davantage conscience du moment où celle-ci prit l'entrée des urgences, et où, plus tard, on le mit au lit.
Chapitre Deux
— Allons, voyons, donnez votre bras, et pas d'histoire ! Allons, allons !
La voix était autoritaire, aiguë et insistante. Leonides Manuel Molygruber remua légèrement, puis la conscience lui revint vaguement quand quelqu'un lui prit le bras en le tirant de dessous le drap.
— Je ne sais pas pourquoi vous résistez de cette façon, dit la voix sur un ton irrité. Il faut que je vous fasse une prise de sang. Allez, donnez votre bras.
Ouvrant les yeux, le vieux Molygruber regarda autour de lui. Au-dessus de lui, sur sa gauche, se tenait une femme avec un air menaçant. Son regard rencontra une sorte de panier métallique posé sur la table de chevet. Le panier ressemblait, pensa-t-il, à ces choses dans lesquelles les laitiers placent les bouteilles de lait ; ce panier contenait de nombreux tubes fermés par du coton à leur extrémité.
— Alors, vous êtes revenu parmi nous, hein ? C'est bien, mais vous me faites perdre mon temps.
Sur ces mots, la femme releva avec brusquerie la manche de pyjama de Molygruber, lui entoura le bras de quelque chose qui ressemblait à une bande de caoutchouc. Puis ouvrant un petit paquet, elle en sortit quelque chose dont elle lui frotta vigoureusement la peau. Il éprouva une douleur aiguë et sursauta.
— Oh ! quel diable d'homme ! Pourquoi ne pouvez-vous pas avoir des veines un peu plus saillantes ?
Elle retira l'aiguille, serra un peu plus la bande de caoutchouc et piqua une autre fois.
Molygruber regarda, un peu étourdi, et vit un grand tube de verre attaché à une aiguille plongée dans son bras. Le tube s'emplit et la femme, avec l'habileté que donne une longue pratique, enleva le tube qu'elle remplaça par un autre. Satisfaite alors de sa tâche, elle retira l'aiguille, plaça un petit pansement et partit avec le sang recueilli. En grommelant, elle écrivit le nom de Molygruber sur les tubes qu'elle déposa dans le panier.
Elle gagna un autre lit, et sa voix grinçante retentit dans les oreilles d'un autre patient. Regardant autour de lui, Molygruber eut le temps de voir que cinq autres malades étaient dans la chambre. Puis sa vision se brouilla, sa respiration devint difficile et, pour un temps, il n'eut plus conscience de rien.
Il fut réveillé par un bruit d'objets entrechoqués. Il lui sembla qu'on roulait un trolley chargé de vaisselle et de plats métalliques. Lentement, et avec difficulté, il ouvrit les yeux et vit juste à l'extérieur de la porte un énorme chariot en métal-chromé. Tandis qu'il regardait l'objet en question, une infirmière surgit et commença à tendre à chaque patient son petit plateau de nourriture. Le nom de chacun était marqué.
Un infirmier vint vers lui et le regarda en disant :
— Alors comment vous sentez-vous maintenant ?
Le vieux Molygruber lui adressa un grognement pour toute réponse, trop fatigué qu'il était pour parler ; et de plus, il se dit en lui-même que n'importe quel idiot serait capable de voir qu'il n'était pas bien brillant. L'infirmier dégrafa quelque chose à l'arrière du lit et dit :
— Tenez seulement votre bras bien droit, je vais prendre votre tension artérielle.
Il sentit qu'on lui serrait le bras et vit l'infirmier avec son stéthoscope aux oreilles. Dans sa main droite, il tenait une poire en caoutchouc et la pressait. Molygruber ferma les yeux pendant quelques instants et s'éveilla à nouveau quand l'infirmier lui desserra le bras.
— O.K., dit-il, le Dr Phlébotum va passer vous voir. Je crois qu'il vient juste de commencer sa ronde. Au revoir !
L'infirmier s'éloigna et fit le tour des patients.
— Alors qu'est-ce qui ne va pas, vieux, avec le petit déjeuner, ce matin ? demanda-t-il à un malade.
Molygruber vit que ce dernier avait auprès de lui une longue tige à laquelle une bouteille était suspendue avec des tubes qui en sortaient. D'une voix faible il demanda :
— Ce type, qu'est-ce qu'on lui fait ?
— Oh, c'est un goutte-à-goutte intraveineux, répondit l'infirmier. On lui donne une solution saline pour lui remettre les idées d'aplomb.
La vision de Molygruber se troubla à nouveau et sa respiration rauque lui semblait comme l'écho d'un bruit très lointain. À nouveau quelqu'un le dérangea. Une main se promenait sur son cou, cherchant à déboutonner son pyjama.
— Qu'est-ce qu'il a ? demanda une voix mâle.
Molygruber ouvrit les yeux et vit un homme en blouse blanche ; sur son côté gauche étaient finement brodées les lettres de son nom : Dr Phlébotum.
— Cet homme a été amené ici, et les paramédicaux disent qu'il a une double pneumonie. Nous attendions que vous l'examiniez, docteur.
Le docteur fronça les sourcils en disant :
— Alors, les paramédicaux jouent aux cliniciens, maintenant ? Je vais m'occuper de cela !
Se baissant, il appliqua son stéthoscope contre la poitrine de Molygruber, puis la tapota en même temps qu'il écoutait le son.
— Je pense qu'il faut qu'il aille à la radio ; il semble avoir beaucoup de liquide dans les poumons. Occupez-vous de cela, garde, voulez-vous ?
Le docteur se pencha sur la fiche de Molygruber, y nota quelque chose, puis se dirigea vers le malade suivant. Molygruber somnola.
Des bruits de voix le réveillèrent. Il ouvrit les yeux. Un infirmier et une garde-malade amenaient un brancard à roulettes près de son lit. Sans ménagements particuliers, on le poussa sur le côté du lit, et de là sur le brancard avec un coup sec et rapide, "comme quelqu'un qui sort un gros poisson de l'eau", pensa Molygruber ; puis l'infirmier le couvrit d'un drap et ils s'en allèrent au long d'un corridor.
— Qu'est-ce qui se passe pour vous, mon bonhomme ? demanda l'infirmier.
— Oh ! sais pas, répondit Molygruber. Suis allé dans l'eau froide, hier, sans pouvoir me changer après ; alors j'ai eu très chaud, puis très froid, et j'ai dû tomber par terre ou avoir un malaise, toujours est-il que je me suis retrouvé ici, dans cette salle. Sûr que j'ai diablement mal dans ma poitrine, est-ce qu'on va pas faire quelque chose pour moi ?
En sifflant entre ses dents, l'infirmier répondit :
— Mais bien sûr qu'on va s'occuper de vous, vous voyez bien qu'on vous emmène à la radio. Pourquoi croyez-vous qu'on le ferait si ce n'était pour vous aider ? Vous ne croyez pas ?
Le brancard eut une secousse et vint s'arrêter contre le mur.
— Nous y voilà, dit l'infirmier. Ils viendront vous chercher quand ils en auront terminé avec le patient qui est à l'intérieur. C'est un jour très chargé. Je vois pas pourquoi que je resterais dans cette bousculade.
Sur ces mots, l'infirmier s'éloigna au long du corridor aux parois de verre. Le vieux Molygruber resta là pendant très longtemps à attendre qu'on vienne le chercher. Il avait de plus en plus de peine à respirer. Une porte s'ouvrit enfin, violemment, et une garde-malade sortit en poussant un autre brancard.
— Vous retournez dans la salle, dit-elle à la femme qui était étendue ; je vous laisse là, et dès qu'ils en auront le temps ils viendront vous chercher.
Ce fut au tour du vieux Molygruber. Elle se tourna vers lui :
— Je suppose que vous êtes le suivant. Qu'y a-t-il qui ne va pas ?
— Peux pas respirer, répondit-il.
Elle saisit le brancard, le fit pivoter avec une brutalité excessive et le poussa dans une pièce obscure. La lumière y était si faible qu'on avait peine à distinguer sa propre main en la portant à son visage ; mais Molygruber parvint à voir d'étranges tubes de métal, des fils partant dans toutes les directions, et, à l'une des extrémités de cette pièce, il crut distinguer quelque chose qui ressemblait aux caisses placées à l'entrée des cinémas. La femme le poussa contre une table de forme un peu incurvée.
— Quel est le problème pour celui-ci ? demanda une voix, tandis qu'une jeune fille sortait de derrière le cabinet de verre.
— J'ai sa feuille ici. On craint une double pneumonie. Faites les radios de la poitrine, devant et dos.
La fille et l'infirmière poussèrent le brancard contre la table et, d'un petit mouvement brusque, firent glisser Molygruber sur le chrome de la table.
— Jamais eu de radio ? demanda la jeune fille.
— Non, jamais, je sais rien de ces choses, répondit Molygruber.
— O.K., dit la fille. Restez bien sur le dos ; faites juste ce qu'on vous dit de faire.
Elle fit quelques manœuvres et régla la hauteur d'une grande boîte suspendue par des tubes en chrome. Elle pressa des boutons, déclencha une petite lumière et projeta sur sa poitrine ce qui semblait être un rayon X. Satisfaite de la disposition de ses appareils, elle dit alors à Molygruber :
— Maintenant ne bougez pas, et quand je dis ‘respirez’, vous prenez une grande respiration et vous la retenez. Compris ?
— Oui, vous me dites quand la retenir, répondit Molygruber.
La jeune fille disparut derrière ce qui ressemblait à une caisse de cinéma, et cria après quelques instants.
— Très bien, respirez... ne respirez plus. (On entendit comme une sorte de sifflement.) Bon, respirez, dit-elle.
Puis elle vint près de la table et il eut l'impression qu'elle ouvrait des tiroirs, ou quelque chose du même genre. Molygruber vit qu'elle en retirait comme une boîte métallique, puis en glissait une autre. Ces boîtes étaient plus larges que sa poitrine.
— Maintenant, dit-elle, il faut qu'on vous tourne sur la poitrine.
Ce qu'elle fit. L'ayant installé dans la bonne position, elle actionna à nouveau ses différents appareils et recommença ses opérations. Elles durèrent si longtemps que Molygruber en perdait la notion du nombre d'images prises de ses poumons, quand enfin, on vint vers lui pour lui dire que c'était terminé.
— C'est fini. Je vais vous pousser à l'extérieur et vous attendrez là pendant qu'on développe les films pour voir s'ils sont bons. Si oui, on vous ramènera dans votre lit, sinon je serai obligée d'en prendre d'autres.
Cela dit, elle ouvrit la porte et poussa le brancard à l'extérieur. Ce traitement rappela à Molygruber une manœuvre de trains poussés sur une voie de garage, et il se dit que le procédé ne témoignait ni de remords ni d'une grande compassion pour les patients.
Après un temps qui lui parut interminable, une petite jeune fille — à laquelle on n'aurait donné guère plus de quatorze ans — arriva en traînant les pieds et en éternuant abondamment, comme si elle avait un terrible rhume. Sans dire un mot au vieux Molygruber, elle attrapa le brancard, le poussa, et, au rythme des éternuements de la fille, ils traversèrent le corridor et retrouvèrent la chambre.
— Et voilà ! dit-elle en disparaissant.
Le brancard roula un peu sur sa vitesse acquise et alla buter contre le mur. Personne n'y fit attention ; un infirmier arriva finalement, reprit le brancard, l'amena contre le lit de Molygruber en lui disant :
— O.K., c'est terminé. Le docteur repassera dans une heure. J'espère que vous durerez jusque-là.
Une fois Molygruber dans son lit, l'infirmier lui remonta les draps jusqu'au menton et, d'une allure nonchalante, sortit le brancard de la chambre.
Un autre infirmier arriva en courant et s'arrêta en dérapant devant le lit de Molygruber.
— C'est vous qui avez sorti l'enfant de l'eau, hier ? demanda-t-il d'un ton qui se voulait être un murmure, mais qui résonna dans toute la chambre.
— Oui, j'suppose que c'est moi.
— Alors la mère est ici. Elle a demandé à vous voir, mais nous avons dit que ce n'était pas possible, que vous étiez trop malade. C'est une bonne femme qui fait des histoires.
À ce moment précis, on entendit des pas dans le corridor, et une femme entra accompagnée d'un agent de police.
— Vous — lui, là-bas, dit la femme d'un air furieux, il a volé le chapeau de ma petite fille hier.
L'agent s'avança et dit à Molygruber tout en le regardant sévèrement :
— Cette dame prétend que vous avez attrapé le chapeau de sa petite fille et l'avez jeté dans l'eau.
— Quel mensonge ! répliqua le vieil homme. J'ai tiré l'enfant de l'eau alors que tout le monde autour la regardait se noyer. La mère, elle non plus, ne faisait rien pour l'aider. J'ai pas vu de chapeau ; qu'est-ce que vous pensez que j'en ai fait ? Que je l'ai mangé ?
L'agent jeta un coup d'œil autour de lui, puis se tourna vers le vieil homme.
— Vous avez sauvé l'enfant ? Alors vous êtes le gars dont j'ai entendu parler ?
— J'suppose, répliqua Molygruber.
L'agent se tourna vers la femme.
— Mais vous ne m'avez pas dit qu'il avait sorti votre enfant de l'eau. Quel genre de mère êtes-vous donc pour venir ainsi accuser un homme qui a sauvé votre enfant ? Drôle de façon d'exprimer votre reconnaissance.
Rouge de fureur, la femme finit par dire :
— Alors, quelqu'un a dû prendre le chapeau car l'enfant ne l'avait plus, et comme je ne l'ai pas trouvé, il doit l'avoir.
L'agent sembla réfléchir un instant.
— Je vais téléphoner au chef.
Prenant l'ascenseur, il gagna le central téléphonique des infirmières. Bien vite parvinrent des "Oui, sir, et non sir, et O.K., je vais faire cela, sir".
Revenant dans la chambre, il s'adressa à la femme.
— Je viens de recevoir des ordres. Si vous continuez ces niaiseries, je vais vous inculper pour torts et dommages à l'ordre public ; aussi vous feriez bien de retirer votre plainte si vous ne tenez pas à me suivre ; le chef n'est pas dans de bonnes dispositions à votre égard, je vous préviens.
Sans mot dire, la femme disparut de la chambre, suivie de l'agent de police.
La scène n'avait fait aucun bien à Molygruber. Sa respiration était plus difficile encore, et l'infirmier venu le voir appuya immédiatement sur le bouton d'urgence placé à la tête du lit. L'infirmière-chef entra et, après l'avoir regardé, sortit en hâte, et on l'entendit qui téléphonait au médecin de service.
Le vieux Molygruber tomba dans la somnolence et dans des rêves tout pleins d'images colorées, auxquels il fut arraché par le geste de quelqu'un qui déboutonnait son pyjama.
— Tirez les rideaux, garde. Je vais examiner sa poitrine, dit une voix mâle.
Le vieil homme leva les yeux et vit un autre docteur qui lui dit, voyant qu'il était éveillé :
— Vous avez du liquide dans la plèvre. Nous allons essayer de l'éliminer.
Un autre docteur entra — c'était une femme cette fois — et une infirmière amena près du lit un plateau monté sur roues.
— Vous allez vous asseoir, maintenant, dit le docteur, car il faut qu'on puisse atteindre vos côtes.
Le vieil homme essaya, mais il était trop faible. On dut le soulever à l'aide d'une couverture, puis on le fixa avec un drap roulé, glissé sous lui et attaché à la tête du lit. Il était ainsi en position assise et ne risquait pas de glisser.
La doctoresse lui injecta un produit dans le côté gauche. Elle attendit un moment, puis le piqua avec une aiguille.
— Il ne sent rien, dit-elle. L'insensibilisation est totale et on peut commencer.
Une infirmière s'affairait, tenant un grand bocal de verre muni d'un tuyau. Elle assujettit soigneusement le système, et Molygruber eut le temps de voir que le bocal était rempli d'eau. Elle le suspendit sur le côté du lit, juste en dessous du matelas. Puis elle tint une des extrémités du tube ; l'autre débouchait dans un baquet.
Le docteur, le dos tourné, préparait quelque chose et, satisfait du résultat, il se retourna. Le vieil homme faillit s'évanouir d'effroi en voyant l'énorme aiguille que le docteur tenait en main.
— Je vais vous mettre ce trocart entre les côtes et retirer ainsi le liquide qui est dans votre plèvre. Cela fait, nous vous ferons un pneumothorax artificiel, ce qui asséchera votre poumon gauche. Mais tout d'abord il faut retirer le liquide. Vous n'aurez pas mal — enfin pas trop, dit-il tout en approchant lentement le tube d'acier et en le poussant entre les côtes de Molygruber.
Une sensation affreuse. Le pauvre homme avait l'impression que ses côtes s'enfonçaient à chaque poussée et que son cœur allait lâcher. La première pénétration ne fut pas réussie ; le docteur essaya à une autre place, puis à une autre, jusqu'au moment où, franchement agacé par son échec, il donna un coup rapide. Un liquide jaune jaillit et ruissela sur le sol.
— Garde, vite ! Vite ! cria le docteur. Donnez-moi ce tube. (Et il poussa le tube à l'extrémité de l'aiguille d'acier.) J'ai l'impression que ce trocart est complètement émoussé, ajouta-t-il à haute voix.
L'infirmière se mit à genoux à côté du lit et, presque immédiatement, le vieil homme entendit l'eau qui coulait. Voyant son étonnement, la doctoresse lui dit :
— Oui, nous insérons ce trocart dans la poche de liquide de votre plèvre, et quand nous atteignons cette poche, nous libérons les deux clips qui sont sur la bouteille, et le poids de l'eau — eau distillée stérile — entraîne le liquide qui est dans vos poumons. Vous allez être mieux en un rien de temps, lui dit-elle avec une assurance qu'elle n'éprouvait pas.
Le vieil homme devenait de plus en plus pâle, bien qu'il eût été, Dieu merci, plus que coloré auparavant.
— Vous tenez ceci, garde, dit le docteur qui se tourna vers une table.
Il y eut un bruit de métal et de verre ; le docteur revint vers le patient et, d'un mouvement rapide, poussa l'aiguille dans ce qui, Molygruber en était certain, était son cœur. Il crut qu'il allait mourir sur-le-champ. Ce fut d'abord comme un choc terrible, puis une sensation de chaleur et comme un bourdonnement, et il sentit que son cœur battait plus fort. Ses joues retrouvèrent un peu de couleur.
— Alors, on se sent mieux, hein ? demanda le docteur redevenu jovial.
— Vous pensez qu'on devrait lui faire une intraveineuse ? (C'était la doctoresse qui posait cette question.)
— Peut-être pourrait-on. Donnez-moi ce qu'il faut, garde, je vais la faire maintenant, dit le docteur.
La garde partit et revint en poussant ce qui ressemblait à une longue perche avec un crochet au bout. Elle roula l'objet vers le lit et fixa une bouteille au crochet. Elle y attacha un tube de caoutchouc et en tendit l'extrémité au docteur qui, avec soin, introduisit une autre aiguille dans le bras droit de Molygruber. L'infirmière relâcha la pince et il eut la sensation étrange que quelque chose coulait dans ses veines.
— Maintenant, dit le docteur, vous allez vous sentir mieux très vite. Restez tranquille, c'est tout. (Le vieil homme fit un petit signe de la tête, puis somnola à nouveau.) Il ne m'a pas l'air très bien, poursuivit le docteur en se baissant pour le regarder. Il faudra le surveiller.
Les deux docteurs quittèrent la chambre, laissant la garde terminer le travail.
Beaucoup plus tard, comme le jour allait finir, une garde éveilla le vieil homme en lui disant :
— Alors, on a l'air beaucoup mieux maintenant ; il est temps que vous mangiez un petit quelque chose, pas vrai ?
Le vieil homme secoua la tête en silence. La nourriture ne lui disait rien, mais la garde insistait. Elle posa un plateau sur la table de chevet en disant :
— Allez, je vais vous faire manger ; pas de caprices surtout ; on a travaillé trop dur sur vous pour vous perdre maintenant.
Et elle commença à lui mettre dans la bouche une cuillerée de nourriture, puis une autre, sans laisser au pauvre malheureux le temps d'avaler.
C'est au milieu de cette scène que l'agent de police entra et s'approcha de Molygruber.
— J'ai éloigné les journalistes. C'était pas facile, dit-il. Ces hyènes ont essayé de faire irruption dans l'hôpital. Ils veulent des manchettes genre ‘Un balayeur des rues sauve un enfant’ et nous leur avons dit que vous étiez trop malade pour les recevoir. Vous voulez les voir ?
Le vieil homme secoua la tête avec toute la force dont il était capable et marmonna :
— Non, que le diable les emporte, peuvent donc pas laisser un gars mourir en paix !
L'agent de police le regarda en riant.
— Oh ! Y a encore de la vie en vous, mon gars, dit-il, et avant longtemps on vous reverra avec votre brouette, en train de balayer derrière tous ces gens. Mais on tiendra les journalistes à l'écart. Nous les avons menacés de prendre des mesures contre eux s'ils viennent ici puisque vous êtes si malade.
Il sortit, et la garde continua à le nourrir jusqu'à ce que le vieil homme crut que la nourriture allait lui sortir par les oreilles.
Le docteur revint environ une heure plus tard. Il regarda le patient puis se baissa pour examiner la bouteille.
— Il semble que nous ayons tout retiré, dit-il. Maintenant, il va nous falloir pomper un peu d'air pour aplatir le poumon. Nous mettons de l'air dans votre plèvre, ce qui repousse le poumon à l'intérieur afin que vous ne vous en serviez pas pour respirer ; il doit se reposer un peu. Je vais aussi vous donner de l'oxygène.
Passant la tête à travers les rideaux, il dit :
— Vous, les gars, devrez vous arrêter de fumer. Vous ne pouvez pas fumer tandis que nous avons une tente à oxygène en action.
Il y eut des murmures désagréables et même courroucés de la part des autres patients.
— Pourquoi faut-il qu'on se prive d'un plaisir pour lui ? dit l'un d'eux en allumant délibérément une autre cigarette.
Le docteur alla téléphoner. Un infirmier arriva et le vieux Molygruber, toujours sur son lit avec l'intraveineuse toujours en place, fut poussé dans une chambre privée.
— Comme ça, dit le docteur, nous pouvons vous donner de l'oxygène sans risquer qu'un de ces patients ne provoque un incendie. Vous serez très bien ici.
La tente fut rapidement mise en place et un tube ajusté au tuyau d'oxygène dans le mur de la chambre. Molygruber ne tarda pas à sentir qu'il respirait plus aisément.
— Nous vous laisserons là-dessous toute la nuit, dit le docteur, et demain vous devriez vous sentir beaucoup mieux.
Sur ces mots, il sortit.
Le vieil homme dormit plus confortablement cette fois. Mais un peu plus tard dans la soirée, il eut la visite d'un autre docteur qui, après l'avoir examiné soigneusement, lui annonça :
— Je vais maintenant retirer ce trocart ; nous avons correctement asséché ce côté-ci. Dans une heure environ, nous devrons vous radiographier à nouveau, et nous pourrons alors décider ce qu'il faudra faire ensuite.
II s'apprêtait à sortir, mais fit demi-tour pour demander :
— N'avez-vous pas de famille ? Qui voudriez-vous qu'on avertisse ?
— Non, j'ai personne au monde, répondit le vieil homme. J'suis tout seul, mais j'espère que ma vieille brouette est bien à l'abri.
En riant, le docteur répondit :
— Oh ! oui, votre brouette est en sécurité. Ne vous faites pas de souci. Le service de nettoyage de la ville l'a ramenée au dépôt. On s'est occupé de votre brouette. Maintenant, c'est de vous qu'il faut s'occuper. Dormez.
Il était à peine sorti que Molygruber dormait déjà, rêvant de mères courroucées demandant des chapeaux pour leurs enfants, de journalistes envahissant sa chambre. Il ouvrit les yeux pour découvrir qu'un infirmier de nuit débranchait l'appareil de l'intraveineuse et s'apprêtait à l'emmener à la radio.
— Puis-je entrer ? Je suis prêtre.
La voix était mélancolique à l'extrême. Le vieux Molygruber ouvrit les yeux et, l'esprit confus, regarda la silhouette qui se tenait devant lui. C'était un homme très grand, d'une rare maigreur, vêtu de noir, avec un collet blanc au-dessus duquel une pomme d'Adam particulièrement proéminente s'agitait désespérément, comme si elle cherchait à s'échapper de ce cou décharné. Son visage pâle aux joues creuses était affligé d'un énorme nez rouge. Il baissa les yeux vers Molygruber, puis s'assit sur une chaise à côté du lit.
— Je suis un prêtre et j'étudie la psychologie ici, ce qui fait que je peux aider les malades de l'hôpital. J'ai été formé dans les provinces Maritimes.
Molygruber fronça le sourcil, puis dit :
— Oh ! j'ai été formé à Calgary — sur le dépôt d'ordures de la ville.
Le prêtre le regarda. Puis, d'un ton grave et convaincu il dit à Molygruber :
— J'ai été plus attristé que je ne pourrais le dire d'apprendre, par votre feuille d'admission, que vous n'étiez d'aucune confession. Aussi, suis-je venu vous apporter Dieu.
Se renfrognant de plus en plus, le vieil homme répliqua :
— Dieu ? Pourquoi voulez-vous que j'écoute votre radotage sur Dieu ? Qu'est-ce qu'Il a jamais fait pour moi ? Je suis né orphelin. Ma mère m'a toujours ignoré, et j'ai jamais su qui était mon père — un homme parmi une centaine sans doute. J'ai toujours été seul depuis que je suis capable de me souvenir. Quand j'étais petit on m'apprenait à prier, et j'ai prié. Il en est jamais rien sorti — si — ramasseur d'ordures.
Visiblement embarrassé, se tortillant les doigts, le prêtre finit par dire :
— Vous avez un accident de santé très sérieux qui peut vous emporter. Êtes-vous prêt à rencontrer votre Créateur ?
Le regardant droit dans les yeux, le vieil homme répondit :
— Comment savoir qui est mon créateur, l'un ou l'autre parmi une centaine d'hommes, comme je vous ai dit. Vous pensez pas que c'est Dieu qu'est descendu pour me fabriquer avec un petit peu de pâte ? Si ?
L'air scandalisé et plus mélancolique encore, le prêtre lui répondit :
— Vous méprisez Dieu, mon frère. Il n'en sortira rien de bon. Vous devez être prêt à rencontrer votre Créateur, à rencontrer votre Dieu, car dans peu de temps, peut-être, vous devrez affronter Son Jugement. Êtes-vous prêt ?
Avec truculence, Molygruber répliqua :
— Vous croyez vraiment à toutes ces histoires d'une autre vie ?
— Certainement que j'y crois, dit le prêtre. C'est écrit dans la Bible et chacun sait que l'on croit ce qui est dans la Bible.
— Eh bien ! pas moi ! répliqua le vieil homme. J'y crois pas. J'ai pas mal lu, dans ma jeunesse ; j'allais, en fait, à la Classe de Catéchisme et j'ai découvert que tout ce qu'on me racontait là était de la blague. Quand on est mort, on est mort, voilà ce que je dis. On meurt et on vous met dans la terre, quelque part, et si on a de la famille — j'en ai pas — alors ils arrivent, mettent des fleurs dans un pot à confiture et le posent sur vous. Non, vous me ferez jamais croire qu'après cette vie y en a une autre. D'ailleurs, moi, j'en veux pas !
Le prêtre se leva et, très agité, marcha de long en large à travers la chambre jusqu'au moment où le pauvre Molygruber se sentit complètement étourdi par cette forme noire qui, tel l'Ange de la mort, voletait devant ses yeux.
— J'ai feuilleté, une fois, le livre d'un gars qui vit près d'où je travaille, un gars appelé Rampa. Il écrit un tas de niaiseries aussi sur la vie après la mort. Tout le monde sait que c'est des bêtises — la mort, c'est la mort ; et plus longtemps on reste mort, plus on sent mauvais. J'en ai ramassé quelques-uns de raides dans ma vie — ivrognes ou autres, et après un temps — pouah ! — pas possible de s'en approcher.
Le prêtre se rassit auprès du lit et menaça du doigt Molygruber en disant d'une voix courroucée :
— Vous serez puni, homme ; vous souffrirez, car vous blasphémez le nom de Dieu, vous raillez les Écritures Saintes. Vous pouvez être certain que Dieu fera tomber Sa colère sur vous !
Ayant réfléchi pendant un moment, Molygruber reprit :
— Comment des types comme vous peuvent-ils parler d'un Dieu bon, d'un Dieu qui aime tous Ses enfants, d'un Dieu de miséricorde et toute la salade — et nous dire dans la minute qui suit que ce même Dieu exercera Sa vengeance ? J'aimerais que vous m'expliquiez ça. Et une autre chose encore, monsieur... Votre livre dit que si on n'accueille pas Dieu, on va en enfer. Eh ben, j'crois pas non plus à l'enfer ; mais si on est sauvé seulement en accueillant Dieu, qu'est-ce qui se passe pour tous les gens sur Terre avant votre Dieu particulier ? Hein ? Vous m'expliquez ?
Le prêtre se leva à nouveau, la voix tremblant de colère et le visage rouge d'émotion. Secouant son poing à l'adresse de Molygruber, il s'écria :
— Écoutez-moi bien, je ne suis pas habitué à me faire parler sur ce ton par des gens tels que vous. À moins que vous n'embrassiez les enseignements de Dieu, vous serez frappé de mort.
Il s'avança et Molygruber crut qu'il allait le frapper. Dans un effort suprême il parvint à s'asseoir. Il ressentit alors une douleur effroyable dans la poitrine, comme si on lui écrasait les côtes. Son visage bleuit, il se renversa en arrière avec une sorte de hoquet, et ses yeux demeurèrent mi-clos.
Tout pâle, le prêtre se précipita vers la porte :
— Vite, vite ! cria-t-il, venez vite, l'homme est mort tandis que je lui parlais. Je lui disais que la colère de Dieu frapperait son impiété.
Et, sur ces mots, il se mit à courir et s'élança vers un ascenseur demeuré ouvert. En tâtonnant, il réussit à trouver le bouton et disparut.
Une infirmière passa la tête par la porte en disant :
— Que se passe-t-il avec ce vieil épouvantail ? Sa vue suffirait à donner une crise cardiaque à n'importe qui. De toute façon, à qui parlait-il ?
L'infirmier apparut, venant d'une autre chambre, et dit :
— Sais pas. Avec Molygruber, je suppose. Vaut mieux aller voir comment il est.
Tous deux gagnèrent la petite chambre privée. Ils trouvèrent le vieil homme qui tenait toujours sa poitrine. Il avait les yeux entrouverts et la mâchoire pendante. En hâte, l'infirmière pressa le bouton ‘urgence’. Tout de suite, l'interphone de l'hôpital donnait ordre à un docteur de venir d'urgence.
— Je pense qu'il vaut mieux l'arranger un peu, dit l'infirmière, sinon le docteur nous attrapera. Ah ! le voilà.
Le docteur à peine entré dans la chambre s'écria :
— Oh ! Dieu, qu'est-il arrivé à cet homme ? Regardez l'expression de son visage. J'espérais vraiment le remettre d'aplomb en quelques jours. (Prenant son stéthoscope, il ouvrit la veste de pyjama du vieil homme et écouta, tandis que de sa main droite il cherchait le pouls de Molygruber. Celui-ci ne battait plus.) Toute vie est éteinte, garde. Je vais faire le certificat de décès, mais, dans l'intervalle, faites-le transporter à la salle mortuaire. Nous avons besoin de son lit ; il y a tellement de malades.
Puis retirant son stéthoscope, il se tourna pour noter quelque chose sur la feuille de Molygruber, et sortit.
La garde et l'infirmier retirèrent draps et couvertures et reboutonnèrent la veste de pyjama de Molygruber.
— Vous amenez le brancard, dit la garde à l'infirmier.
Celui-ci revint avec le brancard sur lequel Molygruber était allé à la radio. La garde et l'infirmier levèrent les draps qui le recouvraient, mettant à découvert une autre planche sous le brancard proprement dit. Ils y poussèrent le corps de Molygruber et l'y attachèrent — car on estimait qu'il eût été fâcheux qu'un cadavre tombe sur le sol — puis ils laissèrent retomber les draps, dissimulant complètement le corps.
L'infirmier se mit à rire en disant :
— Vous ne croyez pas qu'il y a des visiteurs qui piqueraient une crise s'ils savaient que ce brancard qui a l'air vide transporte un cadavre ?
Sur ces mots, il partit, poussant son chargement en sifflotant, et gagna les ascenseurs. Il pressa le bouton ‘sous-sol’, le dos appuyé contre son brancard et laissant sortir les gens à chaque étage.
Comme personne n'entra au rez-de-chaussée, il descendit au sous-sol et sortit le brancard de l'ascenseur. Il tourna, suivit un corridor et donna un petit coup sec contre une porte qu'on ouvrit immédiatement.
— En voilà un autre pour vous, annonça l'infirmier. Vient juste de mourir. Je l'ai amené tout de suite ; je pense pas qu'il y aura une autopsie. Vous feriez bien de l'arranger convenablement.
— De la famille ? demanda le préposé.
— N'en a pas, dit l'infirmier. Il sera peut-être enterré dans la fosse commune, ou comme il était balayeur des rues et qu'il travaillait pour la Ville, peut-être qu'elle lui paiera un enterrement. Mais j'en doute, parce que c'est une bande de types drôlement moches.
Cela dit, l'infirmier aida le préposé à porter le corps jusqu'à la table mortuaire, puis, ramassant le drap, il sortit et s'en alla vers l'ascenseur en sifflotant.
Chapitre Trois
Mais qu'arriva-t-il à Leonides Manuel Molygruber ? Disparut-il comme une lumière qu'on a soudain éteinte ? A-t-il expiré comme une allumette qu'on souffle ? Non ! Pas du tout.
Couché dans son lit d'hôpital et se sentant malade, assez malade pour mourir, Molygruber avait été très bouleversé par ce prêtre. Il avait été ulcéré par cet homme si dépourvu de charité chrétienne et dont il voyait le visage se congestionner de fureur, cet homme prêt à lui sauter à la gorge. Ce que voyant, il s'était brusquement assis sur son lit pour essayer de se protéger, alors que peut-être il aurait pu appeler à l'aide.
S'asseoir avait représenté pour lui un effort immense qui avait mobilisé tout son souffle. En respirant ainsi de toutes ses forces, il avait éprouvé une terrible douleur dans la poitrine. Son cœur avait fait une véritable course de vitesse, comme le moteur d'une voiture dont la pédale des gaz est poussée à bloc alors que la voiture est à l'arrêt. Son cœur accéléra — puis s'arrêta.
Le vieil homme avait connu tout de suite une effroyable panique. Qu'allait-il lui arriver ? Qu'était-ce que la fin ? Maintenant, pensa-t-il, je vais être soufflé comme ces chandelles que j'éteignais à la maison, dans la seule maison que j'aie connue comme orphelin. La panique était totale ; chacun des nerfs de son corps était en feu. Il avait la sensation qu'on essayait de le retourner sens dessus dessous comme on fait d'un lapin mort — quand on le dépèce avant de le mettre à cuire.
Puis il y eut soudainement le plus violent tremblement de terre qui soit, ou du moins c'est ce qu'il crut, et pour le vieux Molygruber tout se mit à tourner. Le monde lui sembla composé de points comme une poussière aveuglante, tel un cyclone tourbillonnant. Puis ce fut comme si quelqu'un l'avait saisi et mis dans une essoreuse ou dans une machine à saucisses. Il était dans tous ses états.
Ensuite tout s'obscurcit. Les murs de la chambre, ou ‘quelque chose’, semblèrent se refermer sur lui. Il eut l'impression d'être enfermé dans un tube de caoutchouc gluant, visqueux, d'où il essayait de sortir pour retrouver la sécurité.
Tout devint plus noir, plus noir encore. Il semblait être dans un long, long tube, un tube d'une totale noirceur. Mais alors très loin, à distance, dans ce qui était sans aucun doute l'extrémité du tuyau, il vit une lumière, mais était-ce une lumière ? C'était une chose rouge, une chose tournant à l'orange vif comme la veste qu'il portait pour nettoyer les rues. Frénétiquement, luttant centimètre par centimètre pour avancer, il força son chemin pour atteindre l'extrémité du tube. Il s'arrêta un instant pour respirer et découvrit qu'il ne respirait pas. Il écouta et écouta, mais il ne pouvait entendre les battements de son cœur ; il n'entendait qu'un bruit curieux à l'extérieur, comme le souffle d'un vent puissant. Puis, tandis qu'il restait volontairement immobile, il lui sembla qu'on le poussait vers le haut et petit à petit il atteignit l'extrémité du tube. Il y resta coincé là pendant un moment, puis il y eut un violent ‘pop’ et il se trouva projeté hors du tube, tel un pois hors d'une petite sarbacane. Il tourna pendant un moment dans tous les sens, puis il n'y eut plus rien. Ni lumière rouge ou orange. Il n'y avait même pas de noirceur. Il n'y avait — RIEN !
Au comble de l'effroi et se sentant dans un état très particulier, il tendit les bras, mais rien ne bougea. C'était comme s'il n'avait pas de bras. La panique à nouveau le gagna et il essaya de donner un coup de pied, un violent coup de pied avec ses jambes, cherchant à toucher quelque chose. Mais de nouveau, il n'y avait rien, rien du tout. Il ne pouvait pas sentir ses jambes. Dans un suprême effort, il essaya de poser ses mains sur son corps, mais il se rendit compte qu'il n'avait ni mains ni jambes, et qu'il ne pouvait sentir son corps. Il ‘était’. C'est tout. Un fragment de quelque chose entendu longtemps auparavant lui revint à la conscience. C'était au sujet d'un esprit désincarné, un fantôme sans forme, sans silhouette, sans être, mais existant d'une certaine façon, quelque part. Il avait l'impression d'être violemment en mouvement, mais en même temps il ne semblait pas bouger du tout. Il ressentit d'étranges pressions, puis tout à coup il sentit qu'il était dans du goudron, du goudron chaud.
Longtemps, il y avait de cela longtemps, presque au-delà de sa mémoire — alors qu'il était un petit garçon, il rôdait autour d'ouvriers qui goudronnaient une route. L'un d'eux, ayant peut-être une mauvaise vue ou bien voulant faire une farce, du sommet ouvert d'un réservoir avait fait basculer une brouette de goudron qui s'était répandue sur le petit garçon. Il avait été coincé, presque incapable de bouger, et c'était ce qu'il éprouvait en ce moment. Il avait très chaud, puis ensuite l'effroi le glaçait, et tout le temps persistait la sensation de mouvements illusoires, puisqu'il était immobile ; immobile — pensa-t-il — de l'immobilité de la mort.
Le temps passa. Passait-il vraiment ? Il l'ignorait. Il savait seulement qu'il était là, au centre du néant. Il n'y avait rien autour de lui, il n'y avait rien à son corps, ni bras, ni jambes, et il supposait qu'il devait bien avoir un corps, sinon comment pouvait-il exister ? Mais, sans mains, il était incapable de le sentir. Il força ses yeux, scrutant, scrutant, scrutant, mais il n'y avait rien à voir. Il ne faisait même pas sombre, ce n'était pas du tout l'obscurité, c'était le néant. De nouveau, un fragment de pensée vint à son esprit qui, d'une certaine façon, faisait référence aux recoins les plus profonds des océans de l'espace où il n'y a rien. Il se demanda vaguement où il avait pris conscience de cela, mais rien de plus ne lui vint.
Il existait, seul, dans le néant. Il n'y avait rien à voir, rien à entendre, rien à sentir, rien à toucher, et même s'il y avait eu quelque chose à toucher, il n'avait rien pour lui permettre de toucher.
Le temps passait, ou est-ce qu'il passait ? Il n'avait aucune idée depuis combien de temps il était là. Le temps n'avait aucun sens. Plus rien n'en avait désormais. Il était simplement ‘là’. Il avait l'impression d'être un grain de poussière suspendu dans le néant comme une mouche est retenue dans une toile d'araignée, mais non, la comparaison n'est pas bonne, car la mouche est tenue par la toile de l'araignée. Le vieux Molygruber, lui, était pris dans le néant qui le réduisait à un état de néant. Son esprit — ou ce qui lui tenait lieu d'esprit — vacillait. Il se serait trouvé mal, pensa-t-il, s'il y avait eu quelque chose pour lui permettre de se sentir mal.
Il ‘était’ simplement un je-ne-sais-quoi, ou même peut-être un rien entouré de néant. Son esprit, ou sa conscience, ou quoi que ce soit qui lui restait à présent, tournait au ralenti, cherchait à formuler des idées, essayait de produire quelque chose à la place de l'horrible néant qui était là. Cette pensée lui vint : "Je ne suis rien, si ce n'est un rien existant dans le néant."
Soudain, tout comme une allumette brillant dans une nuit sans lune, une pensée lui vint : quelque temps auparavant, un homme lui avait demandé de faire un petit travail supplémentaire, payé ; il s'agissait de nettoyer un garage. Le vieux Molygruber s'y était rendu et, en fouinant, avait déniché une brouette et quelques outils de jardinage ; puis il avait ouvert la porte du garage, car l'homme lui en avait remis la clef la veille. L'intérieur offrait le plus étrange ramassis de vieilleries jamais vu : un sofa dont les ressorts s'échappaient, une chaise avec deux pieds cassés et dont le tissu était tout mité. Accrochés au mur, un cadre et la roue avant d'une bicyclette. Tout autour, une quantité de pneus — pneus à clous et pneus usés. À côté traînaient des outils rouillés et inutilisables. Ces vieux trucs étaient de ceux que seuls des gens très économes sont capables d'accumuler — une lampe à pétrole avec un abat-jour déchiré, un store vénitien et, dans le coin le plus éloigné, un de ces mannequins sur une base en bois dont se servent les femmes pour confectionner leurs robes. Il sortit le tout qu'il transporta ensuite et empila à l'extérieur, prêt pour la collecte des ordures du lendemain. Puis il revint au garage.
Une vieille baignoire sur laquelle on avait placé une table de cuisine délabrée avait attiré sa curiosité, et il avait essayé de la sortir de dessous la table. Ne pouvant y parvenir, il avait alors décidé d'enlever d'abord la table ; il tira et le tiroir central tomba. Il contenait quelques pièces de monnaie. "Ma foi, se dit le vieux Molygruber, me paraît dommage de les jeter ; peuvent servir à acheter un hot dog ou deux." Il les avait donc mises dans sa poche. Le fond du tiroir renfermait encore une enveloppe avec des billets de banque de différents pays. "Bonne aubaine, s'était-il dit ; je les porterai au bureau de change." Mais revenons à la baignoire. Il enleva la table, la poussa dehors et trouva, entassées sur le dessus de la baignoire, tout un tas de toiles et de bâches moisies, puis une chaise longue apparut. Il les jeta dehors, puis amena la baignoire au milieu du garage.
Ce vieux baquet renfermait une montagne de livres — certains très étranges eux aussi. Mais Molygruber s'occupa de les en retirer et de les empiler sur le sol. Il découvrit ainsi certains livres de poche qui éveillèrent un vague souvenir dans son esprit – Rampa, livres par Rampa. Nonchalamment, il les feuilleta.
"Ah ! se dit-il, les livres de ce type-là doivent être de la crotte de bique ! Un type qui croit que la vie dure et dure à tout jamais. Pouah ! (Il laissa choir les livres sur la pile, puis en repêcha d'autres.) Ce Rampa m'a tout l'air d'avoir écrit un nombre formidable de livres.
Molygruber les compta, les recompta, étonné d'en trouver autant. Certains étaient tout tachés d'encre. Une bouteille avait dû être renversée sur eux. L'un avait une superbe reliure. Molygruber eut un soupir de regret en voyant le cuir tout maculé d'encre. "Quel dommage !" se dit-il. Il aurait pu en retirer quelques dollars, juste pour la reliure. Mais ce qui est fait est fait — le livre alla rejoindre les autres.
Tout au fond de la baignoire, restait un autre livre dans une solitaire splendeur ; il avait échappé à la saleté, à la poussière, à la peinture et à l'encre, enfermé qu'il était dans une enveloppe de plastique. Molygruber le ramassa, le sortit de l'enveloppe et en lut le titre. ‘Vous — Pour toujours’. Tournant les pages et voyant qu'il y avait des illustrations, il glissa le livre dans sa poche.
À cette heure, dans l'état particulier de néant où il se trouvait, il se rappelait certaines choses de ce livre. En rentrant chez lui ce soir-là, il avait acheté une bière et un gros morceau de fromage au supermarché. Puis, les pieds surélevés, il avait pris le livre ‘Vous — Pour toujours’. Mais certaines choses lui semblant par trop fantastiques, il ne tarda pas à jeter le livre dans un coin de la chambre. Maintenant, il regrettait amèrement de ne pas avoir persisté dans sa lecture, car il aurait peut-être, s'il l'avait fait, la clef de son dilemme actuel.
Ses pensées tourbillonnaient comme des particules de poussière dans une brise vagabonde. Que disait donc le livre ? Que voulait dire l'auteur en écrivant ceci ou en écrivant cela ? Qu'est-ce qui avait bien pu se passer ? Molygruber se rappela amèrement sa constante opposition à l'idée d'une vie après la mort.
Un des livres de Rampa, ou était-ce une lettre ramassée dans les ordures, lui revint soudain à l'esprit. ‘À moins que vous ne croyiez en une chose, elle ne peut pas exister.’ Et ceci : ‘Si un homme d'une autre planète venait sur cette Terre et que son aspect soit totalement étrange aux humains, ceux-ci pourraient fort bien être incapables de le voir du fait que leur esprit se refuserait à croire ou à accepter quelque chose d'aussi éloigné de leurs points de référence.’
Molygruber pensa et pensa, puis se dit à lui-même : "Eh bien, je suis mort, mais je suis quelque part ; je dois donc exister ; aussi il doit y avoir quelque chose dans cette vie après l'affaire de la mort. Je voudrais bien savoir ce que c'est." Tandis qu'il pensait, ses sensations — viscosité ou néant — étaient si particulières qu'il ne parvenait même pas à imaginer ce qu'elles pouvaient être ; mais, tout en pensant qu'il pouvait se tromper, il fut convaincu que quelque chose était près de lui, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Il se demanda si ce n'était pas parce qu'il était en mesure, maintenant, d'accepter l'idée que la vie ne finissait pas avec la mort ?
D'ailleurs il avait entendu d'étranges choses ; les gars, au dépôt, avaient parlé un jour d'un gars à l'hôpital de Toronto. Ce gars était censé être mort et sorti de son corps. Molygruber ne se rappelait pas exactement l'histoire, si ce n'est que cet homme, mort après une grave maladie, avait quitté son corps et avait vu, dans un autre monde, des choses étonnantes. Ensuite, à sa grande fureur, les docteurs avaient ramené à la vie son corps mourant ou mort, et il était revenu et avait raconté son aventure aux journalistes. Soudain Molygruber exulta : il était presque capable de voir des formes autour de lui.
Il s'assit brusquement, tendant la main pour arrêter la sonnerie de ce satané réveille-matin. Il sonnait comme jamais il n'avait sonné... mais il se souvint qu'il n'était pas endormi et se rappela qu'il ne pouvait sentir ni ses bras ni ses mains ni même ses jambes, et que tout autour de lui n'était que néant — que rien n'existait à part cet insistant retentissement qui aurait pu être une sonnerie, mais ne l'était pas. Il ignorait ce que c'était. Tandis qu'il réfléchissait au problème, il sentit qu'il se déplaçait à une vitesse fantastique, une vitesse incroyable mais, à nouveau, il ne s'agissait pas du tout de vitesse. Il était trop peu cultivé pour être au courant des différentes dimensions, troisième, quatrième, et ainsi de suite, mais ce qui se passait c'est qu'il était déplacé selon d'anciennes lois occultes. Ainsi il avançait. Nous nous servirons du mot ‘avancer’, car il est vraiment très difficile de dépeindre des phénomènes de la quatrième dimension avec des termes de la troisième.
Molygruber avait l'impression de se déplacer de plus en plus vite ; puis, il y eut ‘quelque chose’ et, en regardant autour de lui, il vit des formes floues, des choses comme à travers un verre fumé. Il y avait eu, un peu auparavant, une éclipse de soleil et un de ses compagnons de travail lui avait tendu un morceau de verre fumé en lui disant : "Regarde à travers, Moly, et tu verras ce qui arrive autour du soleil, mais ne le fais pas tomber."
Tandis qu'il regardait, la fumée se dissipa graduellement et il aperçut une chambre étrange et la regarda avec une horreur et une frayeur croissante.
Il avait devant lui une vaste pièce dans laquelle se trouvaient différentes tables ressemblant à des tables d'hôpital avec toutes sortes d'équipements. Chacune d'elles était occupée par un corps nu — mâle ou femelle — tous de la même teinte bleue de la mort. Plus il regardait et plus il se sentait mal. D'horribles choses arrivaient à ces corps ; en divers endroits, on leur enfonçait des tubes desquels s'échappait un affreux gargouillis de liquide. Puis il y avait le ronronnement des pompes. Fasciné, il regarda de plus près et vit qu'on retirait du sang de certains de ces corps et que, dans certains autres, on injectait une sorte de fluide, et au fur et à mesure que ce fluide pénétrait un corps, celui-ci passait de son horrible teinte bleuté à une couleur exagérément saine.
Sans pitié, Molygruber fut encore déplacé. Il passa dans une petite alcôve où une jeune femme était assise près d'une des tables, en train de maquiller le visage d'un cadavre femelle. Le spectacle fascinait Molygruber. Il vit qu'on ondulait les cheveux, qu'on passait un crayon sur les sourcils, du rose sur les joues et, sur les lèvres, un bâton de rouge d'un ton trop vif, pensa-t-il.
Il avança et frémit d'horreur en voyant un autre corps qui, apparemment, venait juste d'arriver. Sur les yeux clos étaient posées de curieuses pièces de métal de forme conique, qu'il soupçonna être destinées à tenir les paupières baissées. Et alors il vit qu'on poussait une aiguille d'aspect redoutable à travers les gencives supérieures et inférieures. Il se sentit franchement malade quand l'homme qui effectuait le travail enfonça soudainement un instrument dans la narine gauche du cadavre et, saisissant la pointe de l'aiguille, il la piqua directement à travers la cloison nasale, après quoi le fil fut tiré afin de réunir les deux mâchoires et garder la bouche fermée. Cela lui souleva le cœur, et s'il l'avait pu, il aurait vomi.
Il continua d'avancer et, bouleversé, vit un autre corps qu'il reconnut, avec difficulté, comme étant le sien. Le corps nu gisait sur une table — décharné, émacié et dans un triste état. Avec désapprobation, il regarda ses jambes arquées et ses articulations noueuses. Près de lui il y avait un cercueil, ou, pour être plus précis, juste une caisse.
La force le poussa en avant ; il traversa un petit corridor et entra dans une chambre. Il se déplaçait sans qu'intervienne sa propre volonté. Dans la chambre, il fut immobilisé. Il reconnut quatre de ses compagnons de travail. Ils étaient assis et parlaient avec un jeune homme mielleux, très bien vêtu, qui n'avait en tête que l'idée du montant qu'il pouvait tirer de l'affaire.
— Voyez-vous, disait l'un d'eux, Molygruber travaillait pour la Ville. Il n'a pas beaucoup d'argent, et sa vieille voiture ne vaut guère plus de cent dollars. C'est un vieux clou qui devait lui rendre service ; mais c'est tout ce qu'il a. On en retirera peut-être une centaine de dollars, et il a une très ancienne télévision en noir et blanc — qui peut aller chercher de vingt à trente dollars. Quant à ses effets personnels, ils ne valent même pas dix dollars. Ce qui ne laisse pas beaucoup pour des funérailles.
— J'aurais cru, dit le jeune homme doucereux et bien vêtu, en faisant la moue, que vous auriez organisé une collecte pour un de vos collègues mort dans des circonstances particulières. Nous savons qu'il a sauvé une enfant qui se noyait et que cet acte lui a coûté la vie. Quelqu'un, même la Ville, ne serait-il pas prêt à payer pour des funérailles en bonne et due forme ?
Ses collègues se regardèrent, secouant la tête et tripotant leurs doigts, puis l'un d'eux dit :
— Eh bien, je ne sais pas... la Ville ne veut pas payer pour ses funérailles et créer un précédent. On nous a dit que si quelque chose était payé par la Ville, tel ou tel conseiller municipal soulèverait des tas d'objections. Non, je ne pense pas que la Ville fasse quoi que ce soit.
Le jeune homme essayait de cacher son impatience. Après tout, c'était un homme d'affaires et son job c'était la mort — cadavres, cercueils, etc. — et il devait faire de l'argent. Puis, comme s'il venait d'avoir une idée :
— Son syndicat ne ferait rien pour lui ? demanda-t-il.
D'un commun accord, les quatre collègues secouèrent la tête.
— Non, dit l'un ; nous les avons interrogés mais personne ne veut rien faire. Le vieux Molygruber était juste un balayeur des rues, et si les gens donnaient quelque chose pour ses funérailles, personne ne le saurait ni n'en tirerait publicité.
Se levant, le jeune homme se dirigea vers la pièce voisine. Il appela les quatre hommes.
— Si vous venez ici, je peux vous montrer différents cercueils, mais le meilleur marché pour un enterrement serait de deux cent cinquante dollars. Ce serait vraiment le plus bas prix, juste une caisse en bois et le corbillard pour l'emmener au cimetière. Pourriez-vous réunir deux cent cinquante dollars ?
Les hommes semblaient très embarrassés, puis l'un dit enfin :
— Oui... je crois qu'on pourrait ; mais on ne peut pas vous les donner maintenant.
— Il n'en est pas question. Je ne m'attendais pas à ce que vous me payiez tout de suite, dit le jeune homme. Il suffira que vous me signiez ce papier qui garantit le paiement. C'est simplement pour nous couvrir, car ces dépenses ne sont pas de notre responsabilité.
Les quatre hommes se regardèrent d'une manière significative.
— O.K. ! dit l'un. Je suppose qu'on pourra aller jusqu'à trois cents dollars, mais pas un centime de plus. Je vais signer.
Le jeune homme lui tendit un stylo et l'homme signa en indiquant son adresse. Les trois autres firent de même.
Son Formulaire de Garantie en main, le jeune homme leur sourit tout en disant :
— Il faut être sûr de ces choses, vous savez, car M. Molygruber occupe un espace dont nous avons grand besoin. Nous avons une affaire qui marche très bien ; nous tenons à ce qu'il soit enlevé aussi vite que possible, sinon il y aurait des frais.
Les hommes hochèrent la tête. "Au revoir", dit l'un d'eux, et sur ce ils se dirigèrent vers la voiture qui les avait amenés. Ils roulèrent, silencieux et pensifs pendant un moment, puis l'un d'eux dit soudain :
— Je suppose qu'il va nous falloir rassembler cet argent très rapidement ; j'aime pas savoir le vieux Moly coincé dans cet endroit.
— Quand on pense, dit un autre, que ce pauvre diable a passé des années à balayer les rues, gardant sa brouette en meilleur état que n'importe qui d'autre, et que maintenant qu'il est mort après avoir sauvé une vie, personne ne veut en accepter la responsabilité — et que c'est à nous de lui montrer un peu de respect. C'était pas un mauvais gars, dans le fond. Alors, voyons comment réunir la somme. Vous avez idée comment on va s'y prendre ?
Il y eut un silence. Aucun des quatre n'y avait sérieusement réfléchi. L'un finit par dire :
— D'abord je pense qu'il faudra demander un congé pour s'assurer qu'il est mis en terre convenablement. On ferait mieux d'aller parler au contremaître pour voir ce qu'il en dit.
Molygruber dérivait, voyant la ville qu'il connaissait si bien. Il avait l'impression d'être comme un de ces ballons qui volent au-dessus de Calgary en faisant de la publicité pour une marque de voiture ou autre chose. Il dérivait, sans le moindre contrôle, semblant tout d'abord émerger du toit de la morgue. Regardant vers le bas, il vit combien les rues étaient mornes, combien les maisons étaient mornes, et à quel point elles avaient besoin d'une couche de peinture, d'un ‘coup de pinceau’, comme il disait. Il vit les vieilles voitures garées dans les allées et sur le bord de la route, puis il atteignit le bas de la ville ; il éprouva tout un pincement au cœur en voyant son vieux domaine familier et y découvrit un étranger, un étranger qui portait son casque de plastique et poussait sa brouette, et portant probablement ce qui avait été sa veste de sécurité rouge, fluorescente. Il s'intéressa à l'homme qui poussait nonchalamment le balai le long des caniveaux et attrapait de temps à autre les deux cartons pour ramasser les ordures et les déposer dans la brouette. Sa brouette, elle aussi, avait l'air en piteux état ; il pensa qu'elle n'était pas aussi soignée que lorsqu'il s'en servait. Continuant à dériver, il regarda d'un œil critique et réprobateur les papiers et détritus jonchant les rues, s'intéressa à un bâtiment en construction et regarda les grues qui soulevaient la terre qui était emportée à travers la ville par la forte brise qui soufflait.
Quelque chose le poussa vers le Dépôt D'Assainissement. Il se retrouva en train de flotter au-dessus de la ville, dirigé vers un camion d'assainissement qui allait récupérer les brouettes et les hommes. Mais il continua à dériver jusqu'au dépôt, où il s'enfonça à travers le toit. Là, il trouva ses quatre anciens collègues en conversation avec le contremaître.
— Enfin, on peut pas le laisser là-bas, disait l'un d'eux. C'est affreux de penser qu'il n'a pas assez d'argent pour être mis en terre convenablement et que personne ne va essayer de s'en occuper.
Le contremaître répondit :
— Pourquoi ne pas organiser une collecte ? C'est le jour de la paye ; si chacun des hommes donne seulement dix dollars on pourra l'enterrer décemment avec quelques fleurs. Je l'ai connu tout gosse ; il n'a jamais rien eu ; j'ai parfois pensé qu'il était un peu détraqué, mais il a toujours bien fait son boulot, même s'il était moins rapide que beaucoup. Oui, v'là ce qu'on va faire ; on va mettre une petite note au-dessus de la baraque de paye en demandant à chacun de donner au moins dix dollars.
— Combien donnerez-vous ?
Le contremaître se pinça les lèvres et farfouilla dans sa poche. Il en sortit un vieux portefeuille et regarda à l'intérieur.
— Voilà, dit-il, c'est tout ce que j'ai jusqu'à ce que je touche ma paye : vingt dollars. Prenez-les, je donne vingt dollars.
Fourrageant dans les ordures, un des hommes y dénicha une boîte de carton. Il y fit une encoche dans le milieu, et dit :
— Voilà la boîte pour la collecte. On la mettra avec la notice devant la baraque de paye. On va vite demander à un des employés de rédiger la note avant que les types aient touché leur argent.
Les hommes commençaient à rentrer de leur tournée. Les brouettes furent déchargées des camions et rangées à la place qui leur était attribuée ; les hommes placèrent les balais dans les râteliers puis, tout en bavardant, se dirigèrent vers la baraque.
— Qu'est-ce que c'est ? demanda l'un d'eux en voyant la note.
— Notre défunt collègue Molygruber. Il n'y a pas de quoi payer ses funérailles. Vous pouvez pas, les gars, cracher au moins dix dollars chacun ? C'était un des nôtres, et il a fait partie du personnel pendant très, très longtemps.
Il y eut un peu de grogne, puis le premier homme s'avança pour recevoir son enveloppe. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Il s'empressa de la mettre dans sa poche ; mais à la vue des visages autour de lui, il la ressortit sans enthousiasme et l'ouvrit à contrecœur. Lentement, il en retira un billet de dix dollars. Il le regarda, le tourna et le retourna, puis le glissa en soupirant dans la boîte et s'éloigna. Les autres reçurent leur paye et chacun, sous l'œil vigilant de tous les hommes rassemblés, sortit un billet de dix dollars et le mit dans la boîte de collecte. L'opération était achevée et tous avaient donné leurs dix dollars — sauf un.
— Eh ben, non ! j'connaissais pas le type. Y a qu'une semaine que j'suis là. Pourquoi voulez-vous que j'paie pour un gars que j'ai même jamais vu ?
Sur ces mots, il enfonça sa casquette et se dirigea vers sa vieille voiture qui partit en hoquetant.
Le contremaître s'avança vers les quatre hommes qui s'étaient occupés de la collecte :
— Pourquoi vous n'allez pas voir les Gros Bonnets ? Peut-être qu'ils donneraient un petit quelque chose. Vous ne risquez rien à le faire ; ils ne peuvent pas vous vider pour ça ? Vous ne croyez pas ?
Et les quatre hommes se dirigèrent vers les bureaux des hauts fonctionnaires. Ils étaient mal à l'aise, se dandinant d'un pied sur l'autre. Sans dire une parole, l'un d'eux plaça la note et la boîte devant l'un des directeurs. Il la regarda, soupira, sortit son billet de dix dollars, le plia et le mit dans la boîte. Les autres l'imitèrent. Dix dollars, ni plus ni moins. Le tour fini, les quatre hommes rejoignirent le contremaître.
— Maintenant, les gars, leur dit-il, vous allez porter l'argent au comptable pour qu'il nous donne le total. Cela va nous tirer d'affaire.
Chapitre Quatre
Gertie Glubenheimer promena un regard mélancolique à travers la vaste pièce. Partout des corps, pensa-t-elle : des corps à ma gauche, des corps à ma droite, des corps devant et des corps derrière moi ; quelle pauvre bande ! Elle se redressa et regarda l'horloge à l'extrémité de la pièce. Midi et demi ; l'heure du lunch, se dit-elle. Elle sortit son panier de dessous la table sur laquelle elle travaillait et, se tournant, posa son livre et ses sandwichs sur le corps à côté d'elle. Gertie était embaumeuse. Elle arrangeait les cadavres à la Maison Funéraire afin qu'ils puissent être vus par les parents admiratifs. "Oh ! regarde-le ! Est-ce qu'oncle Nick n'est pas bien, maintenant ?" diraient les gens. Gertie était familiarisée avec les cadavres, familiarisée à un point tel qu'elle jugeait inutile de se laver les mains pour manger après avoir tripoté ses clients.
Une voix éclata :
— Quel est l'idiot qui a laissé ce cadavre autopsié ouvert sans remplir la cavité de la poitrine ?
Le petit homme qui parlait sur le seuil semblait fou de rage.
— Pourquoi, patron ? Que s'est-il passé ? demanda un homme sur un ton distrait.
— Ce qui s'est passé ? Je vais vous le dire ! La femme du gars s'est penchée pour l'embrasser et lui dire adieu, et comme il n'y avait qu'un morceau de journal sous le drap, son coude est entré dans la cavité de la poitrine. Et maintenant elle est en proie à une crise de nerfs. Elle menace de nous traîner en justice.
On entendit un ricanement mal réprimé, car de telles choses étaient fréquentes et personne ne les prenait très au sérieux. Mais le fait est que les proches n'auraient pas voulu qu'on sache qu'on avait mis un coude dans l'être aimé lorsqu'on s'apprêtait à l'inhumer.
Le patron leva les yeux et s'avança vers Gertie en trottinant :
— Enlevez votre panier de son visage, gronda-t-il, vous lui courbez le nez et nous ne pourrons jamais le redresser.
— O.K., patron, O.K., répondit Gertie. Calmez-vous, ce type est un fauché, il ne risque pas d'être exposé !
Le patron regarda le numéro de la table, consulta une liste qu'il portait et dit :
— Oh ! lui, oui ; ils ne peuvent pas aller au-delà de trois cents dollars ; on va juste le mettre en caisse et l'expédier. Et que va-t-on faire du point de vue vêtements ?
La fille tourna les yeux vers le corps nu en disant :
— Qu'est-ce que vous reprochez à ceux qu'il avait à son arrivée ici ?
— À peu près juste bons à jeter aux ordures. Et puis ils ont tellement rétréci au lavage qu'on ne pourra plus les lui mettre.
— Vous vous souvenez de ces vieux rideaux qu'on avait trouvés trop décolorés pour s'en servir à nouveau ? Ne pourrait-on pas l'envelopper dedans ? demanda Gertie.
Le patron la regarda de travers en répliquant :
— Des rideaux qui valent au moins dix dollars ! Qui paiera ? Je crois que ce qu'il a de mieux à faire c'est de mettre des copeaux dans le fond du cercueil, de le déposer dedans, et de remettre des copeaux par-dessus. Personne ne le verra de toute façon. Faites cela.
Il disparut et Gertie continua son déjeuner.
Molygruber, dans sa forme astrale, planait sur tout cela, sans être vu, sans être entendu, mais voyant et entendant tout. Il en avait assez de la façon dont son corps était traité, mais une force étrange le maintenait là ; il ne pouvait se déplacer. Il observait tout ce qui se passait, regardait des corps de femmes qu'on rhabillait de robes absolument merveilleuses, et des hommes auxquels on passait des vêtements de soirée, alors que lui, pensait-il, devrait s'estimer heureux de recevoir une ou deux poignées de copeaux.
— Que lisez-vous, Bert ? demanda quelqu'un.
Un jeune homme tenant un livre dans une main et un hamburger dans l'autre leva la tête soudainement en agitant le livre :
— ‘Je Crois’, répondit-il. Un bigrement bon livre de ce Rampa qui habite dans notre ville. J'ai lu tout ce qu'il a écrit et une chose est restée encrée dans mon esprit : c'est qu'il faut croire en quelque chose, parce que si vous ne croyez en rien, vous êtes bel et bien coincé dans le désert. Prenez le type qui est là — il désigna d'un geste le corps du vieux Molygruber, gisant nu sur une table — il était complètement athée. Je me demande ce qu'il fait maintenant. Il ne peut pas être au ciel vu qu'il n'y croit pas ; peut pas être en enfer non plus puisqu'il n'y croit pas davantage. Il doit être coincé entre les mondes. Ce Rampa répète toujours que vous n'êtes pas obligé de croire ce qu'il dit, mais vous devez croire en quelque chose — ou, en tout cas, garder l'esprit ouvert, car si vous ne le faites pas, les aides, ou ceux qui sont de l'Autre Côté, ne peuvent vous contacter, ne peuvent vous aider. Et quelque part dans un de ses livres il dit qu'alors, au moment de la mort, vous êtes plongé dans le néant.
Le jeune homme rit et reprit :
— Il dit aussi qu'au moment précis où les gens quittent leur corps, ils voient ce qu'ils s'attendent à voir. Ce doit être tout un spectacle de voir partout des anges qui voltigent !
Un homme se leva pour venir jeter un coup d'œil à la couverture du livre.
— Drôle de bille qu'il a ce type-là. Vous ne trouvez pas ? Je me demande bien ce que veut dire cette image ?
— Je ne sais pas, répondit le possesseur du livre. Que le diable m'emporte si j'ai jamais su ce que signifiaient ces couvertures. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le livre. C'est pour ça que je l'achète.
Le vieux Molygruber se rapprocha sans être pour rien dans ce déplacement. Il était simplement guidé d'un endroit à un autre, et se trouvant juste au-dessus des hommes alors qu'ils parlaient du livre, il entendit leurs propos et ceci resta dans son esprit : "Si vous ne croyez pas en une chose, alors pour vous elle n'existe pas. Et alors, qu'allez-vous faire ?"
L'heure du déjeuner s'achevait. Certains lisaient, leur livre posé sur des corps, et Gertie avait étalé son casse-croûte sur Molygruber, s'en servant comme d'une table. Puis la cloche sonna. Les gens ramassèrent les restes de leur repas et jetèrent les papiers sales dans la poubelle. Prenant une brosse, Gertie fit tomber les miettes tombées sur le cadavre de Molygruber, qui regarda avec dégoût les gestes insensibles de cette fille.
— Hé ! là ! les gars, préparez ce corps immédiatement ; posez un peu de copeaux dans la boîte numéro quarante-neuf et mettez-y le gars. Puis remettez un peu de copeaux. Il ne devrait pas y avoir de fuite, mais il faut s'assurer que tout soit bien en ordre.
Le patron revint, une pile de papiers dans la main, en disant :
— Ils veulent que les funérailles aient lieu à 2 heures et demie, cet après-midi, ce qui est un peu rapide. Il faut que j'aille me changer. Il se retourna et disparut.
Gertie et un des deux hommes firent rouler le corps de Molygruber sur le côté et le ficelèrent. On tira des crochets qu'on engagea dans des œillets métalliques et le corps se balança sur ce qui semblait être une petite voie ferrée. Ils poussèrent le corps de Molygruber vers la boîte numérotée quarante-neuf à la craie et dont le couvercle était enlevé. L'assistant se dirigea vers un tas de copeaux qu'il versa généreusement dans le cercueil jusqu'à ce qu'il y en ait environ six pouces (15 cm) d'épaisseur, et Molygruber y fut descendu.
— Je pense, dit la fille, qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Je l'ai bien attaché et tamponné de partout. Mais il est peut-être plus prudent de mettre de la sciure dessus plutôt que des copeaux. Personne ne le saura.
Sitôt dit, sitôt fait. Ils recouvrirent entièrement le corps avec de la sciure. Puis, ensemble, ils soulevèrent le couvercle et le rabattirent avec bruit. L'homme serra les vis à l'aide d'un instrument pneumatique à mesure que la fille les introduisait dans les trous. Prenant un chiffon mouillé, elle effaça le numéro écrit à la craie. Le cercueil fut hissé sur un chariot, et recouvert d'un drap pourpre ; le tout fut roulé de l'atelier à la salle d'exposition.
Il y eut un bruit de voix, et le patron vêtu maintenant comme un parfait Directeur de Funérailles — jaquette noire, haut-de-forme, pantalon rayé — entra en scène.
— Sortez-le de là, avancez-le, voulez-vous. Le corbillard est là-bas, les portes sont ouvertes et tout le monde attend. Allons !
Gertie et l'assistant firent avancer le cercueil et le poussèrent le long d'une rampe où il y avait un dispositif de chargement spécial composé d'une quantité de rouleaux dans une structure s'étendant directement de la rampe à l'arrière du corbillard. Le cercueil y entra directement. Le chauffeur se leva de son siège en disant :
— O.K., c'est bon ? Parfait, on y va !
Le Directeur prit place à côté de lui, les portes du garage furent remontées lentement et le corbillard en sortit.
Une seule voiture attendait dehors, une voiture où avaient pris place les quatre camarades de Molygruber. Ils étaient vêtus de leurs habits du dimanche, tirés probablement du mont-de-piété (organisme de prêt sur gage à taux d'intérêt faible ou nul — NdT) pour la circonstance. Outre l'argent qu'ils retiraient en les y laissant, il y avait un autre avantage à l'affaire : le mont-de-piété nettoyait toujours les vêtements avant de les mettre ‘en garde’.
Le pauvre Molygruber avait l'impression d'être attaché à son corps par des cordes invisibles. Tandis que l'on déplaçait le cercueil, le pauvre, dans sa forme astrale, était traîné sans pouvoir dire son mot sur la question. Au lieu de cela, il était maintenu à environ dix pieds (3 m) au-dessus du corps, se voyant avancer invisiblement à travers murs, planchers et plafonds. Il se retrouva finalement dans le corbillard qui, à son tour, sortit à l'extérieur. Le Directeur de Funérailles se pencha hors de la voiture et dit aux quatre hommes :
— O.K. ? Alors, partons.
Le corbillard sortit du parking des Pompes Funèbres, et les quatre hommes suivirent le cortège dans leur voiture. Les phares étaient allumés pour montrer qu'il s'agissait de funérailles, et sur le côté de la voiture qui suivait était fixé un petit drapeau triangulaire portant l'inscription ‘Funérailles’. Ce qui signifiait qu'ils pouvaient traverser aux feux rouges sans que la police trouve à y redire. Ils allèrent au long des rues et attaquèrent la longue montée conduisant au cimetière. Là, le Directeur de Funérailles s'arrêta, sortit du corbillard et vint dire à la voiture qui suivait :
— Restez bien derrière nous, parce qu'au prochain croisement il y a toujours quelqu'un qui cherche à couper. Et vous pourriez vous perdre. On prend la troisième à droite, et première à gauche. Compris ?
Le conducteur fit signe que oui et le Directeur rejoignit le corbillard. Ils repartirent, la voiture lui collant réellement au train.
Ils ne tardèrent pas à atteindre les grilles du cimetière. Le corbillard et la voiture avancèrent le long d'une avenue. Au sommet, et sur la droite, il y avait une tombe fraîchement creusée recouverte d'un cadre muni de poulies. Le corbillard avança, tourna, puis recula. Deux hommes qui attendaient près de la tombe s'approchèrent du corbillard. Le Directeur de Funérailles et le chauffeur en sortirent, et à eux quatre retirèrent le cercueil. Les quatre camarades suivirent.
— Cet homme étant un athée, dit le Directeur de Funérailles, il n'y aura donc pas de service — ce qui vous évitera une dépense ; nous allons juste le descendre et le recouvrir.
Les hommes répondirent par un petit signe de la tête ; le cercueil fut placé sur des rouleaux et des courroies spéciales furent passées en dessous, puis on le descendit lentement en terre. Les quatre hommes se penchèrent ensemble sur la fosse ouverte, baissèrent les yeux, l'air très ému, très triste.
— Pauvre vieux Molygruber, personne en ce monde pour te regretter, dit l'un.
— J'espère que là où il va, il y aura quelqu'un, ajouta un autre.
Sur ces mots, ils rejoignirent leur voiture, reculèrent, tournèrent, et sortirent lentement du cimetière.
Les deux hommes à côté du Directeur de Funérailles renversèrent un chargement de terre qui tomba sur le cercueil avec un bruit sourd et pénible.
— Bon ! recouvrez-le, c'est fini, dit le Directeur. Et il se dirigea vers le corbillard. Le chauffeur regagna son siège et ils partirent.
Molygruber planait au-dessus de la scène, impuissant, incapable de bouger, et en regardant vers le bas, il pensa "Ainsi c'est la fin de la vie, hé ? Quoi, maintenant ? Où vais-je d'ici ? J'ai toujours cru qu'il n'y avait rien après la mort ; mais je suis mort, et il y a là mon corps, et je suis ici. Alors que suis-je et où suis-je ?" À ce moment, il y eut un puissant son vibrant, comme le son semblable à celui du vent jouant sur les lignes téléphoniques sur une haute colline et Molygruber se trouva projeté à toute vitesse dans le néant. Devant lui il n'y avait rien, derrière il n'y avait rien, et rien non plus sur les côtés.
Silence ! Rien que le silence. Pas un seul son. Il écouta très, très attentivement, mais pas le moindre battement de cœur, pas la moindre respiration. Il retenait son souffle — ou du moins il le croyait — et il se rendit compte avec un choc que son cœur ne battait pas et que ses poumons ne fonctionnaient pas non plus. Par la force de l'habitude, il étendit ses mains pour sentir sa poitrine. Il avait eu la distincte impression de tendre les mains, l'impression très nette que tout fonctionnait, mais il n'y avait rien là — rien.
Le silence se faisait oppressant. Il se déplaça avec difficulté, mais se déplaçait-il ? Il n'était plus sûr de rien. Il essaya de bouger une jambe, un doigt de pied ; mais non — rien. Aucune sensation, aucune sensation de mouvement, pas la moindre sensation que quelque chose ÉTAIT. Il reposait sur le dos — ou pensa qu'il reposait ainsi — et essaya de se calmer, essaya de réfléchir, mais comment le faire dans un brouillard de néant quand vous avez l'impression que vous n'êtes rien, que vous n'existez même pas ? Mais il devait bien exister, se dit-il, parce que s'il n'avait pas existé — eh bien — il n'aurait pas pu penser. Il songea au cercueil descendu dans la terre desséchée par des jours et des jours sans pluie, sans même un nuage dans le ciel. Il pensa.
Il y eut soudain une sensation de mouvement. Il regarda, il aurait dit, ‘de côté’, avec étonnement et vit qu'il était au-dessus de sa tombe ; mais comment ceci pouvait-il être quand, une seconde plus tôt — une seconde ? — qu'était le temps, comment mesurer le temps ici ? Par habitude, il essaya de regarder son poignet ; mais non, il n'y avait pas de montre là. Il n'y avait pas de bras, non plus. Il n'y avait que le néant. Regardant vers le bas, tout ce qu'il vit c'était la tombe. Avec étonnement et un certain effroi il découvrit que, sur elle, l'herbe était haute. Combien de temps l'herbe met-elle pour pousser ? Tout prouvait qu'il devait être enterré depuis plus d'un mois. L'herbe n'aurait pas poussé si vite, n'aurait pas pu pousser autant en moins d'un mois ou de six semaines. Puis il s'aperçut que sa vision glissait, glissait sous l'herbe, sous la terre, et il vit les vers s'agitant et creusant, il vit des quantités de petits insectes. Et sa vue pénétrant plus loin encore, il vit le bois du cercueil, puis sous le couvercle il découvrit l'horrible spectacle de la décomposition. Il recula instantanément et bondit avec un hurlement insonore de terreur — ou du moins en eut la sensation. Il se retrouva tressaillant, absolument tremblant de tous ses membres, mais se souvint alors qu'il n'avait pas de membres, il n'avait même pas de corps, pour autant qu'il pouvait en juger. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait toujours rien à voir, ni lumière, ni obscurité, seulement le vide, le vide absolu dans lequel même la lumière ne pouvait exister. C'était une sensation terrible, choquante. Mais alors, comment pouvait-il éprouver une sensation s'il n'avait pas de corps ? Il était étendu là, ou plutôt, il existait là, essayant de comprendre.
Une pensée rampa soudain le long de sa conscience. ‘Je Crois’, vint la pensée. ‘Rampa’, vint la pensée. De quoi parlaient donc ces gars la dernière fois qu'il les avait vus au Dépôt d'Assainissement ? Il y avait plusieurs balayeurs de rues et des conducteurs de camions d'ordures, aussi ; ils parlaient de la vie, de la mort, et de tout ce qui s'ensuit, une conversation que Molygruber avait déclenchée en montrant un livre de Lobsang Rampa.
L'un d'eux avait dit :
— Ma foi, je ne sais pas que croire, j'ai jamais su. Ma religion ne m'aide pas, ne me donne aucune réponse, me dit seulement que je dois avoir la foi. Comment avoir la foi quand on n'a aucune preuve de rien ? Est-ce qu'il y a un de vous, les gars, qui ait jamais eu de réponse à une prière ? avait encore demandé l'homme.
Il avait regardé et vu le hochement de tête négatif de ses collègues.
— Non, avait dit l'un. Jamais connu personne qui ait eu une prière exaucée. Quand j'étais petit on m'a enseigné la Bible, et ce qui m'avait frappé alors, c'est que tous ces Anciens — grands prophètes, saints et je ne sais quoi — priaient comme des fous sans jamais recevoir aucune réponse, sans que rien de bon n'en soit jamais sorti. Un jour j'ai lu l'histoire de la Crucifixion. Il était dit dans le Livre Saint que le Christ avait crié ces mots : "Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?" Mais Il n'a pas reçu de réponse.
Il y avait eu un lourd silence parmi les hommes qui baissaient les yeux en jouant des pieds, mal à l'aise, et bien que peu habitués à penser, ils avaient essayé de réfléchir au futur. Qu'y avait-il après la mort ? Rien ? Les corps retournaient-ils simplement à la terre pour s'y putréfier et tomber en poussière ? Il devait y avoir quelque chose de plus que ça, pensèrent-ils. Il devait y avoir un sens défini à la vie, et un sens défini à la mort. Certains d'entre eux avaient regardé leurs camarades d'un air quelque peu coupable, car ils avaient en mémoire d'étranges circonstances, des événements particuliers qui ne pouvaient recevoir d'explications conscientes.
L'un avait dit :
— Cet auteur dont vous nous avez parlé et qui vit dans le bas de la ville, eh bien, ma bourgeoise a lu tous ses livres et elle ne cesse de me sermonner. Elle me dit : "Jake, Jake, si tu ne crois en rien, tu n'as rien à quoi te raccrocher quand tu es mort." Elle me répète : "Si tu crois qu'il y a une vie après la mort, alors tu auras une vie après la mort, c'est aussi simple que ça : tu dois croire qu'il y a une vie après la mort, autrement tu flotteras comme une bulle dans le vent, allant simplement à la dérive, presque sans existence. Tu dois croire, garder l'esprit ouvert, et ainsi tu as quelque chose pour stimuler ton intérêt quand tu quittes ce monde."
Il y avait eu un long silence après cette déclaration. Les hommes avaient eu l'air embarrassé et remuèrent, mal à l'aise, se demandant comment ils pourraient bien se retirer sans avoir l'air de se sauver. Molygruber pensait à tout cela tandis qu'il était là, étendu, ou debout, ou assis — il ne savait pas au juste — très haut dans le néant, n'étant qu'une pensée désincarnée, autant qu'il pouvait l'imaginer. Mais alors, cet auteur avait peut-être raison. Les gens l'avaient peut-être persécuté, avaient cherché à le détruire par une publicité infâme — parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils se trompaient. Qu'enseignait-il donc ? Molygruber faisait de terribles efforts pour se remémorer cette pensée fugace qui n'avait touché sa conscience que très superficiellement. Elle lui revint alors. "Vous devez croire en QUELQUE CHOSE. Si vous êtes Catholique, vous croyez à un paradis peuplé d'anges et de saints. Si vous êtes Juif, votre concept de ce qui suit la vie sur Terre est d'une forme différente. Et si vous êtes un disciple de l'Islam, votre paradis prend encore une autre forme. Mais ce qui importe c'est de croire en quelque chose, de garder un esprit ouvert qui vous permet, même si présentement vous ne croyez pas, de pouvoir être convaincu. Sinon vous flotterez oisivement entre les mondes, entre les plans, telle une pensée à la dérive, et aussi ténu qu'elle."
Molygruber pensa et repensa à la question. Il réfléchit avec quelle obstination il avait, durant toute sa vie, refusé l'existence d'un Dieu, refusé l'existence d'une religion, pensant que tous les prêtres n'étaient que des grigous avides de l'argent du public qu'ils endormaient avec des contes de fées. Il réfléchit à tout cela. Il essaya d'imaginer le vieil auteur qu'il avait vu de près une fois. Il se concentra sur l'expression du visage de cet homme, et, à sa grande terreur, il lui sembla que ce visage était devant lui, qu'il lui parlait et disait : "Vous devez croire. Croire en QUELQUE CHOSE, si vous ne voulez pas n'être qu'une ombre à la dérive sans pouvoir, sans motivation, et sans ancrage. Vous devez croire, vous devez garder votre esprit ouvert, vous devez être prêt à recevoir de l'aide afin d'être arraché au vide, au néant stérile, et transporté sur un autre plan d'existence."
À nouveau, Molygruber songea : "Je me demande qui se sert de ma brouette à présent ?" Et comme dans un éclair, il revit les rues de Calgary et sa brouette poussée au long des rues par un jeune balayeur qui s'arrêtait de temps à autre pour fumer une cigarette. Puis il aperçut le vieil auteur et trembla de frayeur en le voyant qui levait les yeux avec une sorte de demi-sourire ; ses lèvres alors formèrent des mots : "Croyez en quelque chose, croyez, ouvrez votre esprit ; il y a des gens prêts à vous aider."
Molygruber regarda à nouveau la rue et éprouva une poussée de fureur contre l'homme qui se servait de sa vieille brouette. C'était maintenant un instrument dont les charnières des couvercles et les poignées étaient horriblement malpropres. Le balai, lui aussi, était usé, mais même pas usé d'une manière régulière — d'un côté seulement — ce qui révélait que l'homme ne mettait pas la moindre fierté dans son travail. Il sentit une montée de colère, et avec elle une terrible vitesse — une vitesse effrayante, à paralyser l'esprit. Et pourtant tout était si étrange ; comment pouvait-il sentir la vitesse quand il n'y avait aucune sensation de mouvement ? Comment pouvait-il y avoir vitesse sans le vent sur son visage ? Il trembla alors de terreur. Avait-il un visage ? Était-il en un lieu où le vent existait ? Il ne savait pas.
Molygruber simplement ÉTAIT. Il n'y avait aucune notion de temps, à peine un sentiment d'exister. Il ÉTAIT, tout simplement. Son esprit tournait, au grand ralenti — seulement de vagues pensées glissant sur l'écran de sa vision mentale. Puis, de nouveau, il se représenta le vieil auteur et entendit presque les mots qui n'avaient pas été formulés : "Vous devez croire en quelque chose." Sur ce, Molygruber eut une vision de son enfance, des pauvres, pauvres conditions dans lesquelles il avait vécu. Il se rappela une image et une phrase lue dans la Bible : ‘Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me guide...’ Il me guide. La pensée revenait comme un refrain dans son esprit ou dans sa conscience — ou dans ce qui lui en tenait lieu maintenant — et il pensa : "J'aimerais qu'Il me guide ! Je voudrais que quelqu'un me guide !" Et à cette pensée, il sentit ‘quelque chose’ ; il n'aurait pu dire ce que c'était, mais il avait la sensation que des gens étaient près de lui. C'était comme lorsqu'il avait dormi à l'asile de nuit ; dès qu'une personne entrait dans cette grande pièce, il sentait sa présence, non pas au point de se réveiller, mais au point de devenir vigilant au cas où l'intrus essayerait de voler la montre sous son oreiller ou le mince portefeuille qu'il avait niché dans le bas du dos.
Il formula une pensée : "Aidez-moi, aidez-moi", et il lui sembla sentir qu'il avait des pieds. C'était comme une sensation aux extrémités, une sensation étrange et — oui — il avait des pieds, des pieds nus, et avec un affreux sentiment de terreur, il découvrit que ses pieds étaient sur quelque chose de collant, du goudron peut-être, pensa-t-il. Il se rappelait le jour, où, enfant, il était sorti de la maison pieds nus en courant et avait marché tout droit là où les ouvriers de la Ville goudronnaient la grand-route. Et il retrouvait ce qu'avait été sa terreur — il était très jeune — à la pensée qu'il était prisonnier de la route et n'en sortirait jamais. C'est ce qu'il éprouvait en cet instant — il était pris, pris dans le goudron. Et alors, il pensa que le goudron montait le long de son corps — car il pouvait sentir son corps maintenant ; il avait des bras, des mains, des doigts, mais était incapable de les remuer, pris qu'ils étaient dans le goudron, ou si ce n'était pas du goudron, c'était une matière collante qui empêchait le mouvement ; et autour de lui il y avait des gens et ces gens l'observaient. Il l'aurait juré. La fureur le prit, une fureur presque meurtrière et il émit la pensée : "O.K., vous, les gars, pourquoi me regardez-vous ainsi bouche bée ? Pourquoi ne venez-vous pas me donner un coup de main ? Ne voyez-vous pas que je suis coincé ?" La pensée revint à lui claire et forte, presque comme ces choses qu'il avait vues sur les écrans de télévision, dans les vitrines des marchands. "Vous devez croire, vous devez croire, vous devez ouvrir votre esprit avant que nous puissions vous aider ; pour l'instant vous nous repoussez avec chaque pensée. Croyez ! Nous sommes prêts à vous aider, croyez !"
Il grogna et essaya de courir après les gens qui le dévisageaient, car il était sûr qu'ils le dévisageaient, mais il se rendit compte que ses mouvements n'étaient qu'une vaine agitation. Il était englué dans le goudron et ses mouvements, presque imperceptibles. Il pensa soudain : "Oh ! mon Dieu, que s'est-il passé ?" Et avec la pensée de : ‘Oh ! mon Dieu’, il aperçut une lueur dans l'obscurité, comme la lumière du soleil au-dessus de l'horizon, à la naissance du jour. Il regarda, stupéfait, et de nouveau murmura, juste pour voir :
— Dieu, Dieu, aidez-moi !
À sa grande surprise, et à sa grande joie, la lumière brilla et il crut voir une ‘silhouette’ se découpant sur l'horizon et lui faisant signe d'approcher. Mais non, Molygruber n'était pas encore prêt ; il se contenta de marmonner pour lui-même :
— Un nuage bizarre, je suppose ; ce doit être ça. Personne ne veut m'aider.
Ainsi la lumière s'assombrit, la luminosité sur la ligne d'horizon s'évanouit, et Molygruber s'enfonça encore plus profondément dans le goudron, ou quelle qu'ait pu en être la substance. Le temps passa, une éternité de temps ; il n'y avait aucune indication du passage du temps, mais l'entité qui avait été Molygruber demeurait simplement ‘quelque part’ plongée dans l'obscurité de l'incroyance et, autour de lui, se trouvaient ceux qui l'aideraient s'il ouvrait simplement son esprit à la croyance, leur permettant ainsi d'accomplir leur tâche et de le guider vers la lumière — vers quelle que soit la forme de vie ou d'existence qui s'y trouvait.
Il était dans un état de grande agitation, rendue pire encore par le fait qu'il ne pouvait sentir ni ses bras, ni ses jambes, ni rien d'autre, et c'était — eh bien, inquiétant, pour le moins. Pour une quelconque raison il ne parvenait pas à chasser de son esprit ce vieil auteur, qui semblait constamment là à l'aiguillonner. Quelque chose bouillonnait sous sa conscience. Enfin il trouva ce qu'il cherchait.
Il avait vu, quelques mois auparavant, le vieil auteur, dans son fauteuil roulant électrique, faisant son petit tour dans le parc nouvellement achevé, en compagnie d'un homme. Molygruber, comme c'était son habitude, s'était arrêté pour écouter leur conversation. L'auteur disait :
— Vous savez, la Bible chrétienne a beaucoup éclairé le problème de la vie après la mort, et ce qui me paraît toujours le plus remarquable c'est que les Chrétiens — les Catholiques en particulier — croient aux saints, aux anges, aux démons et tout le reste, et cependant pour une raison extraordinaire, ils semblent toujours douter de la vie après la mort. Alors comment vont-ils expliquer l'Ecclésiaste (XII, 5-7) qui dit, en fait : "Ainsi chacun s'en va vers sa dernière demeure. Et dans la rue, les pleureurs rôdent en attendant. Alors le fil d'argent de la vie se détache, le vase d'or se brise, la cruche à la fontaine se casse, la poulie tombe au fond du puits. Le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré, et le souffle de vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné." Eh bien, avait poursuivi l'auteur, vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Cela veut dire que le corps d'une personne est composé de deux parties ; l'une retourne à la poussière dont elle est censée être faite, et l'autre retourne à Dieu ou à la vie au-delà de celle-ci. Or, il s'agit de la Bible chrétienne ; elle reconnaît la vie après la mort, ce qui n'est apparemment pas le cas des Chrétiens. Toutefois, il existe nombre de choses en lesquelles les Chrétiens ne croient pas. Ils les découvriront, cependant, quand ils seront de l'Autre Côté !
Molygruber sursauta, ou plutôt eut l'impression de sursauter. Comment peut-on sursauter quand on n'a pas de corps ? Ces mots semblaient avoir été prononcés juste derrière lui. Il parvint à tourner autour de sa conscience, mais il n'y avait rien derrière lui ; il médita donc pendant quelque temps sur le problème, pensant que peut-être il s'était égaré, ayant permis à la première partie de sa vie de déformer sa pensée. Peut-être y avait-il quelque chose après la vie sur Terre. Il doit y avoir quelque chose, conclut-il, car il avait vu mourir son corps, l'avait vu mort et — il aurait frissonné et aurait eu un malaise si la chose avait été possible — l'avait vu pourrir tandis que les os apparaissaient à travers la chair en décomposition.
— Oui, se dit-il à lui-même, si l'on peut marmonner sans voix, c'est qu'il doit y avoir quelque chose après la mort. Il avait dû être induit en erreur durant toutes ces années. Peut-être l'amertume qu'avait engendrée la dureté de sa vie avait-elle faussé son esprit ? Oui, il devait y avoir une sorte de vie, parce qu'il était toujours vivant, ou était supposé l'être, et, s'il ne l'était pas, comment alors pensait-il à ces choses ? Oui, il devait posséder une forme de vie.
Comme cette pensée lui venait, il sentit qu'une chose très particulière était en train de se produire ; il lui semblait éprouver des fourmillements partout, des fourmillements sur ce qui aurait été le contour d'un corps. Il avait des bras, des mains, des jambes et des pieds, et en se tournant légèrement il était à même de les sentir. Et alors — oh ! gloire à Dieu — la lumière augmenta. Dans le néant, dans le vide absolu où il avait été plongé, la lumière pénétrait lentement ; elle était d'une couleur rosée et très faible, mais allait en grandissant. Et alors, avec une soudaineté qui faillit le rendre malade, il se renversa et sembla tomber — tomber sur ses pieds. Après un court moment il atterrit sur quelque chose de collant, quelque chose de gluant, et il était entouré d'un brouillard noir entrecoupé de rais d'une lumière rosâtre. Il essaya de bouger, mais si tout mouvement n'était pas absolument impossible, il était cependant difficile — difficile. Il avait le sentiment d'être dans quelque matière visqueuse qui l'entravait, le faisait bouger au ralenti, et il pataugeait, soulevant d'abord un pied, puis l'autre. Il se compara à l'un de ces monstres bizarres illustrant la couverture de livres de science-fiction tape-à-l'œil.
Il cria à haute voix :
— Oh ! Dieu, s'il y a un Dieu, aidez-moi !
À peine avait-il prononcé ces mots qu'il sentit un changement s'opérer dans sa situation. La matière collante disparut, le brouillard se fit moins épais, et il put distinguer de vagues formes qui bougeaient autour de lui. Étrange, étrange situation, en vérité. C'était comme d'être enfermé dans un sac de plastique couleur de fumée. Il essayait de voir au travers et n'arrivait à rien.
Il se tenait là, mettant la main au-dessus de ses yeux, s'efforçant de voir ce qui pouvait y avoir là. Il eut l'impression, plus que la vision, de gens qui tendaient les mains vers lui, mais ne pouvaient l'atteindre. Ils en étaient empêchés comme par une barrière, par quelque mur transparent et invisible.
Oh ! Dieu ! pensa-t-il, si seulement cette déplaisante couleur pouvait disparaître, si je pouvais abattre ce mur, ce papier, ce plastique ou ce je ne sais quoi. Impossible de voir qui sont ces gens. Ils peuvent vouloir m'aider, ils peuvent vouloir me tuer ; mais comment pourraient-ils me tuer puisque je suis déjà mort. Suis-je mort ? Il frissonna et frissonna encore à l'idée qui frappa soudain son esprit : "Suis-je dans un hôpital ? Ai-je des cauchemars après avoir vu ce prêtre ? Peut-être suis-je à nouveau en vie et sur Terre. Tout ceci n'est-il qu'un horrible cauchemar ? Si seulement je savais !"
Faiblement, très faiblement, comme si elle venait de très loin, une voix lui parlait. Elle était si voilée qu'il dut faire un immense effort pour capter ce qui était dit :
— Croyez ! Croyez ! Croyez en une vie à venir. Nous ne pouvons vous délivrer que si vous croyez. Priez Dieu. Il y a un Dieu. Peu importe le nom que vous Lui donnez. Peu importe la forme de religion. Toute religion a un Dieu. Croyez. Appelez à l'aide votre propre Dieu. Nous attendons, attendons.
Molygruber demeura immobile. Il ne se débattait plus ; ses pieds ne s'agitaient plus pour essayer de traverser le voile qui l'entourait. Il restait calme. Il pensa au vieil auteur, il pensa aux prêtres et les rejeta comme n'étant que des farceurs à la recherche d'un moyen de gagner leur vie facilement en exploitant la crédulité d'autrui. Puis il retourna à ses premières années, pensa à la Bible et ensuite pria Dieu de l'éclairer.
— Oh ! Dieu tout-puissant ! Quelle que soit la forme que vous adoptez, aidez-moi. Je suis coincé. Je suis perdu. J'ai mon être, mais je n'ai pas d'existence. Aidez-moi et permettez que les autres m'aident !"
Ayant dit ces mots avec un cœur plein de foi, il éprouva soudain un choc, comme s'il avait touché deux fils électriques, à nu. Pendant un moment, il tourbillonna tandis que le voile se déchirait.
Chapitre Cinq
Le voile d'obscurité qui entourait Molygruber se déchira devant lui et il fut ébloui par la lumière. Il protégea désespérément ses yeux derrière ses deux mains que, Dieu merci, il avait retrouvées. La lumière était d'une force aveuglante ; jamais encore il n'avait vu lumière aussi puissante, pensa-t-il. Il se prit à retourner à ses jours passés en tant que ramasseur d'ordures, et il songea au grand bâtiment métallique qu'il avait vu construire et à l'équipement de soudure. Il se rappela la violente lumière que produit la soudure, une lumière si insoutenable pour les yeux que les ouvriers sont contraints de porter des verres noirs. Molygruber ferma ses paupières, pressa ses mains sur ses yeux, mais la lumière cependant demeurait encore très forte. Puis, parvenant à se contrôler il souleva prudemment ses paupières. C'était, sans aucun doute, éblouissant ; entrouvrant les yeux, il regarda.
Dieu ! Quelle scène merveilleuse il vit ! La noirceur avait disparu, s'était évanouie — et pour toujours, espérait-il — et il se tenait près d'un groupe d'arbres. Regardant vers le sol, il vit une herbe verte et luxuriante, une herbe encore jamais vue auparavant. Et sur cette herbe il remarqua qu'il y avait de petites choses blanches avec un centre jaune. Il se creusait la cervelle pour identifier ces petits objets blancs. Puis il trouva... c'étaient des pâquerettes, bien sûr, des pâquerettes des champs. Il les voyait, en réalité, pour la première fois ; jusqu'ici il ne les avait vues qu'en image, et parfois sur les écrans de télévision qu'il regardait dans les vitrines des magasins. Mais il y avait bien d'autres choses à voir à côté des pâquerettes. Il leva les yeux et regarda à droite et à gauche. Deux personnes se tenaient à ses côtés et elles lui souriaient, lui souriaient en se penchant car Molygruber était petit, insignifiant, ratatiné, avec des mains noueuses et des traits tannés par les intempéries. Il leva les yeux vers ces deux personnages : il ne les avait jamais vus, mais ils lui souriaient avec une réelle gentillesse.
— Eh bien, Molygruber, dit l'un, que pensez-vous de l'endroit, ici ?
Molygruber resta muet. Comment pouvait-il savoir ce qu'il éprouvait, et ce qu'il pensait de ce lieu qu'il avait à peine eu le temps de voir. Baissant les yeux, il fut heureux de constater qu'il avait des pieds. Puis il laissa son regard voyager le long de son corps. À cet instant, il fit un bond et rougit des pieds à la tête. "Dieu ! me voilà devant ces gens avec rien pour couvrir ma nudité !" Ses mains, tout de suite, esquissèrent le geste, vieux comme le monde, des gens surpris sans pantalon. Les deux hommes qui l'entouraient éclatèrent de rire et l'un dit :
— Molygruber, qu'y a-t-il qui ne va pas, mon vieux ? Vous n'êtes pas né avec des vêtements, pas vrai ? Si oui, vous seriez bien le seul à qui une telle chose serait arrivée. Si vous désirez être vêtu, réfléchissez à ce que vous aimeriez porter !
Molygruber était si paniqué que, pendant un moment, il fut incapable de se représenter un vêtement ; il était dans un tel état de confusion. Puis il pensa à porter ce qu'on appelait un ‘bleu de travail’, une sorte de combinaison qui partait des chevilles et montait jusqu'au cou, avec des manches, et que l'on enfilait par une ouverture sur le devant. À peine sa pensée se fut-elle portée sur ce vêtement, qu'il s'en trouva revêtu. Il se regarda et frissonna de nouveau ; c'était une combinaison d'un rouge vif, la couleur d'un parfait rougissement. Les deux hommes ne purent s'empêcher de rire à nouveau ; une femme qui passait non loin de là se tourna vers eux en souriant et dit en s'avançant :
— Qu'est-ce donc, Boris ! Encore un nouveau effrayé de sa propre peau ?
Celui qu'elle avait appelé Boris répliqua en riant :
— Oui, Maisie. Ça se passe tous les jours ici, n'est-ce pas ?
Molygruber regarda la femme et pensa : "J'espère que je suis en sûreté avec celle-ci ; je ne connais rien aux femmes !" Tous laissèrent échapper un rire sonore. Pauvre Molygruber, il ne se rendait pas compte que, sur ce plan particulier d'existence, chacun était télépathe !
— Regardez autour de vous, Molygruber, dit la femme. Ensuite nous vous emmènerons et vous expliquerons où vous êtes, et tout le reste. Vous nous avez donné pas mal de fil à retordre ; vous vous refusiez à sortir de votre nuage noir — en dépit de tout ce que nous vous disions.
Molygruber murmura quelque chose pour lui-même, et c'était un murmure si confus qu'il fut à peine perçu, même par télépathie. Mais il regarda autour de lui. Il était dans une sorte de parc ; il n'avait jamais imaginé qu'un tel parc put exister ; l'herbe y était plus verte que n'importe quelle herbe qu'il ait vue auparavant ; quant aux fleurs, innombrables, leurs couleurs étaient infiniment plus vives que celles des fleurs habituelles. Le soleil brillait ; il faisait agréablement chaud ; il y avait le bourdonnement des insectes et le murmure des oiseaux. Molygruber leva les yeux ; le ciel était bleu, d'un bleu intense avec des nuages blancs qui ressemblaient à des flocons. Puis Molygruber faillit tomber d'étonnement et sentit ses jambes faiblir :
— Où est donc le soleil ? dit-il.
L'un des hommes lui répondit en souriant
— Vous n'êtes pas sur la Terre, vous savez, Molygruber. Vous en êtes loin, très loin ; vous êtes en un temps et un plan d'existence tout à fait différents. Vous avez une masse de choses à apprendre, mon ami !
— Je veux bien être damné, dit Molygruber, si je comprends comment vous pouvez avoir la lumière du soleil, quand il n'y a pas de soleil !
Ses compagnons — deux hommes et une femme — se contentèrent de lui sourire, et la femme le prit gentiment par le bras en lui disant :
— Venez, nous vous emmènerons à l'intérieur et vous expliquerons beaucoup de choses.
Ensemble, tous les quatre traversèrent la belle herbe verte et gagnèrent une allée merveilleusement pavée.
— Eh ! cria Molygruber, ce sentier me fait mal aux pieds. Je n'ai pas mes souliers !
Ce qui déclencha un nouvel éclat de gaieté. Et Boris de dire à Molygruber :
— Eh bien, pourquoi ne pas réfléchir à la paire de chaussures ou de bottes que vous souhaiteriez porter ? L'opération vous a réussi pour ce qui est du vêtement, bien que la couleur, je dois l'avouer, ne soit pas une réussite. Vous devriez en changer.
Molygruber réfléchit et pensa au spectacle qu'il avait dû donner vêtu de cette combinaison rouge, et sans chaussures. Il souhaita être débarrassé de ce ridicule vêtement et le fut aussitôt.
— Oh ! s'écria-t-il, et maintenant me voilà nu devant une femelle. Oh ! je suis triste. Je n'ai encore jamais été nu devant une femelle. Que va-t-elle penser de moi ?
La femme explosa littéralement de rire, et les gens qui cheminaient sur le sentier se retournèrent, amusés, pour voir ce qui se passait.
— Allons, allons, dit la femme à Molygruber, tout est très bien, ne vous inquiétez pas. Après tout, vous n'avez pas beaucoup à montrer, vous ne pensez pas ? Mais, de toute façon, imaginez-vous seulement dans vos beaux habits du dimanche, chaussé de souliers bien cirés, et si vous y pensez, vous vous retrouverez vêtu ainsi.
Ce qui se produisit.
Molygruber marchait avec précaution et rougissait chaque fois qu'il regardait la femme. Il avait atrocement chaud sous son col et se sentait mal à l'aise, car sur la Terre le pauvre vieux Molygruber faisait partie de ces malheureux qui aiment à regarder et non à agir, et c'est encore pire quand vous n'avez nulle part où aller pour regarder et que vous n'avez personne avec qui faire la chose ! Si incroyable que cela puisse paraître à notre époque, la connaissance qu'avait Molygruber du sexe opposé se limitait à ce qu'il voyait dans les magazines et sur les affiches suggestives que les cinémas mettaient à leur porte dans le but d'exciter l'appétit des passants.
Il repensa à son passé, repensa à quel point il connaissait peu les femmes. Il se souvint qu'il avait pensé qu'elles étaient faites d'un seul bloc à partir du cou jusqu'aux genoux, et il ne s'était jamais demandé comment elles pouvaient marcher dans de telles conditions. Mais alors il avait vu des jeunes filles se baignant dans la rivière, et il s'était rendu compte qu'elles avaient des jambes, des bras, etc., tout comme il en avait. Il fut arraché à ses pensées par de bruyants éclats de rire et découvrit qu'il avait autour de lui une foule de gens qui avaient suivi sa pensée vu que — dans ce monde où il était — pensée et parole étaient très semblables. Il rougit et prit littéralement ses jambes à son cou. Ses trois compagnons partirent à sa suite en courant, s'essoufflant pour essayer de le rejoindre, mais ils en étaient empêchés par de fréquents accès d'hilarité. Molygruber courait ; puis, épuisé, il s'écroula sur un banc du parc. Ses poursuivants, quand ils le rejoignirent, ne parvenaient pas à s'arrêter de rire.
— Molygruber, Molygruber, vous feriez mieux de ne pas penser jusqu'à ce que nous soyons à l'intérieur, lui dit-on en désignant une merveilleuse construction juste sur la droite. Contentez-vous pour l'instant de concentrer votre esprit sur l'idée de garder vos vêtements jusqu'à ce que nous soyons entrés. Là, nous vous expliquerons tout.
Ils se levèrent, et se plaçant de chaque côté de Molygruber, les deux hommes le prirent par le bras et tous trois se dirigèrent vers le bâtiment. Ils pénétrèrent dans une très élégante entrée en marbre, où régnaient une fraîcheur agréable ainsi qu'une lumière douce qui donnait l'impression d'émaner des murs. Il y avait un bureau de réception très semblable à ceux qu'avait vus Molygruber en risquant un œil à travers les portes des hôtels. Un homme qui était là sourit plaisamment et demanda :
— Un nouveau ?
Maisie fit signe que oui de la tête en disant :
— Et un vrai novice aussi.
Ils traversèrent le hall, puis longèrent un corridor où se tenaient de nombreuses personnes. Molygruber se sentait toujours rougissant ; ces gens, hommes et femmes, portaient des vêtements divers, dont certains franchement exotiques, et d'autres ne portaient... rien du tout et n'en semblaient pas du tout gênés.
Quand Molygruber fut introduit dans une chambre très confortablement meublée, il était dans un tel état de sudation qu'il donnait l'impression de sortir d'une piscine — encore qu'il n'eût jamais pénétré dans aucune. Avec un soupir de soulagement, il se laissa tomber sur une chaise et commença à s'éponger le visage avec un mouchoir qu'il avait trouvé dans sa poche.
— Ouf ! répéta-t-il à deux reprises. Laissez-moi sortir de tout ceci, laissez-moi retourner sur Terre, je ne peux pas rester dans un endroit pareil !
— Mais, Molygruber, répondit Maisie en se moquant de lui gentiment, vous devez rester ici. Vous vous souvenez ? Vous êtes un athée ; vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas à la religion, vous ne croyez pas à la vie après la mort. Toutefois, vous êtes ici, ce qui prouve qu'il doit bien exister une sorte de vie après la mort, n'est-ce pas ?
La chambre où on l'avait amené avait de très grandes fenêtres. Il regardait, fasciné, la scène à l'extérieur : le parc splendide avec un lac en son milieu et une agréable rivière qui venait se jeter dans le lac. Il voyait des hommes, des femmes et quelques enfants. Tous donnaient l'impression de marcher comme s'ils savaient où ils allaient, et pourquoi ils y allaient. Soudain, un homme débouchant du sentier vint s'asseoir sur un banc du parc et Molygruber le regarda, pétrifié d'admiration, sortir de sa poche un paquet de sandwichs ! Molygruber ne pouvait détacher son regard de l'homme. Il le vit déchirer le papier qui enveloppait les sandwichs, le déposer avec soin dans un panier placé près du banc, et attaquer les sandwichs. Molygruber, en le regardant, se sentait faiblir et entendait son estomac formuler de vigoureuses protestations. Il leva les yeux vers Maisie et s'exclama :
— Fichtre ! J'ai faim. Quand est-ce qu'on mange par ici ?
Il chercha dans ses poches, se demandant s'il n'avait pas un peu de monnaie sur lui ; il mangerait bien un hamburger ou quelque chose du même genre. La femme posa sur lui un regard plein de compréhension et lui dit :
— Vous pouvez avoir ce que vous voulez comme nourriture ou boisson. Décidez simplement ce que vous désirez, mais n'oubliez pas qu'il vous faut d'abord penser à une table, sinon vous devrez manger par terre.
Se tournant vers lui, un des hommes parla :
— Nous vous laissons pour un moment, Molygruber. Vous sentez que vous voulez manger, eh bien, pensez à ce que vous aimeriez avoir comme nourriture mais, comme vous l'a dit Maisie, pensez d'abord à une table. Quand vous aurez obtenu cette nourriture dont vous n'avez d'ailleurs nul besoin, nous reviendrons vous trouver.
Sur ces mots, ils se dirigèrent vers le mur qui s'ouvrit pour les laisser passer, puis se referma derrière eux.
Toute cette histoire d'avoir à imaginer ce qu'il voulait manger pour l'obtenir, et aussi de n'avoir — comme on le lui avait dit — nullement besoin de manger, était pour Molygruber plus qu'incompréhensible. Le type n'avait-il pas déclaré qu'il n'avait nul besoin de nourriture ? Qu'entendait-il par là ? Toutefois il avait terriblement faim, faim au point de s'évanouir. Et cette sensation lui était familière ; il l'avait bien souvent éprouvée dans sa jeunesse. Et c'était parfaitement désagréable.
Il s'interrogea sur la façon dont il devait penser. Avant tout, la table. Il savait, bien sûr, ce qu'était une table ; n'importe quel idiot le savait. Mais quand vint le moment d'y PENSER, ce ne fut pas tellement facile. Sa première tentative lui parut ridicule à l'extrême. Il essaya de revoir les vitrines des magasins d'ameublement devant lesquelles il s'arrêtait parfois tandis qu'il balayait la rue ; sa pensée se fixa sur une jolie table ronde en métal avec un parasol au-dessus ; puis il se souvint que son attention avait été aussi attirée par une autre table décorée — une table à ouvrage pour dames. À son complet étonnement, il découvrit que la création qui se tenait devant lui était un mélange des deux — moitié métal, moitié table à ouvrage — et semblait très instable. Il la repoussa des mains en disant (tout comme il l'avait vu faire dans un film des années auparavant) :
— Pouah ! Va-t'en et vite !
Il se reprit à réfléchir et pensa à une table qu'il avait aperçue dans un parc où il avait l'habitude d'aller. Elle était faite de rondins et de planches. Il la revit avec autant de précision que possible afin de la demander. Immédiatement elle fut devant lui ! C'était un meuble très rustique, en bois presque brut, et il s'aperçut qu'il avait complètement oublié de penser à un siège ; il se dit qu'il pourrait utiliser la chaise qui était dans la chambre. Mais, à sa grande déception, il découvrit que celle-ci était beaucoup trop basse pour la table. Ayant finalement réglé tous ces détails, il se concentra sur la nourriture. Pauvre, Molygruber appartenait à la classe des déshérités, ayant toujours vécu au jour le jour et n'ayant qu'un peu de café pour accompagner un hamburger ou quelque nourriture du même genre. Il opta donc pour une assiette de hamburgers et quand ils se matérialisèrent devant lui, il mordit dedans à pleines dents. Mais c'était une duperie, car la chose n'avait rien à l'intérieur ! Après plusieurs essais et beaucoup d'erreurs, il comprit qu'il lui fallait penser clairement — et que s'il désirait un hamburger il devait imaginer ce qui serait à l'intérieur. Finalement, il l'obtint exactement comme il le voulait, mais en mordant dedans il décida qu'il n'avait pas grand goût, et quand il essaya le café qu'il avait souhaité, ce fut pire encore. Jamais il n'avait bu un café aussi affreux. Il en vint à la conclusion qu'il ne pouvait plus se fier à son imagination, mais continua à essayer de produire ceci puis cela, sans se risquer cependant au-delà d'un café, d'un hamburger et d'un morceau de pain ; mais n'ayant jamais de sa vie mangé du pain frais, c'était toujours quelque chose de rassis ou de moisi.
Pendant un moment, il y eut le bruit de la mastication de Molygruber dévorant ses hamburgers ; puis ayant avalé bruyamment son café, il repoussa simplement la table et se mit à réfléchir à toutes les choses particulières qui lui étaient arrivées. Il se rappela tout d'abord qu'il ne croyait pas à la vie après la mort. Alors où était-il donc, maintenant ? Il songea à son corps en décomposition, au fait de lui avoir jeté un coup d'œil involontairement, et il faillit vomir. Puis, il pensa à toutes ses étranges expériences : tout d'abord, il avait cru être pris dans un tonneau de goudron qui s'était ensuite évanoui pour faire place à une fumée noire lui rappelant la fois où, avant de sortir, il avait oublié de baisser la mèche de sa lampe à pétrole ; au retour, il s'était tout d'abord cru devenu aveugle, ne pouvant rien voir du tout à cause de toute la suie noire qui remplissait la pièce. Il se souvenait de ce que sa logeuse lui avait dit !
Soudain, il se retourna. Boris était debout à côté de lui et demandait :
— Vous avez eu un bon repas à ce que je vois, mais pourquoi vous en tenir à ces horribles hamburgers ? Vous savez que vous pouvez avoir tout ce que vous désirez, mais à la condition que vous y pensiez soigneusement, que vous réfléchissiez à tous les ingrédients, puis ensuite à la cuisson de la chose choisie.
Molygruber leva les yeux vers lui en disant :
— Où est-ce que je lave les assiettes ?
— Mon cher garçon, dit Boris sincèrement amusé, vous ne lavez pas les assiettes ici. Par la pensée vous les faites apparaître, puis disparaître. Tout ce que vous avez à faire quand votre repas est terminé, c'est de penser à la disparition des plats et au retour de leurs composants au réservoir de la Nature. C'est simple, vous vous y habituerez. Mais vous n'avez pas besoin de manger, vous savez ; vous obtenez dans l'atmosphère tout l'élément nourrissant qui vous est nécessaire.
Molygruber se sentait réellement aigri au sujet de toute cette affaire ; c'était tellement ridicule de dire que la nourriture provenait de l'atmosphère qui l'entourait, c'était trop absurde pour y croire. Pour qui ce Boris le prenait-il ? Il savait, lui, Molygruber, ce que c'était que d'être affamé, ce que c'était que de s'évanouir sur le trottoir par manque de nourriture, il savait ce que c'était que d'avoir un agent qui vous botte les côtes en vous disant de vous relever si vous ne voulez pas être embarqué !
— Allons, il nous faut partir d'ici, lui dit l'homme. Je dois vous conduire auprès du docteur qui vous dira quelques petites choses et essayera de vous aider. Venez.
Ce disant, il pensa à la table et aux restes du repas, et le tout s'évanouit dans l'air. Puis il emmena Molygruber vers le mur qui s'écarta devant eux, les faisant déboucher sur un long corridor brillant. Des gens y circulaient, mais ils semblaient tous avoir un but, ils semblaient tous se rendre quelque part, tous semblaient faire quelque chose et pourtant lui, Molygruber, était complètement désorienté et ahuri.
Après avoir suivi un couloir, l'homme frappa à une porte verte. ‘Entrez’, dit une voix. L'homme poussa Molygruber à l'intérieur et disparut.
Molygruber regarda autour de lui, effrayé. La pièce était confortable et agréable, mais l'homme imposant, assis derrière le bureau, le terrorisait littéralement ; il lui faisait penser à un Médecin du Travail qui l'avait examiné au moment où il avait demandé un emploi de balayeur des rues — oui, c'était bien ça, le Médecin du Travail. Il avait été très brusque et, ricanant du physique minable de Molygruber, lui avait déclaré qu'il doutait qu'il soit assez fort pour pousser un balai. Mais il s'était laissé attendrir et l'avait finalement reconnu bon pour le job.
L'homme assis derrière le bureau leva les yeux et, cette fois, lui sourit d'un air réconfortant en disant :
— Avancez, Moly, et asseyez-vous. J'ai besoin de vous parler.
Hésitant, presque effrayé d'avancer, Molygruber, tout tremblant, fit quelques pas et vint s'asseoir. L'homme le regarda des pieds à la tête en disant :
— Plus nerveux que beaucoup, hein ? Qu'y a-t-il qui ne va pas, mon gars ?
Pauvre Molygruber, il ne savait que répondre ; si la vie avait été terrible pour lui, il lui semblait maintenant que la mort était pire encore. Et il déversa son histoire.
Le grand homme s'installa confortablement et l'écouta. Puis il lui dit :
— Bon, à votre tour maintenant de m'écouter. Je sais que votre vie a été très dure, mais vous l'avez rendue vous-même plus dure encore. Ce n'est pas un mince fardeau que vous avez à porter. Il vous faut changer vos conceptions sur un tas de choses.
Molygruber le fixait, certains des mots qu'il entendait ne voulant rien dire pour lui. Voyant son trouble, le grand homme demanda :
— Eh bien, qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qui ne va pas maintenant ?
Molygruber répondit :
— Certains mots que je comprends pas ; j'ai aucune éducation, vous savez. On m'a rien appris, seulement ramassé deux ou trois choses comme ça...
L'homme repassa dans son esprit les mots qu'il avait employés.
— Je ne pense pas m'être servi de mots inhabituels. Qu'est-ce donc que vous n'avez pas compris ?
Molygruber baissa la tête et dit avec humilité :
— Conception, j'avais toujours cru que c'était ce que les gens font quand ils fabriquent des bébés. C'est le seul sens de ce mot, pour moi.
Le docteur le regarda bouche bée, puis fut pris d'un véritable fou rire.
— Conception ? Eh bien, conception ne veut pas seulement dire ce que vous croyez. Conception signifie aussi compréhension. Si vous n'avez aucune conception d'une chose, vous n'en avez aucune compréhension, et c'est tout ce que veut dire ce mot — vous n'avez aucune conception de ceci, cela, ou autre chose. Disons plus simplement que vous ne savez absolument rien à propos de quelque chose, mais qu'il le faut.
Tout ceci était un véritable casse-tête pour Molygruber — son esprit encore fixé sur ‘conception’— car si l'homme avait voulu dire ‘compréhension ou incompréhension ou non-compréhension’, alors pourquoi diable ne pouvait-il pas dire ainsi ? Mais se rendant compte que le docteur lui parlait, il se cala sur sa chaise et écouta.
— Vous ne croyiez pas à la mort, ou plutôt, à la vie après la mort. Vous avez quitté votre corps et avez flotté ici et là ; vous ne sembliez pas pouvoir vous mettre dans la tête que vous aviez quitté un corps en décomposition et étiez encore vivant ; vous étiez axé sur l'idée de néant et n'en vouliez pas démordre. Aussi, si vous n'êtes pas capable d'imaginer un certain lieu, vous ne pouvez pas y aller ? Pas vrai ? Si vous vous persuadez qu'il n'y a rien, alors pour vous il n'y a rien. Vous n'avez que ce à quoi vous vous attendez, ce que vous croyez, ce que vous pouvez reconnaître, vous n'avez que ce que vous pouvez comprendre ; aussi avons-nous essayé de vous choquer, et c'est pourquoi nous vous avons fait retourner dans cet atelier des Pompes Funèbres afin de vous laisser voir quelques cadavres entreposés, habillés et maquillés pour l'exposition. Nous avons cherché à vous faire voir que vous n'étiez qu'une pauvre chose raide dont personne ne se préoccupait, qui ne comptait pour personne ; et c'est la raison pour laquelle on vous a jeté sur un lit de copeaux ; mais même cela ne suffisait pas ; il a fallu vous montrer votre tombe, votre cercueil et aller jusqu'à vous faire voir votre corps en train de se décomposer. Ceci nous déplaisait déjà passablement ; mais il en a fallu davantage encore pour vous éveiller au fait que vous étiez toujours vivant.
Molygruber donnait l'impression d'être en état d'hypnose. Il comprenait de façon assez vague et cherchait à comprendre davantage. Mais le docteur poursuivait :
— La matière ne peut être détruite, elle ne peut que changer de forme, et dans un corps humain il y a une âme vivante immortelle, une âme qui vit pour toujours et à jamais. Elle a besoin de plus d'un corps, car elle doit acquérir toutes sortes d'expériences. S'il s'agit d'une expérience de combat, elle prend le corps d'un guerrier, et ainsi de suite. Mais quand le corps est tué, ce n'est rien de plus qu'un costume usé jeté à la poubelle. L'âme, le corps astral — peu importe le nom que vous lui donnez — se déloge de l'épave, se remet en route, s'éloigne de la poubelle et est prête à recommencer. Mais si cette âme a perdu beaucoup de compréhension ou n'en avait même pas, alors c'est toute une tâche que nous avons pour l'instruire.
Molygruber hochait la tête et pensait confusément à ce vieil auteur qui avait écrit certaines choses que lui, Molygruber, n'avait pas comprises à l'époque ; mais maintenant, une à une, de petites pièces du puzzle se mettaient en place dans son esprit.
Le docteur reprit :
— Si une personne ne croit pas au paradis ou à une vie future, cette personne, quand elle passe de l'autre côté de la mort, se met à errer ; elle n'a nulle place où aller ; personne n'est là pour l'accueillir vu qu'elle demeure convaincue qu'il n'y a rien. Cette personne est dans la position d'un aveugle qui se répète à lui-même que les choses ne peuvent pas être puisqu'il ne peut les voir.
Il jeta sur Molygruber un regard pénétrant pour voir s'il suivait sa pensée, puis continua :
— Vous vous demandez probablement où vous êtes. Vous n'êtes pas en enfer, vous en êtes juste sorti. Le seul enfer existant, c'est cet endroit que vous appelez Terre ; il n'y a pas d'autre enfer, pas de feu de l'enfer ni de damnation, il n'y a pas de torture éternelle, pas de diables qui viennent avec des tisons pour vous brûler de façon indécente sur divers points de votre personne. Vous allez sur la Terre pour apprendre, pour connaître diverses expériences, pour approfondir vos expériences approximatives — et quand vous avez appris ce que vous étiez allé y apprendre, votre corps alors cède et vous montez aux royaumes de l'astral. Il y a beaucoup de différents plans d'existence ; celui-ci est le plus bas, le plus près du plan terrestre, et vous êtes ici, sur le plus bas, parce que vous n'avez pas la compréhension suffisante qui vous permettrait d'aller plus haut, parce que vous n'avez pas la capacité de croire. Si vous alliez maintenant dans un royaume plus élevé, vous seriez aveuglé sur-le-champ par l'intense radiation de vibrations beaucoup plus élevées.
Voyant l'air totalement ahuri et perdu de Molygruber, le docteur ajouta d'un ton maussade :
— Bon, je crois qu'il vaut mieux vous reposer un peu ; je ne veux pas vous fatiguer trop le cerveau pour le moment. Quand vous serez un peu reposé, je vous en dirai un peu plus.
Il se leva et ouvrit une porte en disant :
— Par ici ; reposez-vous et je vous verrai plus tard.
Molygruber entra dans la chambre, une pièce qui paraissait vraiment très confortable, mais en passant sur un certain point du sol, tout cessa d'exister et, sans qu'il le sache, il se retrouva profondément endormi, permettant ainsi à ses ‘batteries astrales’ de se recharger, car elles avaient été sérieusement épuisées par toutes les étranges expériences qu'il avait subies en entendant des choses au-delà de sa compréhension.
Chapitre Six
Il s'éveilla en sursaut :
— Oh ! mon Dieu ! s'exclama-t-il, je vais arriver en retard au travail. On va me virer et il faudra que je m'inscrive au chômage.
Il bondit du lit et resta comme cloué au sol. Il regarda autour de lui, ébahi par l'ameublement et la vue qu'on avait par la large fenêtre. Puis, lentement, tout lui revint. Il se sentit très reposé ; il ne s'était jamais, en fait, senti aussi bien de toute sa vie — sa vie ? Voyons, où était-il donc maintenant ? Il ne croyait pas à la vie après la mort, mais pourtant il était bien mort ; aucun doute à ce sujet. Il avait eu tort certainement, et une vie existait après la mort.
Un homme entra avec un sourire réconfortant et lui dit :
— Alors, vous êtes de ceux qui aiment le breakfast, hein ? Vous aimez la nourriture, n'est-ce pas ?
L'estomac de Molygruber commença à se manifester par des gargouillements.
— Sûr que je l'aime, répondit-il. Je vois pas très bien comment on pourrait continuer sans nourriture. J'aime en avoir des tas, mais j'ai jamais eu beaucoup à manger.
Il se tut pendant quelques secondes, puis reprit :
— J'ai vécu de cafés et de hamburgers, c'était bon marché. J'ai jamais eu autre chose. Fichtre ! Ce que j'aimerais un bon repas !
L'homme le regarda et lui dit :
— Eh bien ! demandez ce que vous voulez. Vous pouvez l'avoir.
Molygruber demeurait là en proie à l'indécision. Il avait envie de tant de choses merveilleuses vues sur des menus affichés à l'extérieur des hôtels et des restaurants. Qu'était-ce donc ? Il réfléchit un instant ; puis la chose lui revint à l'esprit. C'était un breakfast spécial affiché à l'extérieur d'un des meilleurs restaurants de l'endroit. Rognons grillés, œufs frits, toasts — oh ! tellement de choses. Certaines étaient très au-delà de sa compréhension ; il ne les avait même jamais goûtées ; mais l'homme qui le regardait sourit soudain en disant :
— Très bien, j'ai compris ce que vous voulez et le voici.
Il se retourna et quitta la chambre en riant. Molygruber demeura étonné, se demandant pourquoi il était parti aussi rapidement. Et ce breakfast ? Où était-il ? L'homme lui avait demandé de commander un petit déjeuner, et puis il était tout simplement parti.
Un fumet merveilleux le fit se retourner, et là, juste derrière lui, il y avait une table recouverte d'une belle nappe blanche ; serviette, argenterie, vaisselle fine, tout y était ; ses yeux s'ouvrirent démesurément.
Il souleva un des couvercles d'argent et faillit s'évanouir d'extase à l'odeur qui montait du plat. Il n'avait jamais vu de tels mets. Il regardait, ne parvenant pas à croire que cela lui était vraiment destiné, puis il finit par s'asseoir. Il posa une serviette sur sa poitrine et attaqua son repas. Pendant un moment, ce ne fut que mastication tandis que Molygruber mordait dans les saucisses, le foie, le rognon, les œufs frits et autres petites choses. Puis ce fut le bruit des toasts craquant sous ses dents, suivi de la déglutition de sa tasse de thé. Il n'avait jamais bu de thé, et le goût lui parut d'une certaine manière plus agréable que celui du café. De toute façon, c'était un changement agréable.
Il se leva et retourna s'étendre sur son lit ; le repas avait été si substantiel qu'il avait peine à rester debout. Il s'étendit donc, se laissa aller et ne tarda pas à se retrouver au pays des rêves. Il rêva à la Terre, il rêva à la dure vie qu'il avait eue là, il rêva à son père qu'il n'avait pas connu et à sa mégère de mère ; il se revit quittant la maison et allant travailler sur le dépôt d'ordures, puis, comme il l'aurait dit, se frayant un chemin jusqu'à pousser une brouette dans les rues, balayant les trottoirs. Les pensées et les images défilaient dans son esprit et y tournaient en rond. Ouvrant les yeux, soudain, il vit que la table avait disparu et que le docteur qu'il avait vu hier était assis devant lui.
— Eh bien, mon garçon, dit celui-ci, c'est un sérieux repas que vous avez pris là ! Vous savez, bien sûr, que vous n'avez besoin d'aucune nourriture sur aucun de ces plans d'existence. En éprouvant la nécessité de manger, vous ne faites que céder à une habitude inutile ramenée de la Terre ou la nourriture est nécessaire. Ici nous trouvons dans l'environnement toute notre subsistance et toute notre énergie. Vous découvrirez très vite qu'il en est de même pour vous, car ces aliments que vous venez d'absorber ne sont qu'une illusion ; vous assimilez tout simplement de l'énergie sous une forme différente. Mais maintenant, il nous faut parler ; vous avez des tas de choses à apprendre. Asseyez-vous ou bien étendez-vous, mais écoutez-moi.
Se renversant sur son lit, Molygruber écouta ce que le docteur avait à lui dire.
— L'humanité, lui dit ce dernier, est une expérience limitée à un Univers particulier, un Univers dont la Terre est une toute petite composante, sans importance. L'humanité n'est que le vêtement temporaire d'âmes immortelles qui doivent faire l'expérience des difficultés et de la discipline par l'existence corporelle, car ce genre d'épreuves n'existe pas sur ce qu'on appelle les mondes spirituels.
Il y a des entités qui attendent toujours d'être nées d'un corps terrestre ; mais les choses doivent être planifiées avec soin. Tout d'abord, qu'a besoin d'apprendre l'entité, puis, quel genre de conditions devraient prévaloir à travers la vie afin que l'entité puisse tirer le maximum d'avantages de sa vie sur Terre ? (Le docteur regarda Molygruber.) Vous ne semblez pas très renseigné là-dessus, à ce que je crois comprendre ?
Levant les yeux, Molygruber répondit :
— Non, docteur. Je sais que les gens naissent et que le processus est un beau gâchis ; puis ils vivent une poignée d'années de misère et ils meurent ; on les met dans un trou, et c'est tout... enfin c'était ce que je croyais jusqu'à maintenant.
Il avait dit ces mots d'un air réfléchi.
— Oui, c'est très difficile vous savez, remarqua le docteur, si vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe, car vous semblez penser qu'une personne naît, vit et meurt... et c'est tout. Mais il n'en est pas du tout ainsi. Je vais tout vous expliquer.
Et voici ce qu'il lui dit :
"La Terre n'est qu'un petit endroit insignifiant dans cet Univers, et cet Univers est un petit endroit insignifiant comparé à d'autres univers, des univers qui regorgent de vies, vies de nombreuses différentes sortes, vies servant de nombreux buts différents. Mais la seule chose qui compte actuellement pour les humains, c'est ce qui arrive aux humains. Tout cela est semblable à une école. Un bébé vient de naître ; pendant un temps il apprend à travers ses parents les rudiments d'un langage ; il apprend — cela avant la venue sur Terre des hippies et du M.L.F. — un semblant de manière, de culture. Puis vient l'âge du jardin d'enfants, et dans cette école il est gardé par un malheureux maître qui essaye de le distraire pour qu'il reste tranquille jusqu'à l'heure de la sortie. À l'école, la première période n'a pas une grande importance — tout comme la première vie sur Terre.
"L'enfant progresse et passe d'une classe à l'autre, chacune devenant de plus en plus importante — jusqu'au moment où il arrive au diplôme. Alors c'est l'école préparatoire de médecine ou la faculté de droit. Ou le modeste apprentissage de compagnon-plombier. Peu importe ce que c'est, la personne doit étudier et passer des examens — et il convient de souligner que certains plombiers gagnent plus d'argent que certains médecins. Sur Terre, le statut social est une vaste erreur. Peu importe ce qu'étaient les parents d'un individu ; la seule chose qui compte dans la vie après la mort, c'est ce que CET INDIVIDU EST DEVENU. Vous pouvez avoir un gentleman instruit, aux pensées les plus nobles, qui n'est sur Terre que le fils d'un plombier. Vous pouvez également avoir une autre personne qui peut même être conservateur de musée, qui peut avoir eu tous les avantages d'un statut social élevé, et qui peut se montrer pire qu'un porc dans ses manières ou son manque de manières. Les valeurs sur Terre sont fausses, complètement fausses, et seules comptent celles de l'après-vie.
"Aux premiers jours de ce Cycle particulier de civilisation, les choses étaient plutôt rudimentaires et brutales ; les gens apprenaient leurs leçons en tapant sur la tête de quelqu'un ou bien en se faisant eux-mêmes taper dessus. Les deux parties en présence n'étaient parfois que de petits propriétaires terriens, ou des ouvriers agricoles, ou quelquefois de hauts chevaliers se battant dans un tournoi dans quelque domaine royal ; peu importe la façon dont on est tué, quand on l'est — eh bien ! — on est mort et il faut alors passer à une autre vie.
"À mesure que le monde lui-même atteint une certaine maturité dans ce Cycle d'existence, les tensions et les contraintes que l'on a à surmonter deviennent plus sophistiquées. Dans le monde des affaires, on rencontre toute la haine, les jalousies et la mesquinerie de la vie de bureau, toute la compétition acharnée dans la vente des voitures, des assurances, ou n'importe quelle autre affaire ou profession compétitives. Dans la vie actuelle, comme il n'est pas question d'assommer son voisin, on lui fait un croc-en-jambe poliment ou, en d'autres mots, on s'organise pour le piéger de sorte que si, par exemple, vous êtes un auteur et n'appréciez pas tel ou tel autre écrivain, eh bien, vous conspirez avec quelques autres auteurs pour piéger votre victime. Vous produisez une quantité de fausses preuves, puis vous mettez un journaliste sur l'affaire en lui offrant une petite enveloppe et, s'il s'agit d'un type qui aime la table, eh bien, vous l'invitez à dîner. Il part alors rédiger son article sur la victime en question et tous les autres minables de la presse — une profession ou un secteur extrêmement bas — tombent dans le panneau et font de leur mieux pour torpiller l'auteur qu'ils n'ont jamais rencontré et dont ils n'ont jamais rien lu. C'est ce qu'on appelle la civilisation.
Le docteur fit une pause, puis dit à Molygruber : "J'espère que vous comprenez bien tout ceci ; sinon, il vous faut m'arrêter. Je dois vous enseigner quelque chose, car vous semblez n'avoir rien appris du tout pendant votre vie sur Terre."
Molygruber hocha la tête, l'air assez étonné à présent, et le docteur continua :
"Après qu'une personne ait décidé dans le monde astral ce qui lui est nécessaire, les circonstances sont alors examinées et on sélectionne les parents qui pourraient convenir. Puis quand le mari et la femme, sur Terre, ont fait leur petite affaire, l'entité est alors préparée dans l'astral ; elle ‘meurt’ au monde astral et est poussée dans le monde terrestre sous la forme d'un bébé. Le traumatisme provoqué par le fait même de naître est habituellement si sérieux que l'individu oublie tout de sa vie passée ; et c'est pourquoi nous avons des gens qui disent : "Oh, mais je n'ai pas demandé à naître ! Aussi ne me blâmez pas pour ce que j'ai fait !"
"Quand une personne meurt à la Terre, elle aura atteint un certain niveau de compréhension ; elle pourra avoir appris un peu de métaphysique et aura ainsi acquis quelque savoir qui l'aidera dans l'autre monde. Dans un cas comme le vôtre, Molygruber, vous donnez l'impression d'être singulièrement ignorant de ce qu'est la vie après la mort, et donc voici ce qu'il en est à présent.
"Quand une personne qui n'a vécu que quelques existences sur le plan terrestre — c'est-à-dire sur le plan à trois dimensions — quitte la Terre, ou ‘meurt’ comme on dit improprement, le corps astral ou l'âme ou quel que soit le nom que vous lui donnez, est reçu dans un monde astral inférieur approprié au savoir de la personne qui vient d'arriver. On peut dire d'un garçon ou d'un homme peu cultivé qu'il devra, s'il veut s'élever dans la société, suivre des cours du soir afin d'y acquérir les connaissances indispensables. Il en est de même avec les mondes astraux. Il y existe de nombreux, très nombreux mondes astraux, dont chacun convient à un type donné d'individu. Ici, dans ce monde qui est l'astral inférieur de la quatrième dimension, il vous faudra vous instruire en métaphysique, vous devrez apprendre comment penser afin d'obtenir vêtements, nourriture et tout ce dont vous avez besoin. Vous avez encore à vous rendre dans le Hall des Souvenirs, où vous verrez tout ce que vous avez fait dans votre vie passée, et où vous vous jugerez. Et je peux affirmer qu'il n'est pas de juge aussi sévère que son propre Sur-Moi. Le Sur-Moi peut être comparé à l'âme. Je vous dirai brièvement qu'il existe environ neuf ‘dimensions’ disponibles dans cette sphère particulière d'activité. Quand on a finalement atteint l'incarnation dans le neuvième corps ou Sur-Moi, on est alors prêt à monter dans les royaumes plus élevées et à apprendre des choses supérieures. Les gens, les entités, s'efforcent toujours de s'élever, tout comme les plantes luttent pour aller vers la lumière.
"Ceci est un monde astral inférieur où vous aurez plusieurs leçons à apprendre. Il vous faudra aller à l'école pour y être instruit de nombreux faits de la vie sur Terre, de nombreux faits de la vie dans l'astral. Puis, plus tard, vous déciderez du type de leçons que vous avez à apprendre. Quand tout ceci aura été décidé, vous serez en mesure de retourner sur la Terre auprès de parents appropriés et il est à espérer que vous aurez cette fois davantage d'opportunités de vous élever et d'avoir un meilleur statut sur Terre, c'est-à-dire un meilleur statut de l'âme, et non pas seulement une meilleure position sur Terre. Il est à espérer que dans la prochaine vie vous apprendrez beaucoup, de sorte que lorsque vous quitterez à nouveau le corps terrestre, vous ne reviendrez pas à ce bas niveau, mais vous monterez à deux, peut-être trois ‘plans’ au-dessus de celui-ci.
"Plus vous montez dans les plans astraux, plus vos expériences sont intéressantes et moins vous endurez de souffrances, mais il vous faut approcher ces choses avec précaution, doucement et lentement. Si vous étiez, par exemple, placé soudainement sur un monde astral deux ou trois stades au-dessus de celui-ci, vous seriez aveuglé par l'intensité des émanations provenant des Gardiens de ce monde-là ; aussi, plus vous apprendrez rapidement ce que vous avez à apprendre, plus vite vous pourrez retourner sur Terre et vous préparer pour un stade plus élevé.
"Disons qu'un homme vraiment très bon quitte la Terre, la Terre à trois dimensions d'où vous venez si récemment d'arriver. S'il s'agit d'un homme vraiment spirituel, il pourrait s'élever de deux ou trois niveaux et il ne trouverait pas alors un aussi dur traitement que celui que vous avez sur ce plan, il n'aurait pas non plus à imaginer des aliments pour se nourrir. L'essence de son corps absorberait, de l'environnement, toute l'énergie dont il a besoin. Vous pourriez en faire autant, mais vous n'êtes pas instruit en de telles choses, vous ne comprenez pas grand-chose à la spiritualité, comme en témoigne le fait que, jusqu'à présent, vous n'avez pas cru à la vie après la mort. Sur ce plan-ci, celui où vous résidez à présent, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne croient pas à la vie après la mort ; ils sont ici pour apprendre qu'elle existe !
"Dans des incarnations à venir, vous lutterez pour monter, ce qui fait que, mourant au monde terrestre, vous renaîtrez à un monde astral ; vous vous élèverez à un plan supérieur et aurez de plus en plus de temps entre les incarnations. Dans votre cas, par exemple, supposons que vous ayez été renvoyé de votre emploi sur Terre. Eh bien, dans votre travail particulier, il y a habituellement beaucoup de postes vacants ; vous pourriez retrouver un emploi similaire le lendemain ; mais si vous étiez un professeur, à titre d'exemple, il vous faudrait faire un plus grand effort et attendre plus longtemps pour obtenir l'emploi convenable. De même sur ce plan où vous êtes maintenant hébergé, vous pourriez être renvoyé sur Terre dans un mois ou deux ; mais quand on atteint à des plans plus élevés, on doit attendre plus longtemps afin de se remettre des chocs psychiques endurés sur la Terre.
Molygruber se redressa en disant :
— Tout ça, docteur, me dépasse. Je suppose que je dois commencer à apprendre quelque chose, hein ? Mais est-ce qu'on ne peut pas, d'ici, parler aux gens qui sont sur Terre ?
L'ayant regardé pendant un instant, le docteur répondit :
— Oui, si le sujet est jugé suffisamment urgent. Sous certaines conditions et circonstances, une personne d'ici peut entrer en contact avec quelqu'un qui vit sur Terre. Qu'avez-vous en tête ?
L'air un peu embarrassé, considérant ses pieds puis ses mains en tripotant ses pouces, Molygruber finit par répondre :
— Eh bien voilà ! Le gars qui a ma vieille brouette, j'aime pas la façon dont il la traite. Je la soignais, je la polissais avec de la laine d'acier et la tenais toujours aussi propre que possible. Je voudrais entrer en contact avec le directeur du dépôt et lui dire de donner au gars qui a pris mon job un bon coup de pied où vous savez.
Le docteur eut l'air assez choqué :
— Mais, mon ami, répliqua-t-il, il vous faut apprendre, il vous faut apprendre à ne pas céder à la violence et à ne pas juger une autre personne si sévèrement. Vous méritez, bien sûr, des éloges pour avoir pris tant de soin de votre instrument de travail ; mais un autre homme peut aimer passer son temps de façon différente. Non, il est impossible que vous entriez en contact avec votre directeur pour un motif aussi frivole. Je vous suggère d'oublier votre vie sur Terre, vous n'y êtes plus maintenant, vous êtes ici, et plus vite vous apprendrez ce qui concerne cette vie et ce monde, plus vite vous serez en mesure de progresser, car vous êtes ici pour apprendre et seulement pour cela afin de pouvoir être renvoyé — si vous le méritez — vers un statut supérieur.
Molygruber était là, assis sur son lit, ses doigts tambourinant ses genoux. Le docteur le regarda avec curiosité se demandant comment il était possible que des gens puissent vivre un bon nombre d'années sur Terre et demeurer ‘une âme enfermée dans l'argile’, ne sachant pas grand-chose de ce qui se passe autour d'eux et ne sachant rien du passé ou du futur.
— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il soudain.
Molygruber leva les yeux en sursautant puis répondit :
— Oh ! j'ai pensé à certaines choses et je comprends que je suis mort. Mais si je suis mort, pourquoi est-ce que j'ai l'air solide ? Je ne suis pas un fantôme ? Pourquoi semblez-vous solide ? Si vous êtes un fantôme, vous devriez être comme une bouffée de fumée.
Le docteur éclata de rire.
— Combien de fois n'ai-je pas entendu cela ? dit-il. La réponse est très, très simple : quand vous êtes sur Terre, vous êtes fondamentalement du même type de matière que tous ceux qui vous entourent, et ainsi vous vous voyez mutuellement comme étant solides, mais si une personne — moi, par exemple — j'allais sur Terre venant de l'astral, je serais si ténu pour les gens solides de la Terre, qu'ils ne me verraient pas ou verraient à travers moi. Mais ici nous sommes, vous et moi, de la même matière, de la même densité de matière ; aussi pour l'un et pour l'autre nous sommes solides, tout autour de nous est solide. Et écoutez bien ceci : vu que sur les plans plus élevés d'existence les vibrations sont de plus en plus élevées, si quelqu'un venait à nous, disons, de la cinquième dimension, nous serions incapables de le voir ; il vous serait invisible, parce qu'étant d'une matière plus fine. (Pour Molygruber, tout cela était trop ; il était assis là, paraissant déconcerté et tripotant ses doigts.)
Vous ne me suivez pas du tout, n'est-ce pas ? lui dit le docteur.
— Non. Pas du tout.
Le docteur soupira.
— Bon, je suppose, dit-il, que vous connaissez un peu la radio, que vous avez déjà écouté la radio. Vous savez que vous ne pouvez pas avoir la radio FM sur un poste qui n'est fait que pour la bande AM, et que vous ne pouvez pas avoir AM sur une radio conçue pour FM seulement. Eh bien, cela devrait vous donner une idée, parce qu'on peut dire que FM est une haute fréquence et qu'AM est une basse fréquence. De la même façon, vous pouvez dire que nous, sur ce plan d'existence, sommes de la haute fréquence et les gens sur Terre sont de la basse fréquence. Cela devrait vous aider à comprendre qu'il y a au ciel et sur Terre plus de choses que vous ne pensez ; mais vous êtes ici maintenant et vous devez apprendre certaines d'entre elles.
Molygruber eut soudainement une image du temps où il lui était arrivé de fréquenter l'École du Dimanche — pour deux ou trois dimanches seulement, mais l'image lui vint tout de même à l'esprit. Il cessa de jouer avec ses doigts et regarda le docteur :
— Docteur, y a-t-il quelque chose de vrai dans l'histoire qui dit que les gens vraiment saints sont assis au premier rang au paradis ?
Le docteur éclata de rire :
— Oh ! Dieu ! tant de gens ont cette idée ridicule. Non, il n'y a rien de vrai là-dedans. Les gens ne sont pas jugés en fonction de leur religion, mais du fonctionnement intime de leur esprit. Font-ils le bien pour essayer de faire le bien, ou font-ils le bien pour acquérir une sorte d'assurance en vue du moment où ils quitteront la Terre ? Eh bien, c'est une question à laquelle on se doit d'être en mesure de répondre. Quand les gens passent de vie à trépas, ils voient et font d'abord l'expérience de ce qu'ils s'attendent à voir et à vivre. Par exemple, si de fervents Catholiques ont été élevés avec des idées d'anges, de musique céleste et de saints jouant de la harpe, alors c'est ce qu'ils auront quand ils passeront d'un monde à l'autre. Mais quand ils se rendent compte que tout cela n'est qu'une comédie — une hallucination — ils voient alors la Vraie Réalité, et c'est leur intérêt de la voir le plus vite possible.
Il s'arrêta, regarda très sérieusement Molygruber et reprit :
— Ce qu'il y a de bien en ce qui concerne des gens comme vous, c'est qu'ils n'ont aucune idée fausse quant à ce qu'ils vont voir. Beaucoup de gens de votre type gardent un esprit ouvert, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni croyants ni incroyants, ce qui vaut beaucoup mieux que de suivre en esclave une discipline particulière.
Molygruber était immobile, fronçant les sourcils à tel point qu'ils se rejoignaient presque, puis il parla :
— Quand j'étais gosse, j'avais une peur bleue car on me disait toujours que, si je n'obéissais pas, j'irais en enfer, que là un tas de diables me brûleraient où VOUS savez avec des fourches chauffées au rouge, et que je subirais de grandes souffrances. Comment, si Dieu est aussi grand qu'on le dit, si Dieu est notre Père miséricordieux, peut-Il vouloir nous torturer éternellement ? C'est ce que je ne peux pas arriver à comprendre !
Le docteur soupira profondément, et après une légère pause, répondit :
— Oui, c'est là une de nos plus grandes difficultés. On a donné aux gens de fausses valeurs... de fausses affirmations ; on leur a dit qu'ils iraient en enfer et souffriraient la damnation éternelle. Il n'y a, dans tout cela, pas un brin de vérité. L'enfer, c'est la Terre. Les entités vont sur Terre pour connaître — principalement à travers les épreuves — et apprendre — de nouveau, principalement à travers les épreuves — toutes les différentes choses qu'elles doivent apprendre. La Terre est généralement un lieu de souffrance. Si une personne est peu évoluée elle n'a généralement pas suffisamment de ce que nous appelons le ‘karma’ pour avoir à souffrir afin d'apprendre. Ces personnes restent sur Terre pour acquérir quelque expérience en observant les autres et, ensuite, reviennent plus tard pour leurs propres épreuves. Mais il n'existe pas d'enfer après la vie sur Terre. C'est une illusion, c'est un faux enseignement.
— Alors, dit Molygruber, pourquoi y a-t-il tant de choses sur l'enfer dans le Livre Saint ?
— Parce que, répondit le docteur, il y avait au temps du Christ un village appelé Enfer. Il était situé en bordure d'une très haute terre, et à l'extérieur de ce village se trouvait un marais frémissant d'où sortaient une fumée brûlante et une puanteur continuelle de vapeurs sulfureuses. Quand une personne était accusée de quelque chose, on l'amenait au village Enfer pour lui faire subir l'épreuve de passer par l'Enfer — passer à travers le marais fumant de soufre — selon la croyance qui voulait que si elle était coupable elle ne supporterait pas la chaleur et serait brûlée. Mais si elle était innocente, ou assez riche pour soudoyer les prêtres du lieu — qui lui recouvraient alors les pieds d'un enduit protecteur — elle pouvait traverser le marais et émerger de l'autre côté, reconnue innocente. C'est ce qui se passe maintenant, n'est-ce pas, avec la façon dont la justice est souvent achetée et l'innocent est emprisonné alors que le coupable reste en liberté.
— Il y a autre chose que je ne comprends pas, dit Molygruber. On m'a dit que lorsqu'on meurt il y a des aides de l'Autre Côté — où que ce soit — qui viennent aider une personne à entrer au Paradis ou l'envoyer à l'Autre Endroit. Eh bien, je suis supposé être mort, mais je n'ai certainement pas vu d'aides. Il m'a fallu y aller tout seul, comme le bébé qui naît au moment où on ne l'attend pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aides, finalement ?
Le docteur répondit :
— Bien sûr qu'il y a des aides qui assistent ceux qui souhaitent l'être ; mais si quelqu'un — vous, par exemple — se refuse à croire en quoi que ce soit, vous ne pouvez non plus croire aux aides. Aussi, si vous n'y croyez pas, ils ne peuvent venir vous aider. Et au lieu d'être assisté, vous êtes muré dans l'épais brouillard noir de votre propre ignorance, de votre propre manque de croyance, de votre propre manque de compréhension. Oh oui, je vous assure que les aides existent, si vous leur permettez de venir. De même, les parents ou les proches qui sont décédés viennent généralement accueillir le nouveau venu dans les plans astraux de l'existence. Mais ce plan-ci est le plan le plus bas, celui qui est le plus près de la Terre, et vous y êtes parce que vous n'avez cru en rien. Aussi, parce que vous êtes tellement ignorant, vous trouvez cela encore plus difficile de croire aux plans plus élevés que celui-ci et vous êtes donc ici, dans ce que certaines personnes considèrent comme le purgatoire. Ce mot signifie purger, un lieu de purgation, et jusqu'à ce que vous soyez purgé de votre manque de croyance, vous ne pouvez progresser. Et ainsi, parce que vous êtes sur ce plan, vous ne pouvez pas rencontrer ceux qui ont été amicaux avec vous, dans d'autres existences. Ils sont tellement plus élevés.
Molygruber remua, mal à l'aise, en disant :
— Mince ! Je parais avoir dérangé les choses, aussi que se passe-t-il maintenant ?
Le docteur se leva et pria Molygruber de faire de même en disant :
— Vous devez vous rendre maintenant au Hall des Souvenirs où vous reverrez chacun des événements de votre vie sur Terre ; en les voyant, vous jugerez de ceux où vous avez réussi, et de ceux qui furent des échecs ; vous aurez alors le germe d'une idée dans votre esprit quant à ce que vous aurez à faire pour vous améliorer dans une prochaine existence terrestre. Venez.
Ils se dirigèrent vers le mur qui s'entrouvrit et longèrent à nouveau le grand hall. Le docteur parla quelques instants avec un homme assis derrière un bureau, puis revint auprès de Molygruber.
— Par ici, lui dit-il.
Tous deux suivirent un long corridor, puis débouchèrent sur une longue pelouse à l'extrémité de laquelle s'élevait un bâtiment particulier qui semblait fait de cristal reflétant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et beaucoup d'autres couleurs que Molygruber ne pouvait tout simplement pas nommer. Ils s'arrêtèrent devant une porte.
— Nous voilà au Hall des Souvenirs, dit le docteur. Il s'en trouve un sur chaque plan d'existence une fois que le plan terrestre a été franchi. Vous y entrez et vous voyez devant vous une réplique de la Terre, flottant dans l'espace. En avançant vers elle vous aurez la sensation que vous tombez, tombez, jusqu'au moment où vous aurez l'impression d'être sur la Terre observant tout ce qui s'y passe, voyant tout mais sans être vu. Vous verrez tout ce que vous avez fait, vous verrez les actions que vous avez prises et la façon dont elles ont affecté d'autres personnes. C'est le Hall des Souvenirs que certains appellent le Hall du Jugement, mais il n'y a, bien sûr, aucun grand juge assis solennellement à vous scruter de bas en haut et à peser votre âme dans la balance pour voir si elle est en faute et, si c'est le cas, vous précipiter ensuite dans des feux éternels. Non, rien de semblable. Dans le Hall des Souvenirs, chaque personne se voit elle-même, et chaque personne juge si elle a réussi. Sinon, quelle en est la raison et que faire pour y remédier. Maintenant, je vous laisse, dit le docteur en prenant Molygruber gentiment par le bras pour le faire avancer. Entrez dans le Hall des Souvenirs, prenez tout le temps nécessaire, et quand vous sortirez, une personne sera là, vous attendant. Adieu.
Sur ce, il se tourna et s'éloigna. Molygruber resta là pris d'un étrange sentiment d'effroi. Il ne savait pas ce qu'il allait voir, et il ne savait pas ce qu'il allait faire au sujet de ce qu'il allait voir. Mais il ne montrait aucun signe de mouvement, il demeurait sur place comme une statue — une statue de balayeur des rues sans sa brouette — et une étrange Force finalement le tourna gentiment et le poussa en direction du Portail du Hall des Souvenirs. Il y entra.
Et ainsi donc, Leonides Manuel Molygruber entra dans le Hall des Souvenirs et là, il vit sa propre histoire en tant qu'entité, depuis le commencement des temps.
Il apprit beaucoup, il apprit sur les erreurs du passé et les choses auxquelles se préparer en vue du futur ; et grâce à des moyens inconnus sur Terre, sa compréhension se fit plus vaste, son caractère se purifia et quand Leonides Manuel Molygruber quitta le Hall des Souvenirs à un moment indéterminé — des jours, des semaines ou peut-être des mois plus tard — il s'installa avec un groupe de conseillers et prépara son retour sur Terre afin que, une prochaine tâche achevée au cours de la vie suivante, il puisse revenir à nouveau sur un bien meilleur plan de la vie astrale.
Chapitre Sept
Le grand Président se renversa dans son luxueux fauteuil pivotant, et serra sa poitrine à deux mains d'un air sinistre. Encore cette douleur qui lui donnait l'impression d'être broyé dans un étau. Il suffoquait et se demandait ce qu'il devait faire. Fallait-il appeler le médecin et aller à l'hôpital ou essayer de supporter encore ?
M. Hogy MacOgwascher, le président de Glittering Gizmos avait un problème très grave, semblable à celui qui avait mis fin à la vie de son père. La firme, fondée par ce dernier, connaissait une prospérité qui amenait Hogy à regretter que son père ne soit plus là pour assister à cette réussite. Hogy tâtonna pour trouver ses capsules de nitrite d'amyle. Il les broya dans un mouchoir en papier et laissa les émanations pénétrer sa poitrine, ce qui pour un temps le calmait. Mais le mal dont il souffrait ne finirait qu'avec la vie. Ce médicament lui permettrait de durer, ce dont il était reconnaissant. Il sentait qu'il n'avait pas encore achevé ce qu'il avait à faire. Il songea à son père disparu depuis longtemps ; il se souvint de leurs conversations qui étaient bien plus celles de deux frères que celles de père à fils. Il jeta un coup d'œil à la large fenêtre aux vitres teintées dans le haut, et repensa au jour où son père debout auprès de lui l'avait pris par l'épaule ; ensemble, ils avaient regardé l'usine et le père avait dit :
— Hogy, mon garçon, tout ceci sera à toi, un jour. Prends-en soin, grand soin. C'est mon œuvre, Hogy. Grâce à elle, tu vivras toute ta vie à l'abri du besoin et tu connaîtras la prospérité.
Puis son père s'était assis lourdement et — comme Hogy maintenant — avait serré sa poitrine à deux mains en geignant de douleur.
Hogy avait sincèrement aimé son père. Il revoyait ce certain jour où assis en face de lui devant le somptueux bureau tout luisant qui semblait aux visiteurs d'une longueur à n'en plus finir — un bureau merveilleux, en vérité, tout sculpté à la main par un vieil artisan d'Europe — il avait demandé à son père :
— Papa, d'où tenons-nous un nom si particulier ? Nombre de gens m'ont posé la question et j'ai toujours été incapable de leur répondre. Tu n'es pas pressé cet après-midi, la réunion du Conseil a bien marché. Alors explique-moi ce qui s'est passé avant ta venue au Canada.
Le Père MacOgwascher s'était renversé dans son fauteuil — celui dans lequel Hogy était assis maintenant — et avait allumé un énorme Havane. Puis, tout en tirant sur son cigare, les pieds sur le bureau, les mains croisées sur son large estomac, il avait commencé :
— Eh bien, mon garçon, nous venons de Haute-Silésie, en Europe. Nous étions Juifs. Mais ta mère et moi, ayant appris qu'au Canada aussi le préjugé contre les Juifs existait, nous avons décidé de nous faire Catholiques. C'est eux qui semblent avoir le plus d'argent et le plus de saints pour veiller sur eux. Ta mère et moi avons réfléchi à différents noms. J'ai alors pensé au cousin de ton oncle, du côté de ta mère. Un homme bien, qui gagnait bien sa vie. Il était Juif comme toi et moi, mais gagnait pas mal d'argent en lavant les cochons. Il les brossait, les récurait et ils sortaient de là propres et roses comme les fesses d'un bébé. Les experts s'entendaient toujours pour dire que les cochons devaient provenir de chez cet homme, tellement ils étaient beaux et bons.
Le père de Hogy avait alors posé ses pieds sur le sol tout en cherchant à attraper le canif spécial muni d'une pointe. Il avait percé le bout de son cigare, qui ne tirait pas très bien, puis satisfait du résultat il avait repris son récit :
— J'ai dit à ma femme : on va s'appeler Hogswasher (Laveur de cochons — NdT), un bon nom à la manière du continent américain, car il y a beaucoup de drôles de noms là-bas.
Il s'était arrêté de parler pour rouler son cigare entre ses lèvres avant de continuer :
— Ma femme m'a dit qu'on devrait faire quelque chose pour enjoliver un peu le nom et le faire plus Catholique, par exemple en mettant un ‘Mac’ devant, comme les Irlandais. Ce Mac c'est un peu comme une sécurité pour eux. Alors j'ai dit, c'est bon. On va s'appeler MacOgwascher — et à partir de maintenant, nous serons Catholiques. De nouveau, le vieil homme s'était arrêté tandis qu'il ruminait un peu plus. Hogy savait toujours quand il était d'une humeur contemplative, car l'inévitable cigare allait et venait entre les lèvres de son père. Puis, après une solide bouffée, il avait repris :
— Les amis à qui j'ai raconté mon histoire m'ont dit que je devrais avoir un saint patron, comme les Catholiques en Irlande. Je ne savais pas qui prendre comme saint ; je n'ai jamais connu aucun saint. Alors un ami m'a dit : "Tu veux un bon saint patron ? Tu devrais choisir Saint Lucre."
Hogy avait regardé son père avec étonnement en disant :
— Je n'ai jamais entendu parler de Saint Lucre. Au Séminaire, les Frères avaient l'habitude de nous parler des saints, de leur vie, mais ils ne nous ont jamais rien dit de Saint Lucre.
— Oui, oui, mon garçon. Je vais te dire pourquoi le saint a ce nom-là. Mon ami m'a dit : "Moses, tu as toujours été prêt à courir après un gain, après le sale profit ; tu dis toujours que l'argent n'a pas d'odeur, et les autres disent que tu cours toujours après le sale lucre. Alors quel meilleur saint pour toi que Saint Lucre ?"
À ce point de ses réflexions Hogy se mit à trembler sous un nouveau spasme qui lui transperçait la poitrine. Il crut un instant qu'il allait mourir, il sentait que sa poitrine était écrasée, comprimée, et que l'air était expulsé de ses poumons. Il renifla encore une fois le nitrate d'amyle, et la douleur diminua progressivement. Soigneusement et, oh combien prudemment, il bougea légèrement ; constatant que le pire de la douleur était passé, il estima qu'il serait plus sage de s'arrêter et de prendre un peu de repos.
Il retourna à ses souvenirs et pensa à son père. Des années auparavant son père avait commencé son affaire avec ce qu'il appelait un revenu de misère. Lui et sa femme avaient quitté la Silésie après un de ces pogroms annuels et étaient arrivés au Canada, comme immigrants. Constatant qu'il n'y avait pas d'occupation pour lui, le père Moses travailla pour un temps comme ouvrier agricole au lieu de sa spécialité de joaillier qualifié. Il avait, un jour, vu un autre ouvrier jouant avec une petite pierre trouée. Il avait questionné l'homme, et celui-ci lui avait affirmé que quand il jouait avec cette pierre, elle lui procurait une grande tranquillité d'esprit. Quand le Patron le réprimandait pour sa lenteur et sa stupidité, l'homme jouait avec sa pierre polie et le calme alors l'envahissait.
Le père de Hogy, durant des jours, avait pensé à cette pierre et avait pris une grande décision. Rassemblant tout l'argent qu'il put, en empruntant, et travaillant comme un esclave pour en avoir davantage, il monta une petite affaire qu'il appela Glittering Gizmos. On y fabriquait de petites choses sans vertu aucune, mais les gens pensaient qu'en ayant dans leur poche ces objets dont la plupart étaient dorés par un procédé sous vide, ils trouvaient le calme. Un ami avait un jour demandé à Moses :
— Qu'est-ce que C'EST que cette chose ? À quoi sert-elle ?
— Ah, mon ami ! avait répondu Moses, voilà une bonne question. Qu'est-ce qu'un Glittering Gizmos ? Personne ne le sait. Mais comme les gens veulent savoir, ils dépensent un bon montant pour l'acheter. Personne ne sait ce que c'est. On n'a jamais pu lui trouver aucun usage, mais notre publicité est ‘NOUVEAU — NOUVEAU — NOUVEAU’ et c'est devenu maintenant un symbole de prestige d'en posséder un ; en fait, avec un supplément, nous le gravons aux initiales de la personne. Il faut se souvenir qu'ici, sur ce continent américain, ce qu'ils veulent c'est quelque chose de nouveau ; tout ce qui est vieux, c'est de la camelote. Eh bien, nous prenons de la camelote, la dorons un peu pour l'enjoliver et annonçons que c'est le dernier gadget, garanti pour vous apporter ceci ou cela, faire telle ou telle chose. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Tout est dans l'esprit de l'acheteur. Purement subjectif. Tout se passe dans sa pensée, et s'il découvre que le gadget n'est doué d'aucune propriété, il se refuse à reconnaître qu'on l'a ‘eu’ et essaye de vendre l'objet à d'autres pour leur montrer qu'eux aussi on peut les ‘avoir’. J'ai fait avec ça un bon petit magot.
— Bonté divine ! s'était exclamé son ami. Ne me dis pas, Moses, que tu exploites avec de la SALETÉ la crédulité du public ?
Moses MacOgwascher avait levé ses sourcils gris dans un mouvement de fausse horreur en disant :
— Dieu du ciel ! Tu ne penses pas, mon ami, que je songerais à filouter les gens ? Est-ce que tu me prends pour un escroc ?
L'ami lui avait répondu en riant :
— Quand je rencontre un Catholique dont le prénom est Moses, je me demande ce qui l'a fait renoncer à être Juif pour devenir Catholique.
Le vieux Moses avait beaucoup ri et conté à son ami l'histoire de sa vie ; comment il avait établi une affaire en Haute-Silésie en se faisant une réputation de qualité, d'honnêteté en affaires, de prix très serrés, puis il avait dit jovialement :
— Et tout s'est écroulé. Les Russes sont venus, ont tout pris, ont fait de moi un indigent et m'ont chassé de ma maison ; pourtant j'étais un honnête homme et vendais des articles authentiques. Aussi j'ai fait volte-face. Je suis devenu un homme malhonnête vendant de la camelote à prix élevé et les gens me respectent davantage ! Regarde-moi maintenant : j'ai ma propre entreprise, ma propre usine, ma propre Cadillac, et j'ai mon saint patron, Saint Lucre !
Éclatant de rire, il s'était dirigé vers un petit meuble fixé dans un coin de son bureau. Déverrouillant lentement la porte, il s'était tourné vers son ami en disant : "Kommen Sie hier" (Viens ici — NdT).
L'ami avait ri aux éclats en s'écriant :
— Mais, Moses, tu te trompes de langue. Tu parles allemand maintenant, tu es censé être un citoyen canadien !
Il s'était avancé vers Moses qui maintenait la porte entrebâillée comme pour attirer davantage sa curiosité. Puis, soudainement, il l'avait ouverte toute grande et l'ami avait vu une plinthe en ébène et, sur elle, le signe du dollar en or surmonté d'un halo. Il avait regardé le vieux Moses d'un air d'incompréhension ; celui-ci avait éclaté de rire devant son expression.
— C'est mon saint, mon Saint Lucre, avait-il dit. Le sale lucre, c'est de l'argent ; mon saint, c'est de beaux dollars bien propres.
Hogy se sentait beaucoup mieux. Il pressa le bouton de son interphone et s'adressa à sa secrétaire : "Venez, mademoiselle Williams." Une jeune femme à l'air très professionnel entra et s'assit d'un air posé sur le bord du bureau.
— Je veux que vous appeliez mon notaire pour le prier de venir ici. Je pense qu'il est temps que je fasse mon Testament.
— Oh ! monsieur Hogy ! s'exclama la secrétaire d'un air alarmé. Vous êtes tout pâle ; ne croyez-vous pas que je devrais demander au Dr Johnson de venir vous voir ?
— Non, non ! Je pense, ma chère, que j'ai simplement un peu forcé sur le travail, et on ne saurait être trop prudent. Aussi, appelez seulement mon notaire et priez-le de venir ici demain matin à 10 heures. Ce sera tout pour cet après-midi.
Il fit un signe de la main pour la congédier et la secrétaire sortit, se demandant si son patron avait eu une prémonition — s'il sentait qu'il allait mourir.
Hogy se cala dans son fauteuil, se remettant à réfléchir au passé et au futur, tout comme son père avait dû le faire en de nombreuses occasions. Il songea à ce que Mlle Williams lui avait dit, et ses pensées se portèrent alors sur la vie de son père. Mlle Williams avait raconté à Hogy comment elle avait un jour surpris dans son bureau le Père MacOgwascher, l'air sombre et silencieux, regardant les nuages au-dessus des bâtiments de l'usine, et soupirant longuement. Mlle Williams s'était arrêtée et avait regardé le vieil homme, craignant qu'il ne meure devant elle.
— Mademoiselle Williams, avait-il dit, il me faut ma voiture. Dites à mon chauffeur de venir me prendre maintenant pour me ramener à la maison.
Mlle Williams avait pris note des ordres de son patron, et le Père MacOgwascher était resté là à réfléchir, les mains croisées sur son gros ventre. Elle était revenue presque aussitôt, l'air très inquiet en le trouvant penché sur son bureau.
— La voiture est à la porte, monsieur, puis-je vous aider à mettre votre pardessus ? avait-elle demandé.
Le vieil homme s'était levé, agité de tremblements en disant :
— Eh ! eh ! mademoiselle Williams, vous pensez que je deviens trop vieux ?
La secrétaire avait souri en se précipitant pour l'aider à glisser ses bras dans les manches du pardessus qu'elle avait ensuite boutonné.
— Voilà votre serviette, monsieur. Je n'ai pas encore vu votre nouvelle Cadillac, vous savez ; aussi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais vous accompagner.
Le vieil homme avait acquiescé avec quelques grognements et tous deux avaient pris l'ascenseur et s'étaient retrouvés devant la porte.
Le chauffeur en uniforme s'était précipité pour lui ouvrir la porte.
— Non, non, mon garçon, avait dit le vieil homme, je vais m'asseoir à l'avant avec vous pour une fois.
Il avait fait un petit salut de la main à Mlle Williams et la voiture avait démarré.
Le vieil homme habitait la campagne, à environ vingt-cinq milles (40 km) de son bureau et il regardait autour de lui alors que la voiture roulait rapidement à travers la circulation, puis dans la banlieue — il regardait autour de lui comme s'il n'avait jamais vu le paysage, ou le voyait pour la dernière fois. Environ une heure plus tard — car la circulation était intense — ils avaient atteint la résidence du vieil homme. Mme MacOgwascher attendait à la porte car Mlle Williams, en secrétaire dévouée, lui avait téléphoné pour dire que son Patron n'était pas très bien et risquait peut-être d'avoir un grave malaise.
— Oh ! Moses, Moses ! s'était écriée sa femme en le voyant. Je me suis fait tant de souci. Peut-être que tu travailles trop ; tu devrais prendre des vacances, ne pas passer tant de temps à ce bureau !
Le vieux Moses avait renvoyé le chauffeur et, très las, était entré dans la maison. C'était celle d'un homme riche, mais d'un homme riche sans raffinement. Voisinaient objets anciens rares et précieux, et le moderne criard ; mais le tout se fondait de cette façon presque mystique propre aux vieux Juifs d'Europe — ce qui faisait qu'au lieu de ressembler à une espèce de bric-à-brac, l'intérieur finissait par être tout à fait attrayant.
Mme MacOgwascher avait pris son mari par le bras en disant :
— Viens t'asseoir, Moses ; on dirait que tu vas tomber. Je pense que je vais envoyer chercher le Docteur Johnson.
— Non, mama, non. Il faut qu'on parle ensemble de certaines choses, toi et moi, avant que le docteur vienne. (Puis, calé dans son fauteuil, il s'était pris la tête à deux mains en pensant.) Mama, avait-il dit, tu te rappelles la Vieille Religion ? Le Judaïsme est la religion de notre famille. Aussi, pourquoi est-ce que je n'appellerais pas un rabbin pour m'entretenir avec lui ? Il y a dans mon esprit un tas de choses que je voudrais éclaircir.
Mme MacOgwascher qui s'était mise à préparer un verre pour le vieil homme en dosant soigneusement la glace, le lui avait apporté.
— Mais, avait-elle demandé, comment pouvons-nous retourner à la religion juive, alors que nous sommes de si bons Catholiques ?
Le vieil homme avait semblé méditer tout en dégustant lentement son verre, puis avait fini par répondre :
— Vois-tu, mama, dans les moments critiques, il faut jeter les masques. On ne peut pas retourner au pays de nos ancêtres, mais on peut retourner à notre vieille religion. Je pense que je devrais voir un rabbin.
Pendant un bon moment, la conversation en était restée là, puis durant le dîner, Moses, soudain, avait laissé tomber son couteau et sa fourchette et s'était renversé sur sa chaise en geignant.
— Non, Moses, en voilà assez. Je vais appeler le Dr Johnson, avait-elle dit en courant téléphoner.
Rapidement, passant son doigt le long de l'indicateur de numéros du téléphone automatique, elle avait appuyé sur un bouton. La dernière merveille électronique s'était mise à bourdonner en produisant le numéro de la résidence du Dr Johnson. Après un très court intervalle, une voix répondait et madame MacOgwascher s'écriait :
— Docteur Johnson, Docteur Johnson, il faut venir très vite. Mon mari est au plus mal avec un serrement de poitrine.
Sachant qu'il avait là un malade qui payait bien, le docteur avait répondu sans hésiter un instant :
— Très bien, madame MacOgwascher, je serai chez vous dans dix minutes.
Elle était retournée auprès de son mari, s'asseyant sur le bras de la chaise auprès de lui.
— Mama ! Mama ! avait dit le vieil homme en serrant sa poitrine à deux mains, tu te rappelles comment nous sommes venus du Vieux Pays, voyageant presque comme des bestiaux pour payer le moins cher possible ? On a travaillé dur, toi et moi ; la vie a été bigrement difficile et je ne suis pas sûr qu'on ait fait la bonne chose en devenant Catholiques. Nous sommes nés Juifs et Juifs nous serons toujours. On devrait peut-être retourner à la Vieille Religion ?
— Mais, c'est impossible, Moses. On ne peut pas. Que diraient les voisins ? Nous serions couverts de honte, tu le sais. Mais je suggère qu'on prenne des vacances ; tu te sentiras peut-être mieux au retour. Le Dr Johnson pourrait nous recommander une infirmière qui nous accompagnerait et s'occuperait de toi.
Elle avait sursauté au bruit de la sonnette. La femme de chambre déjà ouvrait la porte et le docteur était introduit.
— Alors, monsieur MacOgwascher, qu'y a-t-il donc qui ne va pas ? avait dit le docteur d'un ton jovial. Vous avez une douleur dans la poitrine ? Ah, ce doit être une autre crise d'angine — un de ses grands symptômes, vous savez, est une très, très forte impression qu'on va mourir.
Sa femme avait hoché la tête d'un air grave.
— C'est vrai, docteur, il y a déjà un certain temps qu'il a cette impression, aussi j'ai pensé que vous deviez venir le voir d'urgence.
— Vous avez eu raison. Nous sommes ici pour ça, avait dit le docteur. Mais il faut qu'il se couche et que je l'examine soigneusement. J'ai apporté un cardiographe avec moi.
Sans tarder, le vieux Moses avait été installé dans un immense lit double recouvert de l'édredon capitonné à la vieille mode européenne. À mesure que le docteur l'avait examiné, son expression s'était faite de plus en plus grave.
— Je crains, avait-il dit après un long examen, qu'il ne vous faille garder le lit pour un bon moment. Vous êtes un homme très malade, vous savez. Vous avez brûlé la chandelle par les deux bouts, aussi bien que par le milieu, et vous ne pouvez pas vous offrir ce luxe à votre âge. (Il avait refermé le cardiographe, rangé son stéthoscope, et était allé se laver les mains dans la luxueuse salle de bains attenante. Puis, ayant dit au revoir à son patient, il avait descendu l'escalier en compagnie de Mme MacOgwascher.) Pouvons-nous, lui avait-il dit à voix basse, nous isoler pour parler ?
Elle l'avait conduit jusqu'au bureau du vieil homme, et avait fermé la porte.
— Madame MacOgwascher, j'ai peur que votre mari ne soit très sérieusement touché, avait-il dit. S'il se fatigue encore, il ne résistera pas. Votre fils Hogy est bien au collège, n'est-ce pas ?
— Oui, docteur. À Bally Ole College. Si vous estimez que je doive le faire, je lui téléphonerai immédiatement pour lui demander de rentrer. C'est un garçon bien, un très bon fils.
— Je le sais, avait répliqué le docteur. Vous savez que je l'ai rencontré en diverses circonstances. Mais mon opinion est que, maintenant, il devrait rentrer pour voir son père. Ce pourrait fort bien être pour la dernière fois. Je veux que vous compreniez bien que votre mari a absolument besoin d'être surveillé jour et nuit. Peut-être souhaitez-vous que je m'occupe de lui. Je peux vous envoyer des infirmières.
— Oh ! oui, docteur, je vous en prie ; nous pouvons dépenser tout ce qu'il faut pour sa santé. Vous n'avez qu'à ordonner.
Le docteur s'était pincé les lèvres entre le pouce et l'index et avait déclaré :
— Je préférerais, bien sûr, le mettre dans ma propre clinique où nous pourrions l'avoir constamment sous surveillance, mais pour le moment je ne crois pas qu'il serait sage de le déplacer. Il nous faudra le traiter ici. Je vous enverrai une infirmière qui passera huit heures auprès de lui et qui sera remplacée par une autre — le roulement sera ainsi assuré — et je viendrai le voir demain matin, à la première heure. Maintenant, je vais faire une ordonnance et prierai le pharmacien de vous faire porter les médicaments. Vous suivrez les instructions très sérieusement. Au revoir, madame MacOgwascher.
Le docteur s'était levé, avait traversé la salle à manger et regagné sa voiture.
Pendant un moment, Mme MacOgwascher était restée assise, la tête entre les mains, se demandant ce qu'elle allait faire. Elle avait été arrachée à ses réflexions par la femme de chambre.
— Le maître vous demande, madame.
Mme MacOgwascher avait alors monté l'escalier en vitesse.
— Mama, vite le rabbin. J'ai besoin de parler avec lui. Peut-être qu'on peut faire des arrangements pour que mon fils ou un vieil ami récite le Kaddisch.
— Moses ! s'était exclamée sa femme, tu crois vraiment que tu devrais voir un rabbin ? Tu es Catholique. Comment expliquer aux voisins que nous sommes subitement devenus Juifs ?
— Mais, mama, comment pourrais-je mourir en paix si je ne sais pas que quelqu'un récitera le Kaddisch pour moi ?
Perdue dans de profondes pensées, Mme MacOgwascher s'était finalement exclamée :
— Je sais ce qu'on va faire... on fera venir un rabbin comme si c'était un ami, et quand il sera parti on appellera notre prêtre catholique. Comme ça on sera couvert auprès des deux religions et auprès de nos voisins.
Le vieil homme avait ri aux larmes et sa douleur dans la poitrine avait resurgi. Mais ayant repris son souffle, il avait dit :
— Alors, mama, tu me crois vraiment très mal puisque tu penses que j'ai besoin de l'assurance que l'un d'entre eux peut faire la meilleure offre pour me faire entrer au Paradis ? C'est très bien, mama ; mais alors il me faut tout de suite le rabbin, et après le Père catholique. Comme tu as dit, j'aurai une double assurance.
— J'ai téléphoné à Hogy, Moses, avait dit Mme MacOgwascher. Je lui ai dit que tu avais eu une petite rechute et que sa présence te ferait le plus grand bien. Il arrive sous peu.
Hogy, revoyant tous ces événements, oubliait sa douleur en ranimant ses souvenirs, en se voyant dans sa grosse voiture fonçant dans la nuit froide à travers les petits hameaux et les grandes villes. Il se rappelait l'expression ahurie de l'agent de police surgissant de l'ombre et essayant de stopper la voiture, puis n'y parvenant pas et le pourchassant en motocyclette. Mais Hogy avait une voiture puissante et il conduisait très bien. Le policier devait être un bleu, car il avait renoncé à la course.
Hogy se revoyait arrivant à la maison paternelle. L'aube s'annonçait dans un ciel tout coloré de rose, de bleu et de jaune. Un peu plus tard dans la matinée, après avoir pris un peu de repos afin que son père ne s'aperçoive pas à quel point il était fatigué, il était allé voir le vieil homme.
Le Père MacOgwascher était au lit, coiffé du yarmelke, la petite calotte noire que les Juifs orthodoxes portent en certaines occasions. Ses épaules étaient enveloppées de son châle de prière. Il avait accueilli Hogy avec un faible sourire en disant :
— Hogy, mon garçon, je suis content que tu sois revenu à temps. Je suis Juif, et tu es bon Catholique. Tu sais rendre service, mon fils, aussi je veux que tu fasses quelque chose pour moi — que tu récites le Kaddisch qui, comme tu le sais, est la Prière des Morts. Je veux que tu le récites à la manière ancienne qui est presque oubliée. Cela ne devrait pas te gêner par rapport à ta foi catholique, mon garçon.
Hogy avait hésité. Il avait sincèrement adhéré à la religion catholique, croyait fermement à la Bible, aux saints et à tout le reste. Il croyait que le Pape et les autres de la hiérarchie de l'Église catholique avaient des Pouvoirs Divins, aussi comment pouvait-il, bon Catholique comme il l'était, retourner soudainement, même temporairement, à la religion de ses ancêtres, le Judaïsme ?
Le vieil homme avait guetté sa réaction, puis, avec un profond soupir, s'était enfoncé dans son lit en disant :
— C'est bon, mon garçon ; je ne te tourmenterai pas davantage ; mais je crois que nous allons tous à la Maison de la même façon ; peu importe que je sois Juif et toi Catholique. Nous y allons tous de la même façon. Si nous avons vécu une bonne vie, nous sommes récompensés. Mais dis-moi, mon garçon, avait-il ajouté avec un faible sourire, pourquoi les Catholiques ont-ils beaucoup plus peur de la mort que les adeptes d'autres religions ? Pourquoi sont-ils si opposés à toutes les autres religions et soutiennent-ils fermement que, pour quiconque qui n'est pas Catholique, il n'est pas de place au ciel ? Est-ce qu'ils auraient acheté tous les tickets d'avance ? avait demandé en riant le vieil homme.
— Père, avait dit Hogy en grommelant, laisse-moi faire venir ici un des Saints Pères, maintenant. Si tu acceptes de te convertir à présent, je suis certain que tu seras jugé digne d'aller au Paradis. En tant que Juif, tu n'as aucune chance, père. Tu te retrouveras en enfer, tout comme un vieil auteur va y être. J'ai lu dernièrement certains de ses livres, jusqu'au jour où un des pères m'a surpris, et j'ai eu une pénitence pour avoir lu ce type qui s'appelle Rampa. Il y a quelque temps, à l'hôpital, une bonne sœur catholique pleurait à l'idée qu'il irait en enfer — parce qu'il était Bouddhiste — un Bouddhiste, peux-tu imaginer ça ?
Le Père MacOgwascher avait regardé son fils avec compassion et pitié.
— Mon garçon, tu as beaucoup changé depuis ton départ. Ta ferveur catholique fait de toi un bigot. Ça ne fait rien, fiston, je vais faire appeler un de mes vieux amis qui a été pour moi comme un fils et je lui demanderai de réciter le Kaddisch ; de cette façon, tu n'auras pas de problème de conscience.
Le rabbin était venu rendre visite au vieil homme qui lui avait confié :
— Mon fils a changé au point qu'il n'est vraisemblablement pas mon fils ; il se refuse à lire le Kaddisch pour moi et ne tolère même pas de parler de notre religion. Je vous demande, mon ami, de bien vouloir réciter le Kaddisch pour moi.
Posant ses mains sur les épaules de son vieil ami, le rabbin avait répondu :
— Bien sûr, Moses, que je le ferai, mais mon fils est un garçon très bien et il me semble que ce serait peut-être mieux que ce soit lui qui le fasse. Il est jeune, de l'âge de votre fils. Mais nous sommes de la même génération, vous et moi.
Le vieux Moses avait réfléchi, puis souri en signe d'acceptation tout en disant :
— Oui, c'est une bonne idée, rabbin. J'accepte le conseil, et votre fils — s'il le veut bien — récitera le Kaddisch comme s'il était mon propre fils.
Le vieil homme s'était tu, puis avait dit après un silence :
— Rabbin, vous connaissez cet auteur, Rampa ? Avez-vous lu ses livres ? Mon fils m'a assuré qu'on interdit aux Catholiques de les lire ; de quoi parlent-ils ?
Le rabbin avait répondu en riant :
— Je vous en ai justement apporté un, mon ami. Il dit beaucoup de choses sur la mort et apporte un grand réconfort. Je vous demande de le lire ; vous y trouverez la tranquillité d'esprit. J'en ai recommandé la lecture à un grand nombre de gens et — oui — je le connais. C'est un homme qui écrit la vérité, c'est un homme qui a été persécuté par la presse, ou plus précisément par les médias. Il y a eu un petit complot contre lui, il y a quelques années ; les journalistes ne cessaient de proclamer que son père était un plombier — ce qui, je le sais pertinemment, est inexact. Mais outre le fait que c'est un mensonge, pourquoi devrait-on avoir à rougir d'être le fils d'un plombier ? Leur Sauveur, le Christ, était nous a-t-on dit le fils d'un charpentier, et beaucoup de saints chez les Catholiques sont d'origine très humble. L'un d'eux, Saint Antoine, était le fils d'un gardien de cochons. Certains étaient des voleurs qui ont été convertis. Croyez-moi, l'homme dit la vérité ! En tant que rabbin j'entends beaucoup de choses, je reçois un abondant courrier et je vous assure que l'homme dit la vérité ; mais il a déplu à un groupe de gens qui, depuis, n'ont cessé de le tourmenter. Et aucun média ne lui a jamais offert la possibilité de s'expliquer.
— Mais pourquoi a-t-il à s'expliquer ? demanda le vieux Moses. S'il a été victime d'une cabale, comme il arrive si souvent, pourquoi n'a-t-il rien fait à ce moment-là ? Pourquoi réagir maintenant ?
D'un air triste, le rabbin avait répondu :
— Il était couché avec un infarctus quand les journalistes se pressaient en grand nombre à son domicile. Et comme on pensait qu'il allait mourir et que personne ne pourrait plus réfuter leurs histoires, ils se firent encore plus virulents. Mais laissons ce sujet pour l'instant et occupons-nous de vous maintenant. Je vais aller parler à mon fils.
Les jours avaient passé. Trois jours, quatre jours, et le cinquième jour, quand Hogy était entré dans la chambre de son père, ce dernier était renversé sur ses oreillers, les yeux à demi ouverts, la bouche grande ouverte et le menton pendant sur sa poitrine. Hogy s'était précipité vers lui, puis avait couru appeler sa mère.
Les funérailles de Moses MacOgwascher furent simples et intimes. Trois semaines plus tard, Hogy regagnait le collège et achevait ses études avant de reprendre les affaires de son père.
Chapitre Huit
Hogy MacOgwascher reprit conscience du présent avec un sursaut. Il leva les yeux, se sentant un peu coupable. Depuis combien de temps rêvassait-il ? Le temps n'avait pas d'importance alors qu'il était aux prises avec ces horribles douleurs. Il resta là, assis, tenant sa poitrine à deux mains et se demandant s'il n'allait pas finir comme son père.
La porte s'ouvrit furtivement. Hogy regarda, étonné. Que se passait-il ? Était-ce un voleur venu pour faire un mauvais coup ? Puis la porte s'ouvrit un peu plus, mais toujours avec précaution ; il entrevit un visage et un œil qui le regardait. C'était sa secrétaire. Comprenant qu'il l'avait vue, elle entra, un peu rougissante.
— Oh ! monsieur Hogy, dit-elle, vous m'avez tellement inquiétée que je suis venue vous voir à deux reprises. J'étais sur le point d'appeler le docteur. J'espère que vous ne pensez pas que je vous espionnais ?
Hogy répondit en lui souriant gentiment :
— Non, ma chère. Loin de moi cette pensée. Je suis simplement navré de vous avoir inquiétée. (Il la regarda avec l'air d'attendre quelque chose et leva les sourcils dans le vieux geste juif, symbole d'interrogation.) Vous voulez peut-être me demander quelque chose ? dit-il.
La secrétaire le regarda avec sollicitude et répondit :
— J'ai remarqué, ainsi que d'autres membres du personnel, que vous aviez l'air de souffrir beaucoup ces derniers jours. Ne pourriez-vous pas faire un sérieux bilan de santé, monsieur Hogy ?
— Je l'ai fait. Je souffre d'angine de poitrine — un état cardiaque, vous le savez — et je suppose que je devrai finir par abandonner mes fonctions de président, si je vis assez longtemps pour cela. Aussi vais-je décider qui me remplacera. Peut-être pourrions-nous organiser une réunion du Comité pour demain après-midi ; voulez-vous le notifier aux membres du Conseil ?
La secrétaire fit signe que oui et se hâta de dire :
— Oh ! monsieur Hogy ! J'espère que les choses vont s'arranger. Croyez-vous que je devrais appeler Mme MacOgwascher pour lui dire que vous rentrez ?
— Oh ! surtout pas. Ma femme se tourmente déjà bien assez à mon sujet, mais je pense que vous feriez bien d'appeler mon chauffeur et de lui dire d'amener la voiture. Je descendrai et l'attendrai dans le hall ; demandez-lui d'entrer dès qu'il arrivera.
Hogy s'attarda à regarder quelques papiers ; puis, d'un geste impulsif, les ramassa et les mit dans le coffre resté ouvert. Il jeta un coup d'œil à sa montre, regarda autour de lui et ferma le coffre. Puis ayant donné un tour de clef à chacun des tiroirs de son bureau, il se décida à descendre les escaliers.
Hogy vivait dans une des nouvelles banlieues, à environ dix-huit milles (29 km) de son bureau. C'était un quartier qui avait connu un récent développement. Cette banlieue, il la parcourait généralement, à l'aller et au retour, la tête enfouie dans ses dossiers, sans lui accorder jamais le moindre regard ; mais aujourd'hui, et pour la première fois, il prenait le temps de s'intéresser à la vie autour de lui.
Je suppose, pensa-t-il en lui-même, que tout comme mon père j'aurai bientôt fini de vivre et que le monde continuera sans moi.
— Oh ! Hogy ! s'écria Mme MacOgwascher, je préfère appeler le médecin tout de suite. Je pense qu'il vaut mieux que tu voies le Dr Robbins ; il te connaît mieux que n'importe quel autre.
Elle partit téléphoner et obtint tout de suite la secrétaire qui, de la manière propre à la profession commença par répondre de façon distante et autoritaire :
— Oh ! mais le docteur est très occupé ; il faudra que votre mari vienne au cabinet. Le docteur ne peut pas se déranger.
— Très bien, mademoiselle, dit Mme MacOgwascher qui savait comment parler à ce genre de personne ; si vous n'êtes pas capable de prendre un message, je vais joindre la femme du docteur. Je suis une amie de la famille.
Hogy passa à table, mais fit peu d'honneur au repas. Il n'avait nulle envie de manger ; il ne se sentait pas très bien et craignait qu'un repas abondant ne fatigue son cœur. Puis il se leva de table.
— Je vais me mettre au lit, dit-il. Je pense que le Dr Robbins ne tardera pas trop à venir. Drôles de gens que les médecins — pas très concernés par l'inquiétude de leurs malades. Tout ce qu'ils veulent de nos jours, c'est leur partie de golf et voir rentrer les chèques.
Et sur ces mots, il se dirigea vers l'escalier qu'il monta pesamment. Une fois dans sa chambre, il vida ses poches, mit la petite monnaie sur la table de chevet, puis plia ses vêtements avec soin ; il revêtit un pyjama propre — il attendait le docteur ! — et se mit au lit. Il resta à penser à son père et à la similitude de leurs deux destinées.
— Sainte Vierge, Mère de Dieu, lança Hogy, soyez avec nous à l'heure de notre mort.
À cet instant précis il entendit le bruit lointain de la sonnette et celui de pas précipités. On ouvrit la porte ; il y eut une conversation à voix basse, puis la femme de chambre monta l'escalier en courant.
— C'est le docteur, monsieur. Dois-je le faire monter ?
— Oui, je vous en prie.
Le docteur entra et, après quelques mots de salutations, sortit son stéthoscope et ausculta Hogy.
— Vous faites une autre attaque d'angine de poitrine. Mais on vous en sortira, monsieur MacOgwascher, comme on vous en a déjà sorti. Je vous demanderai simplement de ne pas vous faire de souci.
S'asseyant au bord du lit, il répéta à Hogy que le symptôme de l'angine de poitrine était grave et que le malade croyait toujours qu'il allait en mourir.
— Mais tous les gens doivent disparaître un jour ou l'autre — même les médecins. Un docteur n'a pas le pouvoir de se faire vivre. Nous devons tous mourir et j'ai été témoin de la mort de tant de gens. Je puis vous assurer que votre heure n'a pas encore sonné.
II se tut, fit une petite moue et reprit :
— Je pense cependant qu'il serait préférable d'avoir auprès de vous une infirmière de jour et de nuit. Vous seriez rassuré, de même que votre femme qui est très inquiète — sans raison — dirai-je. Voulez-vous que je m'occupe de cette question d'infirmières ?
— Je pense que vous êtes le mieux placé pour le faire et je vous en remercie sincèrement. Sans doute voulez-vous le même arrangement que celui qui avait été décidé pour mon père — deux infirmières de jour et une de nuit ? Je vous serais très reconnaissant de vous charger de ce problème.
Un peu plus tard une infirmière entrait dans la chambre de Hogy. Sa vue l'effraya — une vieille chose à l'air revêche. Pourquoi pas une minette un peu gentille, pensa-t-il. Ce serait plus agréable. Mais la femme semblait efficace, mettant de l'ordre dans la chambre, remuant tout. Toujours la même chose avec les femmes, se dit Hogy ; elles chambardent tout, déplacent tout et le pauvre type ne retrouve plus rien. Enfin ! C'est la rançon de devoir garder le lit et il vaut mieux s'en accommoder.
La nuit fut pénible. Il souffrit, reçut ses médicaments et la douleur persista. Il lui sembla que la nuit ne finirait jamais ; puis les premières lueurs du jour commencèrent de percer entre les lamelles du store vénitien. Il avait l'impression de n'avoir jamais passé une nuit aussi atroce. Sa femme était à peine auprès de lui qu'il lui exprima le désir de voir le père le jour même.
— J'ai besoin de lui parler, et peut-être de me confesser.
Sa femme le quitta et alla téléphoner au prêtre catholique. Il y eut une longue conversation sur un ton lugubre, puis il l'entendit qui disait :
— Oh ! je suis si contente, mon père, et mon mari sera ravi de savoir que vous allez venir le voir.
Le prêtre arriva juste après le thé. Hogy pria l'infirmière de se retirer et tous deux restèrent en tête à tête :
— Je vous assure, monsieur MacOgwascher, que vous avez été un excellent Catholique, dit le prêtre, et ne devez avoir aucune inquiétude concernant la vie future. Quand votre heure sera venue de quitter ce monde, soyez certain que vous irez tout droit au Paradis. Vous avez fait beaucoup de bien pour l'Église et je joindrai mes prières aux vôtres.
Il se mit à genoux au milieu de la chambre en disant d'une voix morne :
— Voulez-vous que nous priions ensemble ?
Hogy fit signe que oui. Mais ce genre de choses l'embarrassait toujours ; il pensait à son père, un bon vieux Juif qui n'avait jamais eu honte de l'être, alors que lui avait renié sa propre foi. Il se souvenait avoir lu quelque part qu'on ne doit jamais changer de religion sans de très graves raisons. Et il n'estimait pas que l'avoir fait — comme lui — pour un motif de statut social, ait été une raison valable !
Il ne dormit pas beaucoup, cette nuit-là, et resta à penser. La douleur avait beaucoup diminué et cependant il ne se sentait pas bien. Son cœur avait un rythme étrange. Il avait l'impression qu'il battait à CONTRE-RYTHME. Mais il demeura immobile, regardant le ciel nocturne et les arbres tout proches de la fenêtre. Il s'émerveilla des voies de la vie, s'étonna de celles de la religion. Selon les enseignements qu'il avait reçus, sa seule chance d'aller au ciel impliquait qu'il embrasse la doctrine de Jésus-Christ. Il s'interrogea, se demanda ce qu'il était advenu de tous ceux qui avaient vécu sur Terre pendant des milliers d'années avant la venue du Christianisme — de même, que s'était-il donc passé pour les millions de gens qui n'étaient pas Chrétiens ? Y avait-il quelque vérité dans la croyance que seul un Catholique pouvait aller au Paradis ? Tout en pensant, il glissa vers le sommeil et dormit profondément.
Durant les quelques jours qui suivirent, Hogy sembla aller beaucoup mieux. Le docteur était très satisfait de l'état de son patient.
— Eh bien ! monsieur MacOgwascher, lui dit-il, vous allez bientôt quitter le lit et partir prendre un repos bien nécessaire. Avez-vous décidé où vous iriez en vacances ?
Hogy y avait vaguement pensé, mais n'avait pu se décider. Où irait-il ? À dire vrai, il n'avait envie d'aller nulle part. Il se sentait las, terriblement las. Et s'il souffrait beaucoup moins, il n'était cependant pas bien. Il avait toujours une sensation étrange dans la poitrine. Mais le docteur affirmait qu'il allait mieux, les infirmières ainsi que sa femme le disaient aussi, et au cours de la visite qu'il lui fit le père rendit grâce au Seigneur qui lui avait permis de se rétablir.
Puis vint le jour où Hogy eut le droit de se lever. Ayant revêtu une robe de chambre chaude, il resta pendant un moment près de son lit à regarder à travers les vitres, observant la circulation et les voisins qui — tout comme lui — regardaient en écartant légèrement leurs rideaux. Las de rester dans sa chambre, il décida de descendre au rez-de-chaussée.
À pas lents, il gagna la porte et éprouva de la difficulté à l'ouvrir. Il tenait la poignée qui semblait se refuser à fonctionner. Fallait-il la tourner en la poussant ou en la tirant ? Il resta là à batailler avec cette porte qui finit par s'ouvrir, mais si soudainement qu'il faillit tomber à la renverse.
Avec précaution il avança au long du corridor recouvert d'une moquette, et arrivé au haut de l'escalier il posa le pied sur la première marche, puis la seconde, et soudain il poussa un cri. La douleur avait été si foudroyante qu'il crut qu'on venait de le poignarder. Il se retourna en cherchant à comprendre et, dans ce mouvement, perdit l'équilibre et tomba la tête la première.
Le docteur, fort heureusement, venait justement pour le voir. Il se précipita vers lui, ainsi que Mme MacOgwascher et la femme de chambre. Tous se retrouvèrent au bas de l'escalier avec Hogy étendu à leurs pieds. Le docteur se baissa, ouvrit la robe de chambre de Hogy et se saisit de son stéthoscope qu'il lui appliqua sur la poitrine.
Puis, d'un geste rapide, il fouilla dans son sac. À l'intérieur — le Dr Robbins était un médecin vigilant — se trouvait une seringue hypodermique déjà préparée. Hogy eut conscience qu'on lui faisait une piqûre, puis tout bascula et il ne sut plus rien.
Il y avait un bruit étrange, comme celui d'un bourdonnement, puis c'était comme un cahotement et un balancement. Quelque part, il y avait aussi des voix qui murmuraient très doucement. Hogy ne comprenait pas ce qui se passait. Puis, entendant le bruit aigu d'un klaxon, il ouvrit les yeux. Il était dans une ambulance, et maintenu sur une civière. Sa femme était assise auprès de lui. Il pensa qu'elle était bien piteusement installée ; cette constatation l'amena à se demander pourquoi ces ambulances accordaient si peu d'importance au confort des amis ou parents du patient.
Une autre chose, également, attira son attention. C'était ce que la vue, de l'ambulance, avait d'étrange : on descendait l'autre côté de la colline les pieds plus haut que la tête, puis on remontait l'autre côté de la colline... l'impression d'être sur une bascule. Vues de cette façon, les choses avaient un air bien curieux. Et quand l'ambulance s'arrêtait aux feux de croisement, les passants regardaient avec avidité à travers les vitres de l'ambulance dans l'espoir de satisfaire leur curiosité morbide. Il lui sembla que d'étranges couleurs flottaient autour de certaines personnes, mais il ne s'attarda pas à en chercher le pourquoi. Ses pensées glissaient simplement d'un sujet à l'autre. Soudain il y eut comme un fracas à l'avant de l'ambulance et le véhicule s'engouffra dans un tunnel, puis s'arrêta brusquement. L'ambulance était à peine immobilisée que déjà le chauffeur et son aide avaient sauté à terre et ouvraient la portière. Ils aidèrent d'abord sa femme à sortir, puis tirèrent le brancard, et actionnèrent un mécanisme qui le fit s'élever d'environ quatre pieds (1,2 m) ce qui permit de le pousser aisément. Un infirmier murmura à la femme de Hogy :
— Entrez dans ce petit bureau ; vous devez donner toutes sortes de renseignements concernant les assurances, l'âge, la nature de la maladie, le nom du docteur, numéro de sécurité sociale, et autres. Une fois cela fait, vous monterez salle XYZ.
Saisissant le brancard à chaque extrémité, ils le poussèrent vers une sorte de rampe — comme il en existait dans l'usine de Hogy. L'endroit était assez faiblement éclairé, mais connaissant le chemin, ils poussèrent le brancard d'un pas allègre, saluant au passage infirmières et internes.
Hogy était couché sur le dos, regardant, l'esprit engourdi, et s'interrogeant vaguement sur ceci et sur cela. Le brancard s'arrêta brusquement ; Hogy vit qu'un des infirmiers pressait un bouton — celui de l'ascenseur sans doute. Il avait raison. Presque immédiatement les grandes portes s'ouvrirent et les deux ambulanciers poussèrent le brancard à l'intérieur. Les portes se refermèrent avec un claquement et l'ascenseur démarra. La montée sembla interminable, puis les portes s'ouvrirent enfin et une lumière agressivement violente les accueillit. Avec difficulté et en clignant des yeux, Hogy parvint à voir la scène devant lui — le poste des infirmières situé juste à l'extérieur des ascenseurs.
— Urgence. Cas cardiaque. Où dois-je le mettre ? demanda l'un des hommes.
— Oh ! lui ! Attendez une minute. Voyons voir... oui, ça y est, répliqua l'infirmière assise derrière son bureau. J'ai trouvé... vous le mettez au bloc des soins intensifs.
Les ambulanciers firent un signe de la tête et s'en allèrent en poussant le brancard au long d'un petit couloir. On entendit des bruits de voix en sourdine, le son d'instruments qui s'entrechoquaient métal contre verre — puis les hommes tournèrent brusquement le brancard et l'arrêtèrent. Hogy jeta un regard autour de lui sans grande curiosité. L'endroit avait l'air bizarre — une très grande chambre contenant peut-être une douzaine de lits, mais ce qui le surprit ce fut de découvrir que cette salle était mixte. Cette situation l'inquiéta. La pensée de devoir coucher au milieu de femmes l'embarrassait terriblement. Il marmonna quelque chose et l'infirmier se baissa vers lui en disant :
— Quoi ?
— Je ne savais pas qu'ils avaient des salles mixtes — qu'on mélangeait les hommes et les femmes, répéta Hogy.
L'ambulancier éclata de rire en disant :
— Oh ! vous êtes aux soins intensifs. Les hommes et les femmes qui sont là sont trop malades pour penser à CELA ! (On s'agita à nouveau ; il y eut des murmures inintelligibles et son brancard fut amené le long d'un lit.) Nous y voilà, dit l'un des infirmiers. Pouvez-vous vous glisser vous-même sur le lit ?
Hogy secoua la tête négativement.
— C'est bien, dit l'un des infirmiers, on va vous aider. Le lit est à peu près de la même hauteur que le brancard.
Hogy une fois installé, les deux hommes quittèrent le bloc spécial en emmenant le brancard. Une infirmière leva les deux côtés du lit qui se transforma en une espèce de cage.
— Je ne suis pas un animal dangereux, vous savez ! dit-il.
— Oh, que ceci ne vous inquiète pas ! répondit l'infirmière. Ce n'est qu'une précaution. Si le malade venait à tomber, nous pourrions avoir de gros ennuis.
Puis elle revint en disant :
— Soyez patient, le docteur va vous voir dès qu'il le pourra.
Hogy resta là — il n'aurait pu dire pendant combien de temps — et en levant les yeux il prit vaguement conscience que sa femme le regardait, puis sembla disparaître l'instant suivant dans une sorte de brouillard. Ce fut ensuite l'impression que des gens étaient autour de lui, qu'on déboutonnait son pyjama ; il sentit le froid du stéthoscope sur sa peau, éprouva la sensation d'aiguille dans le bras et la vision imprécise de tubes allant de son bras à quelque chose — QUELQUE CHOSE — qu'il ne pouvait voir. Il y eut une forte pression autour de son autre bras et le bruit d'une pompe. Un homme lut quelques chiffres à haute voix. Puis tout s'évanouit.
Le temps s'arrêta. Il cessa d'exister. Hogy était très vaguement conscient qu'on bougeait des lits, ou peut-être était-ce des brancards qu'on roulait ; conscient également de bizarres tintements et surtout d'odeurs atrocement agressives.
Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Tout était flou, imprécis. Deux personnes parlaient ; étaient-elles à côté de lui ou au-dessus de lui ? Il crut entendre :
— Pacemaker ? Je ne sais pas ; peut-être vaudrait-il mieux être prêt pour le choc cardiaque. Tout cela a un air qui ne me plaît guère. Cependant, il va probablement se remettre. De toute façon, risquons le coup.
Les voix s'éloignèrent, puis s'évanouirent comme une brise qui passe. Hogy replongea dans la somnolence et en fut partiellement arraché par une voix qui demandait :
— Eh bien, monsieur MacOgwascher, comment vous sentez-vous maintenant ? Vous allez mieux ? Monsieur MacOgwascher ? Monsieur MacOgwascher ? M'entendez-vous ? Monsieur MacOgwascher, répondez-moi, êtes-vous là, Monsieur MacOgwascher ? Oh là là, continuait la voix, il faut maintenant que je vous fasse une prise de sang et je n'arrive pas à trouver cette diable de veine !
— Essayez une bande plus large, dit une autre voix. Quelquefois ça marche mieux.
On s'agitait à son chevet, on lui tirait le bras et on le serrait au point que ses doigts lui donnaient l'impression de devoir éclater ; puis il y eut une violente sensation de piqûre et la voix s'exclama :
— Je l'ai cette fois. Tout va bien !
Le silence revint dans la salle, l'agitation diminua progressivement. À l'extérieur, une horloge sonna : un — deux — trois — et ce fut tout. Trois heures ? "Du matin ou de l'après-midi ? se demanda Hogy. Ma foi, je ne sais plus où j'en suis. Que m'arrive-t-il ?"
Puis les voix se firent entendre à nouveau.
— Croyez-vous, mon père, qu'il devrait recevoir l'extrême-onction ? demandait une voix douce. Il nous faudra y songer, car les signes ne sont pas fameux.
Hogy essaya d'ouvrir les yeux. C'était très étrange ; il avait l'impression qu'un homme noir se tenait au-dessus de lui. Il se demanda s'il pouvait être au Paradis en compagnie d'un saint noir, mais il s'aperçut alors qu'un aumônier de l'hôpital était penché sur lui.
Le temps passa. La salle était faiblement éclairée et de petites lumières provenant d'étranges machines s'allumaient puis s'éteignaient sans discontinuer. Sans voir très clairement, Hogy pouvait cependant distinguer qu'il y en avait des jaunes, des vertes et des rouges également et, de temps à autre, une blanche apparaissait. Quelque part, à l'extérieur, un oiseau commença de chanter. Presque aussitôt ce fut le bruit feutré de sandales et plusieurs infirmières entrèrent dans la salle. Il y eut quelques échanges à voix basse, puis l'équipe de nuit s'en alla. Les infirmières circulèrent parmi les lits, demandant des informations concernant les patients, et on entendit le bruit des fiches qu'elles retournaient devant chaque lit. Une infirmière vint auprès de Hogy et se pencha pour le regarder.
— Ah ! vous avez l'air mieux, ce matin, monsieur MacOgwascher, dit-elle.
Ce qui le laissa perplexe, car elle ne l'avait jamais vu auparavant. Bien sûr, se dit-il, elle ne l'avait pas vu puisqu'elle était de service la nuit. Elle donna une petite tape sur les draps et se dirigea vers un autre patient.
Le jour se leva et sa lumière, maintenant, pénétrait la chambre. À l'extérieur, le soleil monta graduellement pour devenir le globe rouge et brillant qui allait dissiper les brumes.
Avec le jour, l'activité gagna la salle. On fit la toilette de certains patients, tandis que d'autres étaient nourris par intraveineuse ou par la voie naturelle. Puis ce fut le tour de Hogy : une infirmière vint lui faire une prise de sang, et une autre prit sa tension artérielle ; elles furent suivies du docteur qui s'avança en disant :
— Tout va bien pour vous, monsieur MacOgwascher. Vous serez bientôt d'aplomb.
Cela dit, il s'éloigna.
Des heures — ou étaient-ce des jours — passèrent et Hogy put enfin s'asseoir dans son lit. Les infirmières vinrent lui annoncer :
— Nous vous déplaçons, monsieur MacOgwascher ; nous allons vous installer dans une chambre privée, car vous n'avez plus besoin d'être dans le bloc des soins intensifs. Avez-vous des choses dans l'armoire là-bas ?
— Non, répondit Hogy, je n'ai que ce que je porte actuellement.
— Bon. Alors nous allons vous pousser. Tenez-vous bien.
Elles libérèrent les freins du lit et le roulèrent soigneusement avec l'appareil d'intraveineuse toujours fixé. Et comme ils arrivaient à la porte, il vit qu'on roulait un autre lit à la place que le sien avait occupée.
Hogy promena autour de lui un regard intéressé comme font tous ceux qui ont vécu en reclus ou isolés dans une salle d'hôpital. La chambre où on l'amena lui parut plaisante, avec une fenêtre et un poste de télévision. Sur un des côtés, il y avait un petit recoin avec un lavabo. Et là, tout près, on trouvait le bouton d'appel d'urgence ; Hogy fut très satisfait en découvrant que de son lit il pouvait, grâce à un dispositif, actionner la radio ou la télévision et choisir ses programmes.
Les infirmières tournèrent son lit de façon à le placer en bonne position, le bloquèrent avec la pédale de frein, puis l'une après l'autre sortirent de la chambre.
Hogy resta étendu, regardant autour de lui et se demandant ce qui allait suivre. Il croyait comprendre que, dans le corridor, fonctionnait une sorte de système d'appel — sans doute à l'adresse des médecins continuellement demandés à un étage ou à un autre. En écoutant, il remarqua que le nom de son propre docteur revenait fréquemment et, soudain, qu'il était appelé à la chambre une telle — qui était justement la sienne. Il s'étendit sur le dos et attendit. Le docteur arriva environ une heure plus tard.
— Alors, monsieur MacOgwascher, j'espère que vous vous sentez mieux. De toute façon vous avez l'air incomparablement mieux. Vous savez que vous nous avez fait très peur.
Hogy lui jeta un regard abattu et répondit :
— Je n'arrive pas très bien à me concentrer, docteur, je me sens comme dans un brouillard. J'ai peine à rattacher les choses entre elles. Par exemple, vous avez été appelé pour venir dans cette chambre il y a environ une heure de cela, et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre que ce devait être parce que j'ai été retiré des soins intensifs de façon plutôt inattendue.
— Oui, c'est exact, répondit le Dr Robbins. Nous avons eu un très grave accident. Il nous a fallu installer dans le bloc en question beaucoup de gens très grièvement blessés — et vu que votre état s'est nettement amélioré, nous avons pensé qu'on pouvait vous mettre ici, où vous seriez seul, plutôt que d'être parmi un grand groupe d'hommes et de femmes au bloc des soins intensifs.
Hogy dit en riant :
— J'ai demandé à une infirmière la raison pour laquelle les hommes et les femmes étaient dans la même salle ; elle m'a répondu que cela n'avait aucune importance vu que les gens soignés dans ce bloc étaient dans un état de santé qui ne leur permettait pas de penser à CELA. Comme elle avait raison, comme elle avait raison !
À la tête de son lit et incorporés dans le mur, Hogy remarqua de nombreux appareils servant, l'un à contrôler le sang, l'autre à envoyer de l'oxygène, et divers autres systèmes dont il ne comprenait pas la signification, mais qui l'intéressèrent quand il vit le docteur s'en servir pour procéder à un examen complet.
— Vous vous en sortirez, monsieur MacOgwascher, vous vous en sortirez, dit le docteur. Votre femme est ici, et je pense qu'elle aimerait vous voir. Elle s'est beaucoup inquiétée, vous savez.
Le docteur se retira, le silence retomba pendant un moment puis, levant les yeux, Hogy vit sa femme debout auprès de lui, les mains crispées l'une contre l'autre et montrant un pauvre visage misérable.
— Le père vient te voir cet après-midi, lui dit-elle. Il pense que tu as peut-être besoin d'un peu de consolation spirituelle. Il me dit que tu as terriblement peur de mourir bien que — Dieu merci — tu n'aies pas à penser à cette éventualité. Le docteur m'a affirmé que tu n'allais pas tarder à rentrer à la maison, mais que tu devrais te reposer pendant un certain temps.
Pendant un moment, ils s'entretinrent de choses anodines et d'autres plus importantes qu'ont à aborder un mari et une épouse dans les périodes difficiles de leur vie. Quand tout va bien, on oublie de songer aux choses graves. Hogy tenait à s'assurer que son testament était en sécurité, ses polices d'assurances bien arrivées ; ensuite il suggéra à sa femme que son principal assistant devienne directeur de l'usine.
Le père vint lui rendre visite dans l'après-midi et Hogy lui dit :
— Oh ! père, j'ai si peur de mourir. C'est quelque chose de si incertain. Je ne sais vraiment pas quoi faire.
Comme la plupart des prêtres et des ecclésiastiques, le Père débita tout un chapelet de platitudes, puis se retira dès qu'il put décemment s'échapper — et non sans avoir extorqué à Hogy la promesse de signer un beau chèque bien dodu pour l'Église dès que son état lui permettrait d'écrire.
L'après-midi s'écoula, faisant place à la soirée, à laquelle succéda l'obscurité de la nuit. La ville alluma ses lumières qui vinrent jouer sur les murs de la chambre de Hogy en y dessinant d'étranges formes. Comme fasciné, il regarda ces ombres et tissa autour d'elles un monde imaginaire ; puis il glissa dans le sommeil.
Le téléphone sonnait avec insistance et son bruit avait quelque chose de particulièrement dur et métallique pour une femme qu'on réveille au milieu de la nuit avec un mari à l'hôpital et dangereusement malade. Mme MacOgwascher s'assit dans son lit cherchant à atteindre l'appareil.
— Madame MacOgwascher ? demanda une voix à deux reprises.
— Oui, c'est elle-même. Qu'y a-t-il ?
La voix répondit sur un ton grave :
— L'état de votre mari a soudainement empiré. Le docteur pense que votre présence à l'hôpital est indispensable et que si vous avez des parents vous feriez bien de les emmener avec vous. Mais veillez à ne pas conduire trop vite, car dans ces situations-là les gens ont tendance à oublier toute prudence. Pensez-vous pouvoir être là dans une heure ?
— Oh ! Dieu, une heure ! s'exclama Mme MacOgwascher. Oui. Nous allons faire aussi vite que possible.
Elle raccrocha et sortit du lit. Elle enfila une robe de chambre et s'en alla frapper à grands coups à une porte située un peu plus loin dans le couloir.
— Mère, mère ! réveillez-vous. Hogy est en train de passer, il faut qu'on parte tout de suite pour l'hôpital. Êtes-vous réveillée, mère ? (La porte s'ouvrit et une vieille dame apparut. C'était la mère de Hogy.)
— Je m'habille immédiatement, dit-elle. Faites de même.
Levant les yeux, Hogy sursauta. Sa mère et sa femme étaient à son chevet. Était-ce bien sa mère et sa femme ? Il n'arrivait pas à décider. Et qui étaient donc ces autres personnes ? Certaines semblaient flotter dans l'air en souriant avec bienveillance. Et alors — les yeux de Hogy s'ouvrirent tout grands — il vit un ange de l'autre côté de la fenêtre. L'ange était vêtu d'une longue robe blanche, et ses ailes battaient comme celles d'un jouet mécanique. C'est du moins ce que pensa Hogy. L'ange le regarda, sourit, puis lui fit un signe comme s'il l'appelait. Hogy mourait d'envie de le suivre.
C'était une sensation tout à fait particulière. L'obscurité gagnait la chambre. Il lui semblait voir des ombres pourpres et comme veloutées, et dans ce velours pourpre il voyait des points de lumière, un peu comme les parcelles de poussière dans le soleil. Il regarda autour de lui : à sa droite se tenait sa femme, et sa mère sur sa gauche. Et que faisait donc cet homme en noir ? Il marmonnait. Oh ! oui, bien sûr — la mémoire revenait à Hogy — le prêtre était en train de lui administrer l'extrême-onction. Hogy fut incroyablement choqué en découvrant, à son très grand désarroi, qu'il pouvait lire les pensées du prêtre ; celui-ci se livrait à tout le grand jeu, espérant par là arracher à Mme MacOgwascher une donation pour l'Église. Dans l'esprit du prêtre, ces gens fortunés représentaient une belle petite somme. Aussi, ayant administré l'extrême-onction à Hogy, il se tourna immédiatement vers sa femme, pensant, tout en donnant sa bénédiction : "Voilà qui devrait bien me valoir une centaine de dollars."
Hogy commença à trembler. Il se sentit terriblement désemparé. Le lit lui sembla d'un matériau duveteux et lui donnait l'impression de ne pas pouvoir le contenir. Ses doigts s'accrochèrent désespérément aux draps ; il essayait de rester au lit parce que tous ses instincts l'exhortaient à s'élever, s'élever vers la lumière.
Il entendit une voix qui disait : "Il s'en va — il s'en va — il glisse", puis il y eut comme un étrange bruissement. Gagné par la terreur, il essaya de crier, mais il ne le put. Il s'imagina tel un cerf-volant. Baissant les yeux, il vit une sorte de corde argentée scintillante qui le reliait à un corps grotesque étendu sur un lit. Avec un sursaut de conscience, il comprit que ce qu'il était en train de regarder était son propre corps mort, ou agonisant. Il pouvait voir la tête de sa femme, celle du prêtre et celle de sa mère. Puis le docteur arriva en toute hâte. Il ouvrit le pyjama de Hogy et, bien inutilement, appliqua son stéthoscope. Il hocha la tête avec gravité. Avec ce geste théâtral, il remonta le drap pour recouvrir le visage de Hogy. Il fit le signe de la croix, le prêtre également, ainsi que les femmes.
— Venez avec nous, venez avec nous, lui murmuraient des voix. Abandonnez-vous, nous nous occupons de vous. Tout est bien, vous allez au ciel.
— Oui, au ciel, au ciel, reprirent en chœur d'autres voix.
Hogy eut l'impression de faire un petit bond et, instinctivement, regarda vers le bas. Il vit la corde argentée s'estomper, puis tomber. Avec une sensation de vertige, il se vit voler au-dessus de l'hôpital, au-dessus de la ville, s'élevant très rapidement. Regardant autour de lui, il s'aperçut qu'il était porté par quatre anges ; leurs ailes battaient et leurs regards pleins d'attention étaient posés sur lui. Ensemble ils se hâtaient à travers le ciel obscur, tandis que montait le chant :
— Nous allons au ciel, nous allons au ciel.
Chapitre Neuf
"Porté sur les ailes des anges. Eh bien, mon gaillard !" se dit Hogy en lui-même. Soudain il se sentit arraché violemment des bras des anges et descendre, descendre en pirouettant à travers l'obscurité vivante. La chute cessa aussi brusquement qu'elle s'était amorcée et Hogy eut l'impression de se comporter tel un yo-yo bondissant au bout d'un élastique. Complètement désorienté, avec cependant l'impression d'être ‘quelque part’, mais où ? Se tortillant, il vit alors — comme s'il regardait à travers un trou dans le plafond ou dans le sol — une scène absolument étrange.
Il regardait vers le bas dans ce qui était une Maison de Pompes Funèbres. Il fut pris de frayeur à la vue de corps nus gisant sur des tables spéciales et sur lesquels on pratiquait les choses les plus diaboliques. Chez certains on retirait le sang, chez d'autres on bouchait les ‘orifices naturels’ afin d'éviter des suintements et, dans un petit cabinet, il vit... SON PROPRE CORPS ! Le corps qu'il avait quitté. Il était sur une de ces curieuses tables, et sur lui une jeune femme était penchée avec une cigarette pendant à sa lèvre inférieure. Hogy bondit d'étonnement en remarquant qu'elle rasait le visage de son propre cadavre. Un homme se précipita vers elle en disant :
— Soignez bien ce que vous faites sur lui, Beth. M. MacOgwascher était quelqu'un de très important. Nous devons l'exposer cet après-midi. Il faut qu'il soit prêt ; aussi hâtez-vous. La femme fit un signe de tête et reprit son travail. Elle le rasa de très près, puis le maquilla. Elle lui brossa les cheveux — ce qui en restait — et passa un peu de teinture sur les mèches grisonnantes. Elle recula pour considérer le résultat, marcha jusqu'à la porte et appela :
— Eh ! patron, le refroidi en question est terminé. Vous venez le voir ?
Le patron se précipita avec un air furieux :
— Vous ne devez pas parler ainsi, Beth, vous ne devez pas. C'est le corps de M. MacOgwascher, un homme très important ici. J'exige que tous les corps soient traités avec respect.
— O.K., patron ! Il y en a certains pour lesquels vous n'avez pas autant de respect, rétorqua Beth. Je veux parler des refroidis que vous mettez dans la sciure et dont vous vissez le couvercle. Ceux-là, ils n'ont pas droit à beaucoup de respect, vous ne croyez pas ? Mais vous faites comme vous voulez ; c'est vous le patron. Et adieu, monsieur MacOgwascher, ajouta-t-elle tout en allant d'un air dégagé attaquer un autre client.
Hogy se détourna, stupéfait. Quand, après un temps dont il n'aurait pu définir la durée, il fut contraint de regarder vers le bas, il découvrit que son corps avait disparu et qu'un autre avait été apporté, enveloppé dans une masse de cellophane, ‘tel un paquet de blanchissage’, pensa Hogy. Il regarda avec intérêt le dépouillement de la cellophane et le corps qu'elle enveloppait. C'était celui d'une femme que le patron et son assistant déshabillèrent rapidement. Hogy, homme pudique, détourna son regard et, en le faisant, son champ visuel s'amplifia et lui permit alors de voir une des ‘Salles d'Exposition’. Il était là, présenté dans un luxueux cercueil et des gens se penchaient pour le regarder. Il vit qu'ils prenaient le café, et quelqu'un posa sa tasse sur le rebord de son cercueil. Hogy se regarda lui-même et décida qu'il ressemblait à une star de cinéma, maquillé, poudré, rasé comme il l'était et le cheveu teint. Dégoûté, il se détourna.
Le temps passa. Combien de temps ? Personne ne sait — deux ou trois jours probablement. Le temps n'a pas d'importance dans l'autre vie. Soudain, on le déplaça de l'endroit où on l'avait exposé. Il baissa les yeux et découvrit qu'il était dans un corbillard qu'on conduisait à l'église. Il vit des hommes le porter à l'intérieur de l'église et assista au service religieux — le prêtre montant en chaire pour prononcer l'éloge de Hogy MacOgwascher :
— Ce frère bien-aimé est maintenant dans les bras de Jésus recevant la récompense de ses vertus.
Hogy se détourna et quand il regarda de nouveau, c'était à cause d'un insistant tiraillement ; il s'aperçut qu'on le portait au cimetière. Là, se déroula un autre service, et quand une motte de terre vint tomber sur le cercueil, il fit un bond. Toutefois, sa sottise lui apparut en se rendant compte que son corps était ‘là, en bas’, et lui, ‘ici’. Mais après la mise en terre, Hogy se sentit libéré. Il s'éleva avec une force incontrôlable et, à sa grande surprise, il se trouva à nouveau dans les bras des anges. Leurs ailes, aussitôt, se mirent à battre et le sourire apparut sur leurs visages. Ils le portaient vers le haut ; il ignorait la direction qu'ils prenaient, mais ils voyageaient à très grande allure, à travers une obscurité qui semblait vivante, et faite de velours noir. À distance, une lumière apparut, une lumière dorée et glorieuse. Hogy concentra son regard dans la direction d'où venait la lumière. Les anges fonçaient vers l'avant et la lumière se faisait plus intense, brûlant par sa violence les yeux de Hogy qui avaient peine à la soutenir. Puis, alors que les anges émergeaient de ce qui avait paru être un long tunnel, Hogy vit les Portes du Paradis scintiller devant lui — de grandes grilles dorées, ornées de perles énormes. Un mur blanc partait de chaque côté des Grilles et à travers les barreaux, il pouvait voir d'immenses dômes de cathédrales et les flèches de belles églises.
Il y avait de la musique dans l'air, de la musique sacrée : ‘Demeure avec moi’, avec quelques mesures de ‘En Avant, Soldats Chrétiens’, provenant d'ailleurs. Ils approchèrent des Grilles, Hogy toujours porté par les anges dont les ailes battaient.
Saint Pierre, ou quelque autre saint, apparut à la grille et demanda :
— Qui vient de par le Seigneur ?
Un des anges répondit :
— M. Hogy MacOgwascher, défunt de la Terre. Nous demandons son admission.
Les Grilles s'ouvrirent toutes grandes et Hogy vit de près son premier saint, qui semblait vêtu d'une longue chose blanche ressemblant à une de ces chemises de nuit démodées descendant jusqu'aux chevilles. Il avait dans le dos une paire d'ailes qui s'agitaient facilement et de son dos partait aussi une sorte de baguette en métal luisant qui s'élevait un peu au-dessus de sa tête et se terminait par un Halo doré. Le saint regarda Hogy et Hogy regarda le saint qui lui dit :
— Vous devrez d'abord voir l'Ange qui tient le Registre afin de vous assurer que vous êtes bien autorisé à entrer. De ce côté, deuxième porte à droite.
Les anges saisirent de nouveau Hogy — il eut l'impression d'être entre les mains de livreurs — et leurs ailes se mirent à battre. Lentement, ils le portèrent au long d'une route lisse, toute bordée d'herbe et sur laquelle saints et habitants célestes étaient assis, jouant de la harpe. C'était une indescriptible cacophonie, car chacun jouait son propre morceau. Mais le bureau de l'Ange chargé du Registre était tout proche. Là, les anges mirent Hogy debout et le poussèrent gentiment en avant.
— Par là, dit l'un, donnez tous les détails — date de la mort et autres informations. Nous attendrons.
Hogy entra donc et vit un vieux saint à l'air bienveillant perché sur un tabouret. Ses ailes s'agitaient et il posa sur Hogy un regard de myope à travers ses lunettes à monture dorée. Puis, mouillant son pouce, il tourna les pages d'un immense livre tout en marmonnant ; il s'arrêta subitement en tenant la page de sa main gauche :
— Voilà j'y suis, s'exclama-t-il. Nom — Hogy MacOgwascher, mâle, mort inattendue. Oui, c'est vous. J'ai votre photo ici.
Hogy le regarda, muet. Tout le processus lui sembla bien particulier. Les ailes du vieux bonhomme s'agitaient en faisant un bruit de portes rouillées sur leurs gonds. Puis, faisant un geste du pouce par-dessus son épaule, l'Ange chargé du Registre dit à Hogy :
— Par là, la sortie. Ils vous attendent dehors. Ils feront ce qu'il faut pour vous.
Hogy se trouva en mouvement ; il avançait sans avoir à faire le moindre effort, et se retrouva dehors. Dès qu'ils le virent, ses aides mirent leurs ailes en marche tout en lui souriant et, s'emparant de lui, ils le soulevèrent dans les airs.
— Maintenant, il vous faut aller à l'Église, dit l'un.
— Oui, reprit l'autre. C'est préférable de se mettre au courant de ces choses dès le début.
Et sur ces mots, ils descendirent et entrèrent dans une Cathédrale au portail majestueux. L'intérieur était tout peuplé d'anges assis dont les ailes battaient au rythme de la musique. Ce spectacle qui ressemblait à une sorte de parodie le choquait de plus en plus, mais il assista au service qui fut interminable et tout au long duquel les anges agitaient leurs ailes, se signaient et s'inclinaient devant l'autel. Puis le service enfin s'acheva, les anges s'envolèrent comme une nuée de pigeons et Hogy demeura seul dans la Cathédrale vide.
Il promena autour de lui un regard étonné. Il était impossible que ce lieu fût le Paradis. On l'avait, depuis le début, induit en erreur. Cette histoire d'anges était une pure absurdité ; de même que ces gens chantant et allant à l'office tout le temps était une fable par trop stupide pour être crédible. Hogy venait à peine de décider que toute cette histoire était parfaitement ridicule quand il se produisit un bruit comme un coup de tonnerre, et du ciel une lumière descendit en cascade jusqu'au sol ; c'était comme si un grand rideau se déchirait et tombait. Hogy leva les yeux, étonné. Son père était là, venant vers lui en riant et en lui ouvrant les bras.
— Oh ! Hogy, mon garçon, tu t'en es tenu à ton illusion de religion pour un bout de temps, n'est-ce pas ? Peu importe, je m'en suis tiré de la même façon, à la différence que mon illusion m'a conduit à voir Moïse. Enfin, maintenant que tu es sorti de tout cela, nous pouvons être ensemble et bavarder. Viens avec moi, mon garçon, viens. Nous avons ici beaucoup d'amis et de parents qui veulent s'entretenir avec toi.
Et le père MacOgwascher le guida jusqu'à un très beau parc rempli de gens.
Le parc surpassait en beauté tout ce que Hogy avait vu dans sa vie — sa vie sur Terre, bien sûr. La couleur de l'herbe était d'un vert particulièrement plaisant, et les fleurs qu'il voyait étaient d'une espèce inconnue pour lui ; il savait que cette espèce n'était pas terrestre. Les sentiers étaient magnifiquement entretenus, dans une propreté et une ordonnance impeccables. Pour le ravissement de Hogy, et à son grand étonnement, des oiseaux chantaient dans les arbres et de petits animaux jouaient — chiens et écureuils — ainsi que d'autres animaux que Hogy n'avait jamais vus.
— Oh, père ! s'exclama-t-il, les animaux eux aussi viennent ici, à ce que je vois ?
Le père MacOgwascher dit en riant :
— Hogy, mon garçon, tu sais que tu ne dois plus m'appeler ‘père’, car on n'appelle pas un acteur par le nom qu'il avait dans une pièce. Une fois celle-ci terminée, il peut changer de rôle et changer de nom. Dans ma dernière vie sur Terre, j'étais ton père, mais dans quelque vie antérieure, tu as pu être le mien, ou peut-être même ma mère !
La tête du pauvre Hogy chavirait ; tout pour lui était si étrange.
— Mais alors, comment vais-je t'appeler ? demanda-t-il.
— Bon ! jusqu'à ce que les choses soient arrangées, disons que tu peux continuer à m'appeler ‘père’, si tu veux. Cela pourra nous éviter des complications, répondit Moses MacOgwascher.
Regardant son père, Hogy demanda :
— Mais dis-moi, où sommes-nous ? Ceci, logiquement, ne peut pas être le Paradis vu que tu es Juif et que les Juifs n'y sont pas admis.
Le père MacOgwascher éclata d'un rire sonore. Les gens regardèrent dans leur direction en souriant ; ce genre de choses était fréquent.
— Hogy, mon garçon, beaucoup des concepts qui ont cours sur Terre sont complètement erronés. Je suis Juif, dis-tu, eh bien, je vais te dire que j'étais Juif durant ma vie sur la Terre et que maintenant j'appartiens à la vraie, la seule religion qui est celle-ci : si tu crois en un Dieu ou en une religion, alors c'est une bonne religion. Ici, peu importe qu'on soit Juif, Catholique, Musulman, Protestant, ou autre. Mais la grande difficulté est que, lorsqu'on arrive ici la mémoire farcie de toutes les fables touchant à la religion qu'on nous a enseignée, on est tellement hypnotisé par ce qu'on s'attend à y voir, qu'on est incapable de voir quoi que ce soit. Sur Terre il y a des gens qui hallucinent tout le temps ; ils croient être ceci ou cela. Tu vas dans un hôpital pour affligés mentaux sur Terre et tu y trouves des malheureux qui se prennent pour Napoléon ou Jésus-Christ, et certains peut-être croient être Moïse. Ils croient vraiment qu'ils sont ce qu'ils prétendent être. Prends l'exemple de cet homme là-bas — il désigna quelqu'un à distance — c'est un nouvel arrivant auquel on avait appris, sur la Terre, qu'il aurait en allant au Ciel ce qu'il pourrait désirer, des danseuses à la douzaine, etc., etc. Il est là maintenant et vit dans un monde imaginaire. Il voit des danseuses partout, et jusqu'à ce qu'il réalise la fausseté de tout cela, personne ne peut l'aider. Il peut fort bien continuer ainsi pendant des années et des années à rêver de son Paradis à lui, peuplé de danseuses et de masses de nourriture. Dès qu'il aura compris son erreur — comme toi avec tes anges et leurs ailes — alors il pourra être aidé.
— Nourriture, oh ! père, nourriture ? dit Hogy. Là, tu viens enfin de dire quelque chose de vraiment sensé. Où peut-on trouver à se nourrir ici ? J'ai faim !
Le père MacOgwascher regarda son fils en disant :
— Hogy, mon garçon, tu devrais à présent avoir compris que tout ce que tu as apporté ici avec toi n'était qu'illusion — tu es venu ici pensant que tu étais au Paradis avec des anges jouant de la harpe ou chantant des hymnes, mais tu comprends à présent que ce n'était qu'illusion. Il en est de même avec notre ami là-bas qui se croit entouré de jeunes danseuses ; pure imagination, tout comme pour tes anges. De la même façon, si tu veux de la nourriture, eh bien ! imagine-la. Tu peux contrôler ton imagination et avoir n'importe quelle nourriture — rôti de bœuf, si tu veux, ou hot dogs, ou encore une bouteille de whisky. Ce ne sera, bien sûr, qu'illusion, mais si tu vas jusqu'au bout de l'absurdité consistant à vouloir de la nourriture, alors tu devras jouer le jeu logiquement. Si tu absorbes de la nourriture, il te faudra l'éliminer un peu plus tard et ce processus normal d'élimination implique pour toi d'imaginer le problème des toilettes ; imaginer, imaginer — ce n'est que cela. Tu ne feras aucun progrès aussi longtemps que tu resteras attaché aux choses stupides du monde.
— Oui, mais j'ai faim. Et ce n'est pas une affaire d'imagination. J'ai vraiment faim et si je ne suis pas autorisé à obtenir de la nourriture — sous prétexte que c'est une illusion — comment vais-je faire pour calmer ma faim ? (Hogy parut très irrité.)
Le père MacOgwascher répondit avec douceur :
— Bien sûr que tu as faim, parce que tu es victime d'un rythme de vie terrestre, de repas pris avec régularité. Mais si au lieu de t'imaginer absorbant de la viande morte tu penses à des vibrations saines, alors tu n'auras plus faim. Réfléchis, Hogy : tu es entouré d'énergie vibrante et elle se déverse en toi de partout. Dès que tu comprendras que ceci est ta nourriture, ta subsistance, tu cesseras d'avoir faim. L'action qui consiste à imaginer aliments et boissons est une marche en arrière qui retardera beaucoup tes progrès.
Hogy réfléchit au problème et s'apprêtait à protester, mais constata que soudain il n'avait plus faim !
— Père, dit-il, tu n'as pas du tout changé, tu es exactement le même que lorsque tu étais sur Terre. Comment est-ce possible ? Tu es là depuis pas mal de temps, tu devrais avoir l'air plus âgé et, de toute façon, comme tu n'es probablement plus qu'une âme maintenant... Ah ! tout ceci me trouble tellement que je ne sais plus que croire ni que faire.
Un sourire de compassion apparut sur le visage de son père.
— Tu sais, mon garçon, que nous passons tous par là. Certains sont capables d'une rationalisation plus rapide, mais supposons que je te sois apparu sous l'aspect — disons — d'une jeune femme ou d'un jeune homme, m'aurais-tu reconnu comme la personne que tu connaissais sur Terre ? Si j'étais venu à toi en te parlant avec une voix différente, avec des traits et une apparence physique différents, tu aurais pensé que j'étais quelqu'un qui te jouait un tour pour gagner ta confiance. C'est pourquoi je t'apparais ici tel que je suis dans ton souvenir et je te parle avec la voix que tu m'as connue. De la même façon, tes amis et tes parents qui sont ici t'apparaîtront tous comme des personnes familières que tu connaissais sur Terre ; elles t'apparaîtront comme telles, parce que tu ne vois que ce que tu veux voir. Si je regarde M. X, je le vois d'une certaine façon, et à ma manière, qui peut être totalement différente de la tienne. Prends deux personnes qui se font face, l'une des deux tenant une pièce de monnaie ; l'une verra le côté pile et l'autre le côté face ; c'est pourtant la même pièce de monnaie, mais elles en verront chacune un aspect différent. C'est comme ça ici, et c'est comme ça aussi sur Terre. Nul ne sait au juste comment on voit une autre personne. La chose n'est jamais discutée, on n'y pense jamais. Ainsi, ici, nous apparaissons aux autres tels que sur Terre.
Tout en écoutant, Hogy avait laissé errer son regard à travers le parc et il sursauta de stupéfaction en voyant sur un très joli lac des gens qui se promenaient en bateau à rames. Assis sur le banc du parc, Hogy fixait des yeux la scène. Le père Hogy se tourna vers lui en disant :
— Et pourquoi ne se divertiraient-ils pas, Hogy ? Ils ne sont pas en enfer, mon garçon ; ils font ce qu'il leur plaît de faire — et c'est bien agréable de se trouver dans une telle situation. Ici, ils peuvent imaginer un bateau, aller sur la rivière et profiter de certaines des sensations, bien que grandement accrues ici, qu'ils appréciaient tant sur Terre.
Pendant un certain temps Hogy demeura sans pouvoir répondre ; il était trop stupéfait, trop abasourdi. Il s'écria finalement :
— Mais je croyais que nous n'étions que des esprits, des âmes mouvantes. Je pensais que nous nous déplacerions en chantant des hymnes et en récitant des prières. Ceci ne ressemble en rien à l'idée que je me faisais du Paradis.
— Mais, Hogy, Hogy, tu n'es pas au Paradis, tu es dans une différente dimension où tu peux faire des choses que tu ne pouvais faire sur Terre. Tu es ici dans une sorte de station à mi-chemin. Certaines personnes, en mourant, éprouvent un considérable traumatisme, tout comme il peut arriver aux bébés au moment de leur naissance sur Terre. Ceux-ci doivent parfois être délivrés à l'aide d'instruments, ce qui leur occasionne certains dommages. Il en est de même avec la mort. Certaines personnes, en particulier si elles ont mené une mauvaise vie, ont du mal à surmonter, à se libérer des chaînes de la Terre. Un petit exemple est ton insistance à vouloir de la nourriture ; tu n'en as aucun besoin.
Hogy baissa les yeux sur lui-même et dit :
— Corps — corps. Si nous sommes des âmes, pourquoi avons-nous ces corps ? Pourquoi en avons-nous besoin ?
Le père MacOgwascher sourit et dit :
— Si tu pouvais apparaître sur Terre maintenant, tu serais un fantôme, ou bien plus probablement tu serais tout à fait invisible pour les gens ; ils marcheraient à travers toi et tu marcherais à travers eux, à cause de la différence de vibration. Ici, tu me vois, tu peux me toucher, je suis solide pour toi, et tu l'es pour moi ; notre être doit avoir une sorte de véhicule, n'est-ce pas ? Nous sommes venus de la Terre et avons maintenant un corps différent, sur ce plan intermédiaire. Nos corps ont encore une âme ; l'âme monte tout en haut jusqu'au Sur-Moi qui est plusieurs plans au-dessus. Ici, nous avons un corps afin d'apprendre encore, comme sur Terre, à travers la souffrance, bien qu'ici elle soit de nature beaucoup plus bénigne. Mais même quand nous atteignons — disons — la neuvième dimension, nous avons encore un corps, convenant à la neuvième dimension. Si une personne venait vers nous, descendant de cette dimension en question, elle ne nous serait pas visible, et vice versa, pour la simple raison que nous serions complètement différents. Nous progressons d'un plan à un autre, et où que nous soyons, peu importe le plan, peu importe les conditions, nous avons toujours un corps convenant à ces conditions.
Le père MacOgwascher éclata de rire avant de dire :
— Tu crois me parler, Hogy, mais tu ne me parles pas ; tu communiques par télépathie. Nous n'utilisons pas la parole, ici, si ce n'est dans des situations très inhabituelles. Nous nous servons plutôt de la télépathie. Mais nous devons partir, mon garçon. Il nous faut nous rendre au Hall des Souvenirs et dans ce Hall, toi, et toi seul y verras tout ce que tu as fait et te proposais de faire sur Terre. Tu y verras ce que tu voulais faire, tu y verras tes réussites et elles t'apparaîtront sans importance ; tu y verras aussi tes échecs. Tu te jugeras toi-même, Hogy, tu te jugeras toi-même. Il n'y a pas de Dieu courroucé trônant tel un juge et désireux de t'envoyer en enfer ou à la damnation éternelle. L'enfer n'existe pas — quoique oui, il existe : l'enfer c'est la Terre — et il n'y a rien de tel que la damnation éternelle. Sur Terre tu fais certaines expériences et tu essaies de mener à bien certaines tâches. Tu peux échouer dans ces tâches, mais c'est sans importance. Ce qui EST important, c'est comment tu as essayé de faire une chose, comment tu as mené ta vie, et c'est toi, ton Sur-Moi, qui jugeras comment tu as vécu et est mort sur Terre. Tu décideras de ce qui te reste à accomplir pour réaliser la tâche que tu as entrepris de faire et n'a peut-être pas achevée. Mais viens, on ne doit pas rester ici à bavarder oisivement.
Le père MacOgwascher se leva, Hogy fit de même et tous deux s'en allèrent à travers les pelouses au gazon parfaitement entretenu, s'arrêtant pendant un moment pour admirer les rives du lac, les bateaux, les oiseaux aquatiques à la surface de l'eau, puis ils continuèrent leur chemin.
Hogy s'amusa beaucoup quand, à un tournant du sentier, ils se trouvèrent face à un arbre offrant un spectacle charmant. Une de ses branches hébergeait trois chats étendus de tout leur long, la queue pendante et ronronnant, ronronnant de bien-être dans ce qui sembla à Hogy être le chaud soleil de l'après-midi. Ils les regardèrent, amusés. Les chats levèrent la tête et, ouvrant les yeux, sourirent en voyant l'étonnement de Hogy. Puis, après cette interruption, les chats reprirent leur position et leur sommeil interrompu.
— Personne ici ne leur ferait du mal, Hogy. Ici, c'est la paix et la confiance réciproque. Ce plan-ci d'existence n'est pas mal du tout.
— Ah ! s'exclama Hogy. Il y a donc plusieurs plans d'existence, si je comprends bien ?
— Bien sûr, autant qu'il est nécessaire, répondit le père. Les gens vont à l'étape qui leur convient le mieux. Ils viennent ici pour prendre un peu de repos et décider ce qu'ils vont faire, ce qu'ils peuvent faire. Certains sont parfois retournés rapidement sur Terre pour y occuper un nouveau corps, d'autres sont envoyés sur un plan d'existence supérieur. Peu importe où on est, on a encore des leçons à apprendre et des conclusions à tirer. Mais l'après-midi est déjà très avancé et il faut nous hâter parce qu'il nous faut te faire entrer au Hall des Souvenirs en ce jour. Dépêchons-nous, veux-tu ?
Le père MacOgwascher pressa le pas — et il semblait que ses pieds ne touchaient même pas le sol. Hogy, en y réfléchissant, découvrit qu'il ne sentait pas non plus le sol sous ses pieds. Impression étrange et effrayante, pensa-t-il. Mais il se dit que ce qu'il avait de mieux à faire était de se tenir tranquille et de voir ce que faisaient les autres qui, eux, étaient là depuis beaucoup plus longtemps que lui.
Le sentier fit une petite courbe, puis droit devant eux se dressa le Hall des Souvenirs. C'était un bâtiment blanc qui paraissait être de marbre poli.
— Asseyons-nous là un moment, dit le père MacOgwascher. Nous ne savons pas combien de temps tu resteras dans le Hall et c'est agréable de regarder les gens, tu ne trouves pas ?
Ils s'assirent sur ce qui semblait être un banc de parc en pierre. Mais ce banc réservait une surprise à Hogy car, au lieu d'être dur, il céda faiblement pour s'adapter à la forme de son corps. Se penchant en arrière il découvrit que le dossier, lui aussi, épousait la forme de son dos.
— Regarde, dit le père en montrant du doigt l'entrée du Hall des Souvenirs.
Hogy regarda et eut peine à réprimer un sourire : un énorme chat noir avançait, l'air aussi honteux et coupable que possible. Il leva la tête, et en les voyant, disparut dans les buissons.
— Sais-tu, Hogy, dit le père MacOgwascher en riant, que sur ce plan d'existence même les animaux doivent aller au Hall des Souvenirs. Ils ne parlent pas, bien sûr, en termes humains, mais toi non plus, quand tu y seras. Tout se fait par télépathie.
Hogy regarda bouche bée d'étonnement l'homme qui avait été son père.
— Tu veux dire que les ANIMAUX se rendent au Hall des Souvenirs ? Tu blagues sûrement ?
Le père MacOgwascher secoua la tête et éclata de rire.
— Ah ! Hogy ! Tu n'as pas changé le moins du monde, pas vrai ? Ton idée est toujours que les humains sont au sommet de l'échelon de l'évolution et que les animaux sont des créatures inférieures ? C'est bien ce que tu penses ? Eh bien ! tu as tort, tu te trompes complètement. Les humains ne sont pas la forme finale de la perfection ; il existe tellement d'autres formes. Tout ce qui EST a une conscience, tout ce qui EST, vit, et même ce banc sur lequel nous sommes n'est qu'une collection de vibrations. Il sent les points saillants de ton anatomie et les épouse afin de te donner le maximum de confort. Regarde !
Il se leva, désigna du doigt le banc, et Hogy regarda la place qu'il venait de quitter. Le banc avait retrouvé sa forme normale. Il reprit sa place sur le banc qui, immédiatement, adopta sa forme anatomique.
— Mais comme je te le disais, Hogy, tout a une conscience, tout ce qui EST est en état d'évolution. Maintenant, les chats ne deviennent pas plus des humains que les humains ne deviennent des chats ; ils ont une ligne différente d'évolution, de la même façon qu'une rose ne devient pas un chou ni le chou une rose. Mais il a été prouvé, même sur Terre, que les plantes sont douées de sensations, lesquelles sensations ont été détectées et mesurées à l'aide d'instruments électroniques extrêmement sensibles. Sur ce monde-ci, les gens viennent dans un stade intermédiaire ; nous sommes, ici, plus près des animaux que nous ne le sommes sur Terre. Ne crois pas, Hogy, que ceci soit le Paradis ; ce ne l'est pas, de même que le stade au-dessus de celui-ci et ceux qui suivent ne sont pas le Paradis. Ici, c'est ce que nous pourrions appeler une station à mi-chemin, un lieu de triage où l'on décide ce que feront les gens. Iront-ils sur un plan supérieur, ou retourneront-ils sur Terre ? J'ai beaucoup appris depuis que je suis ici et je sais que nous sommes très, très près du plan de la Terre ; nous sommes la différence entre la radio ordinaire AM et la radio FM. FM est de bien meilleure qualité qu'AM, a des vibrations plus rapides, des vibrations plus fines, et ici, sur ce monde, nos vibrations sont bien meilleures que sur Terre. Notre perception est plus aiguë, nous sommes dans un état entre la Terre-physique et le Sur-Moi-spirituel. Nous venons ici pour perdre beaucoup de nos inhibitions. Si quelqu'un m'avait dit alors que j'étais sur Terre qu'un chat pouvait parler, raisonner, j'aurais pensé que cette personne était folle. J'ai appris, ici, que les chats sont doués de raison et d'une raison parfois très brillante, dans certains cas. Mais nous ne le comprenons pas sur Terre, parce que leur type de raison est différent de celui des humains.
Ils restèrent assis pendant un certain temps, n'apercevant plus que les contours du chat, à distance. Ce dernier regarda autour de lui d'un air plutôt coupable, sembla ensuite hausser les épaules et s'étendit dans la lumière vive du soleil et s'endormit. Lumière du soleil ? Hogy regarda le ciel, puis se souvint que le soleil, ici, n'existait pas ; tout était un soleil en miniature. Ayant visiblement suivi l'enchaînement de la pensée de Hogy, le père MacOgwascher remarqua :
— Oh ! non, il n'y a pas de soleil ici. Nous trouvons notre énergie dans l'environnement, elle nous est irradiée, et ici point n'est besoin d'absorber de nourriture du type terrestre, nous n'avons pas à satisfaire aux éliminations du type terrestre. Si nous prenons l'énergie irradiée, ici, nous en avons toujours autant que nous voulons et pas davantage, mais avec la nourriture de type terrestre il y a toujours un terrible gaspillage et s'en débarrasser constitue actuellement un des gros problèmes que connaît l'humanité. Aussi, souviens-toi, Hogy, que tu n'as pas besoin ici d'imaginer un repas. Laisse-toi exister, et c'est tout. Ton corps prendra toute l'énergie qui lui est nécessaire et tu n'auras pas faim — à moins que tu ne penses au type de nourriture terrestre, et alors, pour un certain temps il est possible que tu en aies un violent désir.
À cet instant précis, un homme qui passait stupéfia totalement Hogy. L'homme fumait la pipe ! Marchant à grandes enjambées en balançant les bras, il envoyait dans l'air de gros nuages de fumée. Regardant Hogy, le père MacOgwascher rit à nouveau :
— Je t'ai déjà dit que certains rêvent de nourriture de type terrestre, d'autres de tabac ou d'alcools — eh bien, ils peuvent les avoir, mais il n'y a là tout simplement aucun sens. Cela signifie qu'ils n'ont pas atteint le stade d'évolution qui leur permettrait de secouer leurs vieilles habitudes terrestres. Ce type-là fume, eh bien, d'accord, il aime fumer, mais viendra le moment où il comprendra que c'est tout simplement sot. Il pense au tabac, ensuite à une blague à tabac, puis met la main dans la poche d'un costume qu'il a imaginé et en sort une blague à tabac imaginaire avec laquelle il remplit une pipe imaginaire. Bien sûr c'est une illusion, c'est une hallucination, c'est de l'auto-hypnose, mais la même chose se rencontre dans les hôpitaux psychiatriques, sur Terre. Prends un type qui est un peu détraqué ou même complètement loufoque, et ce type-là peut très bien s'imaginer conduire une voiture, ou être à cheval. Je l'ai vu de mes propres yeux, en Irlande, dans un hôpital psychiatrique. Avisant un homme dans une attitude absolument particulière, je lui demandai ce qu'il faisait. Il me regarda comme on regarde un idiot — ne se rendant pas compte que c'était LUI qui l'était — et me répondit : "Qu'est-ce que vous pensez que je fais ? Vous ne voyez pas mon cheval ? L'imbécile est fatigué, il est couché par terre et nous ne pouvons évidemment pas continuer jusqu'à ce que cet abruti de cheval se remette sur pieds." Puis le fou, se libérant avec précaution de son cheval imaginaire, s'en est allé, dégoûté, parlant de tous les cinglés qui sont dans la maison !
Hogy eut un mouvement convulsif. Il ne comprit pas ce qui lui arrivait. C'était la sensation étrange d'être un morceau de métal attiré par un aimant. Pour une étrange raison, il agrippa le bras du banc sur lequel il était assis. Le père MacOgwascher se tourna vers lui en disant :
— Il est l'heure, Hogy, ils t'appellent au Hall des Souvenirs. Il te faut y aller. J'attendrai ici que tu sortes, je peux peut-être t'aider, mais quand tu en sortiras appelle-moi Moses et non pas père. Ici je ne suis plus ton père. Va, maintenant.
Hogy se leva, et ce faisant,il constata qu'il se trouvait soudainement très près du Hall des Souvenirs. Confus, il se tourna vers l'entrée et découvrit qu'il courait presque, qu'il allait plus vite qu'il ne le voulait, en tout cas. Mais les grandes marches de pierre apparaissaient devant lui. À cette distance, le Hall le surprit par ses dimensions et l'entrée imposante l'effraya. Il éprouva ce que pourrait éprouver une fourmi pénétrant dans quelque palais sur Terre. Il gravit les marches dont chacune paraissait plus haute que la précédente. Mais en était-il vraiment ainsi ? Peut-être rétrécissait-il à chaque pas qu'il faisait. Plus petit, très certainement, dans sa propre estime. Rassemblant son courage, il continua son ascension. Il atteignit bientôt ce qui semblait être une vaste surface qui lui donna l'impression d'être sur un plateau dont le seul trait saillant était une grande porte qui semblait monter vers les cieux. Hogy avança, et comme il approchait de cette grande porte, celle-ci s'ouvrit. Il entra dans le Hall des Souvenirs. La porte se referma derrière lui.
Chapitre Dix
Se redressant avec difficulté, le vieux moine secoua sa longue robe défraîchie ; il regarda avec compassion le gros homme escalader la palissade qui séparait le monastère du parc public. Ayant l'impression que le moine l'observait, l'homme se tourna à mi-chemin de son escalade en lui criant avec rudesse :
— Je suis Cyrus Bollywugger, le grand spécialiste des reportages. Si vous voulez provoquer des histoires, prenez un avocat.
À pas lents, le moine se dirigea vers un rocher et s'assit en soupirant.
"Quelle chose étrange", pensa-il. Depuis cinquante ans le vieux moine se promenait dans les jardins de son monastère. Et voilà qu'aujourd'hui, et en dépit de tous les écriteaux Propriété privée et des protestations du moine, un grossier personnage s'était introduit en escaladant le mur. Et plus encore, s'était avancé vers lui, un gros doigt pressé contre sa poitrine en disant :
— Renseignez-nous, vieux. Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte ? Vous êtes tous une bande d'homos, hein ? Ma foi, vous m'avez pas l'air très homo, mais donnez-moi des tuyaux. Faut que je fasse un article.
Le vieux moine avait toisé l'homme des pieds à la tête avec un mépris qu'il estimait peut-être un peu excessif. Ce n'était pas bien d'être si méprisant avec un de ses semblables, bien que celui-ci eût dépassé les bornes.
Le vieux Frère Arnold était entré très jeune au monastère et y avait toujours vécu, essayant d'accorder les paroles de la Bible avec ce qu'il estimait être le bien et le mal. Il avait — selon son habitude — discuté le problème avec lui-même ; il ne pouvait accepter et prendre à la lettre tout ce que disait la Bible. Récemment encore, il avait confié certains de ses doutes à l'Abbé, pensant que celui-ci l'aiderait en éclairant son esprit ; mais non, l'Abbé était entré dans une rage folle et le vieux Frère Arnold avait été en pénitence pendant une semaine. Pénitence consistant à laver toute la vaisselle du monastère.
Puis, comme maintenant, après l'assaut de cette brute des médias, il avait prié longuement, répétant en lui-même : "Seigneur, dans Ta Miséricorde, ne laisse rien devenir trop proche ni sembler trop réel." Cette prière l'avait calmé et lui avait permis de jeter un regard de manière abstraite sur toutes choses.
Il déambulait donc en pensant à son existence passée. Travail le matin, étude l'après-midi et beaucoup, beaucoup d'Enluminures à exécuter. Les peintures, de nos jours, étaient pauvres, affreuses, et quant au vélin, mieux valait n'en pas parler. Juste assez bon, peut-être, pour la confection d'abat-jour, mais pour les Enluminures de grande qualité qui l'avaient rendu célèbre, les fournitures modernes étaient inutilisables. Et ensuite qu'y avait-il après les tâches de l'après-midi ? Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et année après année — chaque jour, les Vêpres, puis le souper dans un silence solitaire, puis les Complies, l'accomplissement de la septième heure canoniale. C'était alors la cellule solitaire, froide et exposée aux courants d'air, avec un lit étroit et dur avec à sa tête l'inévitable Crucifix, une cellule si exiguë qu'un détenu dans une prison aurait refusé d'y vivre et se serait mis en grève.
C'était à tout cela qu'il réfléchissait en marchant, quand cette brute imbécile avait fait irruption dans le sanctuaire privé et, lui plantant son doigt dans la poitrine, avait exigé du vieil homme qu'il lui livre un article à sensation. Des homosexuels ? Grand Dieu non ! Les moines n'étaient pas des gays ; ils considéraient les homosexuels avec une certaine compassion, mais avec un manque total de compréhension. Le vieil homme avait tenu tête et ordonné à Cyrus Bollywugger de se retirer. Celui-ci s'était mis en colère, pérorant sur la puissance de la presse et se vantant de pouvoir, avec sa plume, détruire la réputation du monastère. Comme le moine demeurait silencieux, perdu dans sa contemplation intérieure, l'énergumène avait levé le poing, un poing énorme, et l'avait frappé en pleine poitrine, le jetant à terre. Il était resté là, étourdi, se demandant ce dont l'humanité souffrait de nos jours, et pourquoi un lourdaud brutal frappait ainsi un vieil homme frêle presque à la fin de sa vie. Il n'arrivait pas à comprendre. Puis après quelques minutes et avec un énorme effort il était parvenu enfin à se mettre debout, et d'un pas mal assuré il était allé s'asseoir sur une grosse pierre afin de se ressaisir.
Tout en hurlant des menaces de ‘Révélations’ Bollywugger avait fini par escalader la palissade et, une fois de l'autre côté, s'était hâté de sa démarche lourde qui ressemblait bien plus à celle d'un gorille qu'à celle d'un spécimen d'homo sapiens.
Frère Arnold était assis là, près de la mer scintillante, regardant avec des yeux qui ne voyaient pas, avec des oreilles qui, en fait, percevaient à peine les cris et les appels des gens qui s'amusaient sur la plage, des enfants qui se querellaient et des mégères qui d'une voix aiguë injuriaient leurs hommes pour un quelconque affront imaginé. Soudain, le vieil Arnold sursauta. Une main venait de se poser sur son épaule et une voix disait :
— Qu'est-ce donc qui vous fait souffrir, mon frère ?
Il leva les yeux et vit un autre Frère, de son âge, dont les yeux bruns le considéraient avec intérêt.
— J'ai été insulté par un journaliste qui a franchi notre clôture et m'a frappé en pleine poitrine, raconta Frère Arnold. Il demandait que je lui dise que dans ce monastère nous étions tous des gays — des homosexuels — et quand j'ai nié la chose avec des paroles un peu acerbes, il m'a tout simplement frappé et jeté à terre ! Depuis ce moment, je ne me sens pas bien et j'ai dû me reposer un peu. Mais rentons à la maison, voulez-vous ?
Il se leva avec peine et les deux vieillards qui avaient été Frères dans le monastère pendant tant et tant d'années s'en allèrent à pas lents au long du sentier, vers le grand bâtiment qui était leur demeure.
Cette nuit-là, après les Complies, quand les moines eurent regagné leurs cellules, Frère Arnold souffrit beaucoup. Il avait d'horribles sensations de brûlures dans la poitrine. Faiblement, il réussit à tapoter sur le mur avec sa sandale. Il y eut un bruit et une voix demanda derrière la porte :
— Qu'y a-t-il, Frère ? Êtes-vous malade ?
Frère Arnold, d'une toute petite voix, répondit :
— Oui, Frère, voulez-vous demander au Père Infirmier s'il peut venir me voir ?
La voix murmura un acquiescement, et il y eut le bruit de sandales claquant sur le sol dallé. Frère Arnold se mit à réfléchir à ce qu'il y avait d'étrange dans le règlement qui voulait qu'aucun moine n'entre dans la cellule d'un autre moine, pas même pour le plus impérieux des motifs. Seul le Père Infirmier avait le droit de pénétrer dans une cellule et seulement pour y donner des soins. Pourquoi cette interdiction ? Certains moines étaient-ils homosexuels ? Frère Arnold pensa que la chose était possible. Les autorités avaient promulgué suffisamment de règlements : les moines ne devaient jamais être à deux, mais se promener toujours par trois. Frère Arnold repassait le problème dans son esprit quand la porte de sa cellule s'ouvrit et une voix douce demanda :
— De quoi souffrez-vous, Frère Arnold ?
Il raconta alors l'incident de l'après-midi, le coup qu'il avait reçu dans la poitrine et sa chute. Le Père Infirmier avait été un Docteur en Médecine pleinement qualifié, mais avait renoncé à pratiquer, ayant de la profession une conception qui ne lui permettait pas d'accepter les combines véreuses qui ont envahi de nos jours la ‘science’ médicale. Il écarta avec délicatesse les vêtements de Frère Arnold et examina sa poitrine qui était maintenant couverte d'ecchymoses noires, bleues, jaunes, puis son œil entraîné découvrit immédiatement les côtes cassées. Il recouvrit doucement la poitrine du vieil homme et se leva en disant :
— Je dois faire un rapport au Père Sous-Prieur. Il faut vous radiographier, Frère Arnold, car vous avez des côtes cassées et vous avez besoin de soins hospitaliers.
Sa visite terminée, il s'en alla en silence.
Bien vite frère Arnold entendit des bruits de pas et des murmures derrière sa porte. Celle-ci s'ouvrit et le Père Infirmier et le Père Sous-Prieur entrèrent.
— Frère Arnold, dit le Sous-Prieur, vous serez obligé d'aller à l'hôpital pour y être radiographié et pour qu'on vous mette un plâtre. Je vais informer le Père Abbé afin qu'il prenne les dispositions nécessaires. Dans l'intervalle, le Père Infirmier restera avec vous, au cas où vous auriez besoin de lui.
Le Sous-Prieur allait quitter la cellule mais Frère Arnold s'exclama :
— Non, Père Sous-Prieur, non Père Sous-Prieur, je ne veux pas aller à l'hôpital. J'ai tellement entendu parler des fautes professionnelles qui s'y produisent que je préfère de beaucoup être soigné par le Père Infirmier, et si je suis au-delà de ses capacités, alors je recommanderai mon âme à Dieu.
— Non, Frère Arnold, je ne peux pas accepter cela. Seul le Père Abbé est autorisé à accorder une dispense. Je vais aller le voir, dit le Sous-Prieur en quittant la cellule.
Le Père Infirmier disposait de bien peu de moyens pour soulager le vieux moine, à part la serviette mouillée qu'il maintenait sur son front pour essayer de diminuer la fièvre. Puis il ouvrit ses vêtements qui pesaient péniblement sur sa poitrine. Tous deux étaient assis car le vieil homme respirait plus aisément dans cette position.
À nouveau, on entendit des pas. C'était le Père Abbé. Le Sous-Prieur dut attendre à l'extérieur, vu l'exiguïté de la cellule. Le Père Abbé se pencha pour regarder Frère Arnold et l'horreur se peignit sur son visage en voyant la poitrine du vieux moine. Après s'être entretenu à voix basse pendant quelques instants avec le Père Infirmier, le Père Abbé se tourna vers Frère Arnold en disant :
— Je ne peux pas prendre la responsabilité de vous garder ici dans l'état où vous êtes. Il vous faudra aller à l'hôpital, Frère Arnold.
Il se tut, semblant réfléchir, puis dit après avoir considéré le vieux moine :
— Vu votre état et votre âge, je vais, si vous le désirez, téléphoner à l'Évêque et nous devrons nous soumettre à sa décision.
— Je vous en suis très reconnaissant, répondit Frère Arnold. Je hais l'idée de quitter cet endroit, qui est mon foyer, pour aller affronter les dangers inconnus des hôpitaux d'aujourd'hui. J'ai entendu dire tant de choses désobligeantes à leur sujet, que je n'ai aucune confiance en eux — et il est bien difficile de bénéficier d'un traitement dont on doute. J'ai pleinement foi dans les soins du Père Infirmier.
— Comme vous voudrez, Frère Arnold, dit le Père Abbé. Je ne devrais pas le dire en votre présence, mais je suis complètement d'accord avec vous.
L'Abbé quitta la cellule et gagna son bureau accompagné du Sous-Prieur. Quelques minutes plus tard il était en communication avec l'Évêque du Diocèse dont dépendait le monastère. Les mêmes phrases revenaient souvent :
— Oui, comme vous dites, Monseigneur, comme vous dites. Oui, c'est ce que je vais faire. Au revoir.
Le Père Abbé demeura à réfléchir, puis ayant soudain pris une décision, il demanda un secrétaire afin de lui dicter un papier que devrait signer Frère Arnold. Il était dit dans ce papier que si le moine se refusait à aller à l'hôpital, il le faisait sous son entière responsabilité — le monastère ne pouvant être tenu responsable des conséquences de cette décision.
La lumière de la lune qui était à son plein accentuait la blancheur froide du monastère et les nuages qui défilaient en voilant de temps à autre la face de l'astre ajoutaient quelque chose de sinistre au bâtiment. Les fenêtres brillaient sous les reflets de la lune, semblant faire un clin d'œil aux nuages à mesure qu'ils passaient. Un hibou appelait quelque part dans l'obscurité. Plus près on entendait le bruit doux et rythmé des vagues léchant le sable, puis se retirant pour revenir. Dans le monastère tout était calme, silencieux, comme si le bâtiment lui-même savait que la mort était proche, comme s'il attendait que l'Ange de la Mort agite ses ailes. Il arrive que des bruits étranges se produisent parfois dans une vieille construction qui ressent le poids des ans. De temps à autre c'est le trottinement discret d'une souris glissant rapidement sur un sol poli ou laissant échapper un petit cri aigu. Mais le monastère était silencieux, autant que peut jamais l'être une vieille maison. À l'horloge de la tour, les heures sonnèrent à travers la campagne, et au loin un train gronda sur ses rails roulant à toute allure vers la capitale.
Frère Arnold était étendu sur son lit de douleur. À la lumière vacillante de la chandelle il pouvait voir le Père Infirmier qui le regardait avec compassion. Rompant le silence avec une soudaineté qui le fit sursauter, le Père parla :
— Frère Arnold, dit-il, nous sommes si inquiets pour vous au sujet de votre vie future. Il vous arrive d'avoir des croyances qui sont tellement différentes de celles de la religion orthodoxe. Vous semblez penser que peu importe ce en quoi l'on croit, aussi longtemps que l'on croit. En l'état où vous êtes, Frère Arnold, laissez le repentir prendre place. Voulez-vous que j'appelle le Père Confesseur pour vous, Frère Arnold ?
Levant les yeux vers lui, Frère Arnold répondit :
— Père Infirmier, je suis satisfait de mon mode de vie. Je vais vers ce que je crois être le Paradis ; j'ai vécu en accord avec ma propre foi, qui n'est pas nécessairement celle du Livre. Je crois que notre religion prescrite — la religion orthodoxe — fait montre d'étroitesse dans ses concepts.
Il gémit soudain de douleur, ayant l'impression que sa poitrine était en feu, ayant l'impression qu'on y plantait des clous, et il pensa aux clous plantés à travers les mains et les pieds du Christ, il pensa à la douleur causée par le coup reçu du garde qui se tenait au pied la Croix.
— Père Infirmier, Père Infirmier, dit-il, voulez-vous me donner le Crucifix afin que je baise les Cinq Plaies.
Se levant lentement, le Père Infirmier s'avança vers la tête du lit. Levant le bras après s'être signé, il prit le Crucifix et le pressa sur les lèvres de Frère Arnold.
— Père Infirmier, Père Infirmier, s'écria Arnold avec angoisse et étonnement, qui sont tous ces gens rassemblés autour de moi ? Ah... je vois ! Voilà ma mère ; elle est venue pour me souhaiter la bienvenue à la Réalité Supérieure, à la Vie Supérieure. Ma mère est ici, mon père est ici, plusieurs de mes amis sont ici, également.
Le Père Infirmier se leva d'un bond et frappa violemment à la porte de la cellule voisine. Une exclamation s'éleva de l'intérieur et presque immédiatement une tête rasée apparut dans l'entrebâillement de la porte.
— Vite, vite ! dit le Père Infirmier. Appelez le Père Abbé. Frère Arnold est sur le point de nous quitter.
Sans prendre le temps de passer sa robe ou d'enfiler ses sandales, le moine se précipita dans le corridor et dévala l'escalier. Il revint presque aussitôt suivi du Père Abbé qui attendait, seul dans son bureau.
Frère Arnold le regarda d'un air égaré et angoissé en s'exclamant :
— Comment se fait-il que nous qui prêchons la religion soyons effrayés de mourir ? Comment se fait-il, Père Abbé, comment se fait-il que nous soyons si effrayés de mourir ?
Une réponse arriva dans le cerveau de Frère Arnold : "Tu l'apprendras, Arnold, quand tu viendras à nous, de l'Autre Côté de la vie. Ce sera très bientôt."
Le Père Abbé s'agenouilla près du lit, tenant le Crucifix dans ses mains levées. Il pria. Il pria pour le salut de l'âme de Frère Arnold qui s'était si souvent éloigné des préceptes de la religion. La chandelle posée près du lit s'embrasa, puis le vif éclat baissa et la brise soudain faillit l'éteindre. Elle brilla de nouveau et, à la lueur de cette chandelle solitaire, ils virent Frère Arnold se dresser en criant :
— Nunc Dimitis, Nunc Dimitis. Seigneur, permets maintenant que Ton serviteur parte en paix, selon Ta parole.
Ayant dit ces mots, il gémit et retomba sans vie sur l'oreiller.
Le Père Infirmier fit le signe de la croix et dit la Prière des Morts. Puis, tendant le bras au-dessus du Père Abbé qui était toujours agenouillé, le Père Infirmier ferma les yeux de Frère Arnold et les maintint clos à l'aide de petits tampons. Il passa une bande sous la mâchoire inférieure, puis l'attacha au sommet de la tête rasé de Frère Arnold afin de maintenir la bouche fermée. Avec soin, il lui souleva la tête et retira les oreillers. Prenant les mains du défunt, il les croisa sur sa poitrine. Ayant ensuite procédé à la toilette nécessaire, il rabattit le drap sur le visage du défunt.
Lentement le Père Abbé se releva, sortit de la cellule, gagna son bureau et donna des instructions à un moine. Quelques minutes plus tard les cloches sonnèrent pour annoncer le passage de vie à trépas. Silencieusement, les moines revêtirent leurs robes et descendirent à la Chapelle pour réciter les Prières des Morts. Plus tard, une fois le soleil au-dessus de l'horizon, il y aurait une messe. Tous y assisteraient, puis le corps de Frère Arnold, enveloppé dans sa robe, le capuchon rabattu sur son visage, ses mains serrant le Crucifix, serait porté en procession solennelle au long du sentier jusqu'au petit carré consacré qui abrite les corps de tant de moines morts depuis longtemps.
Déjà deux moines se préparaient à se rendre au lieu consacré pour y creuser une tombe — une tombe en face de la mer et où reposerait, jusqu'à sa dissolution finale, le corps de Frère Arnold. Les deux moines, la pelle sur l'épaule, se mirent en route, silencieux, chacun s'interrogeant peut-être sur ce qu'il y avait après la vie. Les Saintes Écritures nous apprenaient beaucoup, mais pouvait-on se reposer totalement sur elles ? Frère Arnold — à la grande colère du Père Abbé — disait toujours qu'il ne faut pas prendre trop à la lettre les Saintes Écritures, mais seulement les voir comme un indicateur de la Voie, un guide, un panneau de direction. De même, il avait souvent dit que la vie future n'est que la continuation de la vie sur Terre. Un jour qu'il était assis en silence dans le réfectoire avec devant lui une bouteille d'eau gazeuse, il s'était soudain levé et, saisissant la bouteille, il avait dit :
— Regardez, mes frères, cette bouteille ressemble au corps humain ; elle a une âme en elle. Si j'enlève le bouchon, il y a un bouillonnement, un pétillement et, tout comme pour l'âme d'un humain, les gaz émergent et jaillissent. C'est ainsi, mes frères, que nous quittons nos corps à la fin de cette vie. Nos corps ne sont rien d'autre qu'un vêtement pour l'âme immortelle, et quand le vêtement est vieux et en lambeaux, l'âme alors abandonne le corps et s'en va ailleurs et vers ce qui se passe dans cet ailleurs. Eh bien, mes frères, chacun de nous à son tour le découvrira.
Frère Arnold avait versé le contenu de la bouteille dans un verre et l'avait bu rapidement en disant :
— Maintenant le corps qui était l'eau a disparu, tout comme notre corps disparaîtra éventuellement dans la terre pour finalement s'y décomposer.
Tout en cheminant au long du sentier, les deux moines songeaient à ces choses. Ils regardèrent autour d'eux, cherchant l'endroit où creuser une tombe profonde de six pieds (1,8 m), longue de six (1,8 m) et large de trois (0,9 m). Sans un mot, ils se mirent au travail, enlevant soigneusement le gazon et le mettant de côté pour qu'il puisse être utilisé plus tard pour recouvrir la nouvelle tombe.
Dans le monastère on avait déplacé le corps de Frère Arnold avant que n'intervienne la rigidité cadavérique qui n'aurait plus permis de le descendre par l'étroit escalier. Quatre moines tenant un drap muni de poignées à chaque coin le glissèrent avec précaution sous le corps de Frère Arnold en veillant à ce qu'il soit exactement au milieu. Ils tirèrent soigneusement vers le haut les côtés du drap afin que les poignées du haut et du bas s'emboîtent, les extrémités à la tête ensemble, et les extrémités aux pieds, ensemble aussi. Puis les moines soulevèrent le corps, le passèrent par la porte et, adroitement, tournèrent dans le corridor. Avançant lentement tout en récitant les paroles du Rituel pour le Défunt, ils descendirent le corps dans l'annexe de la Chapelle. Respectueusement, ils placèrent le corps dans un cercueil, arrangèrent sa robe pour qu'elle tombe naturellement et mirent des sandales aux pieds du moine. Toujours avec respect, ils replacèrent le Crucifix entre ses mains froides et abaissèrent le capuchon sur son visage. En ayant terminé, les quatre moines commencèrent leur garde solitaire, veillant le corps de leur Frère mort jusqu'à la naissance du jour, moment où de nouvelles messes seraient chantées.
Et ainsi Frère Arnold quitta son corps. Il se sentit emporté vers le haut. Regardant vers le bas avec une certaine appréhension, il vit une corde bleu argenté tendue entre son corps actuel et l'horrible cadavre reposant sur le lit au-dessous. Il pouvait en partie distinguer des visages autour de lui. C'était sûrement sa mère ? Et là était son père. Ils étaient venus d'au-delà des Ombres pour l'aider, le guider dans son voyage.
La route devant était sombre, ressemblant à un long tunnel, un tunnel sans fin, ou peut-être à un tube, comme celui que les moines portaient lors de leurs processions à travers le village. Ce tube était supporté par une perche qu'ils hissaient à hauteur des fenêtres, les gens déposaient leurs contributions à l'entrée du tube et celles-ci glissaient et tombaient dans un sac situé à l'autre extrémité.
Frère Arnold éprouvait la sensation de monter lentement dans ce tube. Sensation vraiment très étrange. Il baissa la tête et vit la corde d'argent s'amenuiser, puis tandis qu'il regardait la corde se sépara et disparut, à la manière d'un élastique qui, coupé, se rétracte sous sa propre élasticité.
Regardant au-dessus de lui, il crut voir une brillante lumière. Cela lui rappela le jour où il était descendu dans le puits du monastère pour aider à nettoyer les filtres à eau. Levant les yeux, il avait vu le cercle de lumière tout en haut du puits. C'était un peu la même impression, la sensation qu'il était porté, élevé vers la lumière et il se demanda — quoi maintenant ?
Et soudain, tel un diable qui apparaît sur la scène en sortant d'une trappe, Arnold apparut — où ? — il apparut en cet autre monde, ou sur un autre plan d'existence. Pour l'instant il ne le savait pas. La lumière était d'une intensité qui l'obligea à protéger ses yeux, et quand après un moment il écarta ses mains avec précaution...
— Oh ! par exemple ! murmura-t-il en entendant un rire amusé et en voyant devant lui l'homme qui avait été son père.
— Arnold, dit l'autre, tu as vraiment l'air étonné ; j'aurais pensé que tu te souviendrais de tout, bien que je doive avouer que cela m'a demandé un assez long temps.
Arnold regarda autour de lui.
— Je dois bien reconnaître que je SUIS étonné, dit-il. Cet endroit donne l'impression de la Terre, oh ! d'une bien meilleure version de celle-ci, je te l'accorde, mais c'est un monde de type terrestre, et je pensais que nous irions, heu, je ne sais pas trop exactement, mais dans un type de monde plus abstrait. (Il désigna d'un geste les bâtiments et les parcs.) Tout ici évoque une version extrêmement huppée de la Terre !
— Tu as beaucoup à apprendre, ou à ré-apprendre, Arnold, dit l'homme qui avait été son père. Tes propres études, ta longue expérience auraient dû t'amener à la certitude que si une entité — une âme humaine — allait directement de la Terre aux hautes sphères célestes, cela détruirait entièrement l'équilibre mental de cette entité, car le changement serait trop grand.
Regardant Arnold gravement, il poursuivit :
— Pense à un verre, un verre ordinaire. Tu ne pourrais pas plonger directement dans l'eau chaude un verre glacé sans qu'il se brise ou se fêle, et il y a beaucoup de choses de cette nature ; il faut procéder très, très doucement. C'est la même chose pour une personne qui a été malade pendant longtemps et confinée au lit — tu ne t'attendrais pas à la voir se lever un beau jour et se mettre à marcher et courir comme un athlète bien entraîné. Il en est de même ici. Tu étais sur un monde fruste, très fruste — la Terre — tu étais sur le chemin ascendant et tu es ici dans un stade intermédiaire, disons une halte, où l'on peut se reposer pendant un temps et s'orienter.
Arnold regarda autour de lui, émerveillé par la beauté des bâtiments, émerveillé par le vert de la végétation et par les arbres sans défaut. Il vit qu'ici les animaux et les oiseaux n'avaient nullement peur des humains. Ce monde semblait un monde de bonne entente.
— Je suis certain que très bientôt tu iras en haut vers des plans plus élevés, mais avant que la décision en soit prise, il te faudra passer par le Hall des Souvenirs. Et peut-être, une fois là, te souviendras-tu de la visite que tu y as faite précédemment.
— Je trouve ça drôle, dit Arnold, cette façon de dire ‘en haut’, car dans mon esprit les Sphères Célestes et les Sphères Terrestres, ou plans d'existence — appelle-les comme tu voudras — pouvaient être entremêlées, occupant même peut-être le même espace, alors pourquoi dire ‘en haut’ ?
Un homme les interrompit, les ayant écoutés sans rien dire.
— C'est en haut, il n'y a aucun doute à ce sujet. Nous montons vers une plus haute vibration. Si nous allions vers une plus basse, nous descendrions. En fait, de tels lieux à vibrations inférieures existent bel et bien ; les gens d'ici qui, pour une quelconque raison doivent descendre (peut-être pour aider une âme lasse) diront qu'ils descendent à tel ou tel plan. Mais ici c'est un lieu intermédiaire ; nous y montons depuis la Terre. Nous voulons nous éloigner d'elle, et si nous descendions vous pourriez dire alors que nous nous rapprochons du cœur de la Terre, et c'est ce que vous ne voulez pas faire. Ainsi c'est bien ‘en haut’, vers une vibration plus élevée, loin du centre de la Terre, et bientôt vous, Arnold, monterez de nouveau. Je n'en doute nullement car ceci n'est qu'un plan intermédiaire ; les gens d'ici vont vers un plan supérieur, ou redescendent sur Terre une nouvelle fois pour y apprendre d'autres leçons. Mais il est temps pour vous d'aller au Hall des Souvenirs. Chacun doit s'y rendre en premier. Venez, suivez-moi.
Ils longèrent ce qui ressemblait à une rue parfaitement entretenue. Il n'y avait pas de voitures, aucune sorte de véhicules motorisés. Les gens marchaient et les animaux en faisaient tout autant, souvent à côté des humains. Arnold et son nouvel ami ne tardèrent pas à quitter les rues pour prendre un petit chemin à l'extrémité duquel Arnold pouvait voir une masse de verdure. Tous deux déambulaient en silence, enfermés dans leurs propres pensées, puis ils arrivèrent au bout du chemin. Devant eux s'étendait un parc superbe — plantes et fleurs merveilleuses, inconnues d'Arnold. Et là, au beau milieu du parc, s'élevait le grand bâtiment en forme de dôme auquel on donnait le nom de Hall des Souvenirs. Ils restèrent debout quelques instants comme pour embrasser la scène — verdure, fleurs aux couleurs vives et bleu irréel des cieux qui se reflétaient sur la surface lisse du lac, près du Hall des Souvenirs.
Comme d'un commun accord, Arnold et son nouvel ami prirent le chemin qui menait au Hall. Peut-être s'interrogeaient-ils, tout en marchant, sur les gens qu'ils voyaient assis sur les bancs ou étendus sur l'herbe. Le Hall avait de nombreux visiteurs, les uns montant l'escalier et d'autres sortant par une quelconque issue cachée. Certains paraissaient exaltés et d'autres avaient l'air châtiés au-delà de toute expression. L'étrangeté de tout cela donnait le frisson à Arnold. Qu'est-ce qui se passait dans le Hall des Souvenirs, qu'allait-il se passer pour lui ? Allait-il être à la hauteur et monter vers une vibration supérieure, vers une forme d'existence plus abstraite ? Ou bien serait-il renvoyé sur Terre pour recommencer toute une autre vie ?
— Regardez, regardez, murmura le nouvel ami d'Arnold en désignant quelque chose à distance.
Sa voix se fit aussi faible qu'un murmure :
— Ceux-ci sont des entités d'un plan d'existence beaucoup plus élevé ; ils sont venus pour observer les gens. Regardez-les.
Arnold regarda. Il vit deux brillantes sphères dorées paraissant faites de lumière, mais si brillantes qu'il ne pouvait même pas deviner leur véritable forme. Les sphères dorées dérivaient comme des bulles d'or sous une légère brise. Arrivées devant les murs du Hall des Souvenirs, elles les touchèrent et, sans laisser aucune marque sur la structure, les traversèrent.
— Je dois vous quitter maintenant, dit l'ami d'Arnold. Mais gardez votre confiance, ne vous laissez pas abattre. Je suis certain que VOUS n'avez à vous inquiéter de rien. Adieu. Quelqu'un sera là pour vous accueillir quand vous sortirez. Courage ! N'ayez pas cet air lugubre ! (Sur ces mots, il fit demi-tour.)
Avec une appréhension grandissante — non ! — avec une frayeur atroce, Arnold se dirigea jusqu'au bout du sentier où se trouvait l'entrée du Hall des Souvenirs. Il s'arrêta au pied du grand escalier de pierre et essaya de regarder autour de lui pour voir ce qui se passait ; mais non, il ne s'arrêta pas, en fait, car une force le propulsait, le tirait. Il monta les marches à la hâte et s'arrêta un instant devant la grande porte d'entrée. Soudain, et sans un bruit, elle s'ouvrit et Arnold se trouva poussé à l'intérieur. Poussé ou entraîné — peu importe — il était à l'intérieur et la porte se ferma derrière lui.
Chapitre Onze
Le silence, total et absolu. Pas le moindre son, même pas celui d'un murmure. Rien. Un si grand silence qu'il y avait une absence absolue de tout, à part le silence.
L'obscurité, si obscure qu'Arnold pouvait presque y voir des choses. Ses yeux, habitués à la lumière, avaient dû en enregistrer des configurations parce qu'en cet instant, dans cette obscurité si profonde, ses nerfs optiques envoyaient des éclairs.
Une absence absolue de tout. Arnold se déplaçait et n'en avait pas conscience. Tout était vide, plus vide pensa-t-il, que l'espace lui-même. Puis un faible point lumineux apparut soudain ‘quelque part’ et de ce point jaillirent des raies bleues comme volent les étincelles sur un fer à cheval chauffé au rouge frappé par un maréchal-ferrant. La lumière était bleue, bleue pâle en son centre, puis allait en s'assombrissant pour finir par être d'un bleu violacé. La lumière s'étendit — toujours bleue — et Arnold vit alors le monde, la Terre qu'il avait quittée si récemment. Elle donnait l'impression de flotter dans l'espace. Il n'y avait qu'une masse de nuages qui avait presque l'air d'une boule d'ouate de différentes couleurs, des nuages noirs et des nuages blancs, puis il eut un aperçu momentané de ce qu'il pensait être le Désert du Sahara — rien d'autre que sable et désolation. Puis, à travers la Terre il vit d'autres globes, tous s'entremêlant, sans cependant se toucher.
"Je deviens fou, pensa Arnold. Que je sorte d'ici au plus vite !" Et il se tourna pour fuir. Il vit derrière lui deux sphères incandescentes. Il les regarda et reçut une impression : "Tout va bien, Arnold, nous savons tout sur vous, nous avons examiné votre passé. Vous vous en êtes très bien sorti dans cette dernière vie, si ce n'est que vous avez été paresseux au point d'être resté diacre. Vous n'avez pas pris la peine d'être ordonné. Ce fut paresseux de votre part, Arnold."
Arnold regarda fixement et l'impression lui parvint : "Non, vous ne pouvez pas nous voir, nous sommes d'une vibration différente. Vous ne pouvez voir qu'un globe de lumière et ce n'est pas du tout ce à quoi nous ressemblons. Vous serez bientôt l'un des nôtres — si vous le souhaitez — et si tel n'est pas votre désir, alors vous devrez retourner sur Terre et accomplir certaines choses laissées inachevées, comme cette affaire de rester diacre quand vous auriez pu vous élever tellement plus haut."
— Mais comment êtes-vous ? À quoi ressemblez-vous ? demanda Arnold.
"Peu de gens savent comment vit un roi, pensa l'une des sphères. On se fait des rois et des reines les idées les plus étranges. Pour certains, ils sont censés passer tout leur temps assis sur un trône doré avec sur la tête une couronne tout en tenant l'Orbe et le Sceptre. Ce n'est pas du tout le style de vie des rois et des reines. De même les gens sur Terre se font de bien curieuses idées de ce qu'est la vie qui suit immédiatement la mort, ils pensent qu'il y a un Paradis aux Grilles Dorées — eh bien, il y a un Paradis aux Grilles Dorées pour ceux qui y croient, puisqu'ici dans ce pays contrôlé par la pensée les gens sont ce qu'ils pensent qu'ils sont ; si donc une personne croit au tableau des anges, alors elle les verra. Mais tout ceci est vain, ce genre de vie n'est pas du tout utile, et ces stades intermédiaires existent pour que les gens puissent rationaliser les choses et changer."
Il sembla qu'une conversation se déroulait entre les deux sphères, car il se produisit entre elles beaucoup de sautillements et de vibrations. Puis de l'une des deux vint cette pensée : "Nous sommes très amusées de constater que sur ce plan d'existence certains sont si attachés à leurs habitudes de vie qu'il leur faut d'abord imaginer une nourriture et imaginer ensuite qu'ils la mangent. Nous avons vu certaines personnes très religieuses qui, ici, insistent même pour manger du poisson le vendredi !"
— Cela me paraît excessif ! dit Arnold. Mais pourquoi les gens ont-ils si peur de la mort ? J'ai été un religieux, j'ai obéi toute ma vie aux règles de l'Ordre et pourtant, je dois confesser que j'étais terrifié à l'idée de mourir. Je pensais que Dieu serait là et prêt à me châtier pour les fautes que j'avais commises, et je me suis toujours demandé pourquoi les gens craignaient tant la mort.
La voix télépathique répondit : "Les gens ont peur de la mort parce que nous ne voulons pas qu'ils connaissent la vérité. La mort est agréable ; quand on arrive aux dernières étapes de la mort toute peur est supprimée, toute douleur, toute souffrance est supprimée. Mais il importe que les gens aient peur de la mort, sinon ils n'hésiteraient pas à se suicider et il y aurait des suicides collectifs. Si les gens savaient à quel point la mort est agréable et à quel point la vie est bien meilleure ici, ils se suicideraient et ce serait très mal, en vérité. Ils vont sur Terre comme les enfants vont à l'école pour apprendre, et les enfants ne doivent pas être autorisés à s'échapper pour profiter des plaisirs de la campagne. C'est pourquoi les gens ont peur de la mort jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'instant où il est évident qu'ils ne peuvent vivre plus longtemps. Ils accueillent alors la chaleur de la mort, le bonheur de la mort."
"Mais nous voulons que vous quittiez les mondes matériels et veniez aux mondes de l'esprit, pensa l'une des sphères."
— Mais pourquoi y a-t-il un paradis matériel — quand bien même une imitation — si les gens n'ont pas besoin des choses matérielles ? demanda Arnold.
"Parce qu'un Sur-Moi ou une Âme, ou quel que soit le nom que vous lui donniez, a besoin d'acquérir l'expérience matérielle, et à travers les épreuves de la Terre on peut apprendre de dures leçons en quelques années seulement, alors que si les leçons devaient être absorbées par un esprit vivant dans un monde spirituel, cela prendrait des éternités. Mais nous devons maintenant vous montrer votre vie passée. Regardez !"
Le monde devant Arnold sembla s'étaler et se déployer si rapidement qu'il crut tomber du bord d'un précipice — un précipice dans l'espace ? — sur le monde en rotation. Il tomba, ou crut qu'il tombait, pendant des milliers de milles (km), et se trouva à quelques pieds (m) seulement au-dessus de la Terre. Devant lui, des hommes à l'apparence étrange étaient lancés dans une lutte à mort, brandissant des lances, des haches, et même des bâtons avec de lourdes pierres à leurs extrémités. Arnold les regardait et l'un deux l'attira tout particulièrement. La forme se leva brusquement du sol où elle était étendue et traversa d'un coup d'épée la poitrine d'un ennemi qui approchait. L'ennemi s'écroula dans une mare de sang. "C'est une mauvaise action que vous avez faite là, Arnold, dit une voix dans sa tête, vous avez dû vivre plusieurs vies pour l'expier."
Les images se déroulaient, depuis le temps des Assyriens, et traversant différentes périodes de l'histoire de la Terre ; puis il vit enfin la vie qu'il venait juste de quitter, d'abord ses jeunes années et les petites offenses qu'il avait commises — les fruits dérobés dans le verger voisin, ou les quelques pièces de monnaie posées sur la bouteille de lait et subtilisées. Il se vit volant au marché à quelques reprises : pommes, poires et bananes.
Puis, bien plus tard, ce fut le moine redoutant de ne pas réussir aux examens de l'Ordination et adoptant une attitude hautaine pour couvrir la peur de sa propre incompétence.
Il vit à nouveau son agonie et sa mort, et il sembla alors s'élancer en flèche loin de la Terre, montant, montant toujours pour enfin atterrir sur un autre plan d'existence.
"Vous avez été très bien dans cette vie, dit la voix dans sa tête, et ce serait pour vous pure perte de temps que de retourner à la phase terrestre. Nous pensons que vous auriez avantage à venir dans le monde qui se situe au-delà des choses matérielles, où vous pourriez sans aucun doute beaucoup apprendre."
— Mais alors, demanda Arnold, et tous les amis que j'ai ici ? Mon père et ma mère, et tous les gens que j'ai connus. Ne serait-ce pas mal de ma part d'avoir usé de leur hospitalité et de les quitter soudainement pour un plan supérieur ? Que penseront-ils de moi ?
La voix dans sa tête éclata de rire en répliquant : "S'ils étaient dignes d'aller plus haut, Arnold, ils iraient, et si vous ne sortez pas de ce bâtiment sous une forme qu'ils peuvent reconnaître, alors ils se rendront compte que vous êtes monté sur un plan plus élevé. Quand nous sortirons d'ici nous leur apparaîtrons tous trois comme des globes de lumière, et comme ils n'en ont vus entrer que deux, ils comprendront que le troisième c'est vous. Ils se réjouiront en conséquence de votre avancement et de votre élévation. Cela leur donnera aussi beaucoup d'espoir de pouvoir éventuellement faire de même."
Il vint donc à l'esprit d'Arnold de dire ‘Oui’, et alors, à son grand étonnement, il se découvrit plein de vitalité, plus débordant de vie que jamais auparavant ; il se sentit plein d'énergie et, baissant les yeux, il lui fut impossible de voir ses pieds, impossible de voir ses mains. Comme il regardait d'un air ahuri, la voix revint : "Arnold, Arnold, vous êtes semblable à nous maintenant ; en nous regardant vous pouvez voir comment vous êtes. Nous ne sommes que des masses d'énergie pure puisant dans notre environnement une énergie supplémentaire. Nous pouvons aller partout et nous pouvons tout faire entièrement par la pensée et, Arnold, nous ne nous nourrissons plus de la façon qui vous est familière !"
Il y eut une étrange impression de chant et Arnold se trouva traversant, à la suite de ses deux nouveaux amis, le mur du Hall des Souvenirs. Il sourit légèrement en voyant quelques-uns de ses amis à l'extérieur ; il nota leur expression en voyant sortir les trois globes — se souvenant que deux seulement étaient entrés.
Le son musical augmenta et il y eut une sensation de précipitation, de vitesse, et Arnold pensa : "Je me demande bien pourquoi nous avons toujours l'air de monter et jamais de descendre ?" En même temps qu'il s'interrogeait, la réponse lui vint : "Certainement que nous montons, nous allons vers une vibration supérieure. Avez-vous jamais entendu parler de descendre vers une vibration supérieure ? Non n'est-ce pas ? Nous montons de la même façon que vous montez quand, sur Terre, vous voulez changer de position, vous éloigner de la Terre. Si vous descendiez, vous vous rapprocheriez du centre de la Terre, ce que vous essayez d'éviter, mais — faites attention où nous allons."
Arnold, à cet instant précis, éprouva un choc ou une secousse. La sensation était difficile à définir avec précision, mais s'il y avait réfléchi il l'aurait probablement rapprochée de celle ressentie en passant le mur du son. C'était une sensation très ‘particulière’ — comme s'il entrait dans une autre dimension — ce qu'il faisait précisément.
Il y eut ce bond soudain et autour de lui tout lui sembla éblouissant ; il vit des couleurs chatoyantes et scintillantes de teintes qu'il n'avait jamais connues auparavant ; puis, regardant les deux entités qui étaient avec lui, il s'exclama :
— Oh ! Vous êtes des humains tout comme moi !
Les deux autres rirent en disant :
— Mais, bien sûr, nous sommes humains tout comme vous. Que devrions-nous être ? Le grand Plan de l'Univers fait que les gens doivent adopter une certaine forme ; par exemple nous sommes humains, peu importe que nous soyons sous-humains, humains ordinaires ou surhumains, nous avons tous le même nombre de têtes, de bras, de jambes, la même méthode fondamentale d'élocution, etc. Vous découvrirez que dans cet Univers particulier tout est bâti sur la base de la molécule de carbone, et ainsi où que vous alliez dans cet Univers, humains ou humanoïdes sont fondamentalement semblables à vous ou à nous. De même dans le monde animal : un cheval a une tête et quatre membres — tout comme nous, et si vous prenez le chat c'est à nouveau une tête, quatre membres et une queue. Les humains en avaient une, il y a très longtemps ; heureusement, ils ont pu s'en passer. Ainsi, souvenez-vous que dans cet Univers-ci, sur n'importe quel plan d'existence que vous alliez, chacun a fondamentalement la même forme, que nous appelons la forme humaine.
— Mais, bonté divine, s'exclama Arnold, confus, je vous ai vus comme des sphères de lumière ! Et maintenant je vous vois comme des formes super-surhumaines, bien que vous soyez encore entourés d'un flot de lumière.
Ils répondirent en riant :
— Vous vous y habituerez bientôt. Vous allez demeurer assez longtemps sur ce plan ; il y a beaucoup à faire, beaucoup à planifier.
Ils dérivèrent pendant un certain temps. Arnold commença à voir des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Les deux entités l'observaient et l'une dit :
— Je pense que votre vue s'habitue à voir les choses d'ici ; vous êtes maintenant dans la cinquième dimension, vous savez, loin du monde, du plan des choses matérielles. Vous n'aurez plus besoin, ici, d'imaginer votre nourriture, votre boisson, ou toute autre chose de cette nature. Ici, vous existez comme un pur esprit.
— Mais si nous sommes de purs esprits, dit Arnold, alors comment se fait-il que je vous voie comme des formes humaines ?
— Mais peu importe ce que nous sommes, Arnold, il nous faut encore avoir une forme. Si nous étions des boules de flammes, nous aurions une forme ; maintenant vous mettez au point votre vision de la cinquième dimension, et de cette façon vous nous voyez comme nous sommes — de forme humaine. De même, vous voyez aussi des plantes, des fleurs, des habitations autour de vous, mais pour des gens qui sont encore sur le plan d'où vous venez tout juste d'arriver, elles n'existent pas, ils ne les voient pas. S'ils venaient ici — ce qui est impossible — ils seraient brûlés par l'intensité des radiations.
Le paysage au-dessus duquel ils dérivaient était si merveilleusement beau qu'Arnold était dans le ravissement. S'il lui fallait jamais retourner sur Terre, pensa-t-il, et décrire ce qu'étaient les conditions de vie d'ici, ce lui serait impossible. Sur la Terre, ou sur le plan à quatre dimensions, il n'existe aucun mot pour décrire la vie sur cette cinquième dimension.
— Oh ! que font donc ces gens ? demanda Arnold en désignant un groupe à l'intérieur d'un très agréable jardin.
Ces gens étaient assis en cercle et semblaient — bien que l'idée parût absurde à Arnold — être en train de créer des choses par la pensée.
L'un de ses compagnons se tourna nonchalamment en disant :
— Oh ! eux ? Ils préparent simplement des choses qui, plus tard, seront envoyées à certaines personnes sur Terre en tant qu'inspiration. Voyez-vous, Arnold, nombre de messages que nous adressons aux humains à l'esprit obtus, dans le but d'élever leur niveau spirituel, ont leur origine ici. Malheureusement, pour le peuple de la Terre tout doit être utilisé à des fins de destruction, de guerre et de gain capitaliste.
Ils s'élevaient maintenant à grande vitesse dans les airs. Arnold fut très étonné en remarquant qu'il n'y avait pas de routes ; il en conclut que tout le trafic devait se faire par air.
Ils aperçurent d'autres parcs que les gens parcouraient d'un pas de promenade.
— La marche est pour nous un plaisir, dit l'un des guides, et aussi le moyen de nous rendre lentement dans certains endroits, aussi n'avons-nous que des sentiers où nous pouvons pratiquer la marche et de façon plaisante, au bord d'une rivière ou d'un lac. Nous circulons normalement par lévitation contrôlée, comme nous le faisons maintenant.
— Mais qui sont tous ces gens ? demanda Arnold. J'ai une impression déconcertante de — eh bien, il me semble reconnaître certains d'entre eux. C'est, bien sûr, parfaitement absurde, irrationnel. Il est tout à fait impossible que je connaisse qui que ce soit ici, ou que quelqu'un me connaisse, et cependant j'ai le sentiment précis et étrange de les avoir déjà vus. Qui sont-ils ?
Les deux guides ayant regardé les gens en question, répondirent :
— Oh, EUX ! Eh bien, celui-ci qui parle avec ce gros homme était connu sur Terre sous le nom de Léonard de Vinci, et celui auquel il s'adresse était, lui, Winston Churchill. Là-bas — indiquant un autre groupe — vous voyez Aristote qui, en des temps bien lointains, était connu sur Terre comme le Père de la Médecine. Il a eu pas mal de peine à monter ici, car on considéra qu'au lieu d'être le Père de la Médecine, il n'avait fait qu'en retarder les progrès de beaucoup, beaucoup années.
— Oh ! comment cela ? demanda Arnold en regardant en direction du groupe.
— C'est bien simple. On proclama qu'Aristote possédait la connaissance totale de la médecine et savait tout ce qu'il y avait à savoir concernant le corps humain. Ce qui fait que toute tentative en vue d'approfondir les recherches fut jugée comme un crime. Et c'est ainsi que fut décrété passible de la peine de mort l'acte consistant à disséquer un corps, à faire des recherches d'ordre anatomique, car c'eût été une insulte à Aristote. Ce qui retarda les progrès de la médecine pendant des centaines et des centaines d'années.
— Mais, est-ce que tout le monde vient ici ? demanda Arnold. Il ne semble pas y avoir beaucoup de gens, si c'est le cas.
— Oh non, non, non, bien sûr que tout le monde ne vient pas ici. Rappelez-vous le vieil adage : ‘Beaucoup d'appelés et peu d'élus’. Beaucoup restent sur le bas-côté de la route. On trouve ici un petit nombre de personnes de mentalité ou de spiritualité très avancées. Elles sont ici dans un but spécial, celui d'essayer de faire progresser l'humanité sur Terre.
Arnold eut un air très sombre. Il éprouvait un terrible sentiment d'inconfort, de culpabilité. Il finit par dire humblement :
— Je crois qu'une erreur a été commise ; je ne suis, voyez-vous, qu'un pauvre moine et n'ai jamais aspiré à être autre chose. Quand je vous entends dire qu'il y a ici des gens de mentalité ou de spiritualité supérieures, j'en conclus alors que j'y suis sous de faux prétextes.
Les deux guides lui sourirent en disant :
— Les gens de bonne spiritualité se jugent généralement mal. Vous avez passé les tests nécessaires et votre psyché a été examinée en très grands détails. C'est pourquoi vous êtes ici.
Ils accélérèrent, laissant derrière eux les terres d'agrément, montant vers ce que, sur un autre plan, Arnold aurait appelé une région élevée. Il constata qu'avec l'amélioration de sa vision spirituelle et de sa compréhension de la cinquième dimension il lui aurait été impossible d'expliquer à quiconque ce qui s'y passait. Avant leur descente et leur atterrissage en une cité très spéciale, il posa une autre question :
— Dites-moi, est-ce qu'il arrive que des gens du plan terrestre viennent ici et puis retournent sur Terre ?
— Oui, dans des circonstances très particulières, des personnes très spéciales qui ont été choisies dès le départ pour descendre, montent ici pour un temps pour être — disons — mis au courant de ce que sont les choses à ce moment-là et recevoir de nouvelles informations concernant ce qu'ils doivent dire aux gens de la Terre.
Ils foncèrent vers le bas, tous trois, comme liés par d'invisibles liens et Arnold entra dans une nouvelle phase d'existence — une phase située au-delà de la compréhension des humains et à laquelle ils se refuseraient de croire.
Le rêve du vieil auteur
Le vieil auteur fit un rêve, et voici dans quelle ambiance se déroula son rêve. Il était assis dans son lit, un ancien lit d'hôpital, avec sur ses genoux la petite machine à écrire. Vous vous souvenez de cette machine à écrire ? D'un jaune canari, elle lui avait été offerte par son vieil ami Hy Mendelson ; une belle petite chose légère qui faisait gaiement clic-clac quand on s'en servait correctement.
Miss Cleopatra était étendue auprès de lui. Elle rêvait à quoi rêve toute Lady Chatte Siamoise quand elle est bien nourrie et au chaud. Miss Cléo ronflait à la manière d'un vieux trombone, en supposant qu'un trombone ait jamais ronflé. Mais le bruit de la machine à écrire sous une main peu experte était d'une pénible monotonie, et le ronronnement du trafic, à l'extérieur, avait l'intensité d'un essaim d'abeilles qui butineraient un champ de fleurs par un beau jour d'été.
Le Vieil Auteur avait un terrible mal de dos. C'était comme si du bois mort cassé lui rentrait dans la chair en lui pinçant les nerfs. Il ne pouvait bouger vu qu'il est paraplégique — vous savez, incapacité d'utiliser ses deux jambes. Et, de toute façon, bouger aurait signifié déranger le beau rêve de Miss Cleopatra — et une superbe petite chatte comme Miss Cléo ne pouvait avoir que des rêves merveilleux qui ne devaient PAS être troublés. Mais la douleur finit par s'apaiser et la frappe se ralentit. Le Vieil Auteur finit par dire avec une touche de rudesse dans le ton : "Allez, disparais, toi, machine à écrire. Je t'ai assez vue." Et sur ce il la glissa sur une petite table placée près de son lit. Se pelotonnant de son mieux, il ferma les yeux, et d'après les rapports ultérieurs de deux personnes partiales, LUI aussi ronfla d'un ronflement sonore, irritant et monotone. De toute façon, il ronflait et comme il ronflait il devait donc être endormi.
Les images commencèrent à défiler dans son rêve. Il se voyait flottant au-dessus des rues et savait qu'il était dans sa forme astrale ; mais il pensa : "Oh, mon Dieu, j'espère que je porte mon pyjama !" parce que tant de gens oublient les conventions de la civilisation quand ils voyagent dans l'astral, lesquelles exigent que l'on couvre certaines parties, au moins, de son anatomie.
Le Vieil Auteur, qui dérivait, s'immobilisa soudain. Une voiture de sport approchait et le vieux terme ‘à fond de train’ convenait dans ce cas. C'était une petite voiture décapotable, une de ces petites choses anglaises rapides, genre Austin-Healey ou Triumph, ou quelque chose d'analogue et qui filait sur la route. Mais la conductrice, une jeune femme, n'était pas du tout attentive, ses longs cheveux au vent, ce qui l'obligeait parfois à rejeter quelques mèches qui lui cachaient la vue. C'est au moment précis où elle avait la main levée pour se débarrasser d'une mèche folle qu'une voiture — une vieille guimbarde lourde — déboucha d'une route transversale, s'arrêtant pile contre la petite voiture !
Il y eut un effroyable BONK, puis un bruit de métal arraché, un son, en fait, assez semblable à celui d'une boîte d'allumettes qu'on écrase dans les mains. La vieille guimbarde fut rejetée sur le côté de la route. Un homme sortit du siège du conducteur, courbé en deux, et vomit sur la chaussée suite au choc. Son visage pâli par la frayeur ressemblait à celui de quelqu'un qui vient de souffrir du mal de mer — dans son cas il s'agissait du mal de voiture.
Des curieux, le regard interrogateur et la bouche ouverte, accouraient de toutes parts. Par les fenêtres, les gens se penchaient en tendant le cou, et de jeunes garçons débouchaient du coin de la rue en criant à leurs petits camarades de venir voir le ‘merveilleux accident’.
Un homme courut téléphoner à la police ; ce fut très vite la cacophonie bien connue annonçant l'arrivée de la police et de l'ambulance venue pour ramasser les restes. Et des restes, il y en avait ! La voiture de police stoppa d'abord en dérapant, puis dans cette course à qui arriverait le premier, l'ambulance s'arrêta en faisant une embardée. Les deux policiers sautèrent de leur véhicule et les ambulanciers firent de même. Tous se dirigèrent vers les deux voitures.
On se bousculait pour voir et on criait. Regagnant sa voiture en courant un des policiers saisit le micro et, braillant, demanda un camion de remorquage. Il hurlait tellement qu'on avait l'impression que même sans radio tout le monde dans la ville aurait pu l'entendre.
Très vite on aperçut au bout de la rue une lumière jaune éblouissante, et un camion de remorquage s'avança en sens interdit. Mais ces choses-là sont normales quand il y a urgence. Le camion tourna et recula vers l'épave. La petite voiture Austin-Healey ou Triumph, ou autre marque, fut tirée en arrière. Au moment où elle s'arrêta, le corps de la jeune femme tomba sur le sol. Elle était encore secouée par les dernières manifestations d'une vie qui la quittait.
Le Vieil Auteur flottait au-dessus de la scène en produisant un son astral qu'on pourrait rendre par un ‘tsk ! tsk !’ Puis il regarda derechef, car au-dessus du corps maintenant presque complètement mort de la jeune femme un nuage se formait. Et alors, la corde d'argent reliant le corps astral au corps physique s'amenuisa et se rompit, et le Vieil Auteur vit que c'était l'exacte réplique du corps de la jeune femme. Il s'apprêtait à partir à sa suite et s'écrier : "Hé ! Miss, hé ! Miss, vous avez oublié votre culotte !" Il se souvint alors que de nos jours les jeunes personnes ne portent plus ce genre de choses, mais plutôt des slips, et il réfléchit qu'on ne pouvait décemment courir après une jeune femme pour lui dire qu'elle avait perdu son slip, son soutien-gorge, et le reste. En même temps il se rappela qu'il était paraplégique — il avait oublié, dans l'excitation du moment, qu'il n'était plus paraplégique dans l'astral. Aussi la jeune femme s'en alla-t-elle en dérivant vers les royaumes d'en haut.
En bas, sur les lieux de l'accident, les hommes du camion-remorque poussaient et rassemblaient ce qui aurait pu être deux bouteilles de ketchup ou de gelée de framboise. La voiture des sapeurs-pompiers s'avança, brancha ses appareils et arrosa la route, la nettoyant du sang et de l'essence répandus.
On caqueta longuement, et le Vieil Auteur fut bientôt las de suivre ce qui se passait. Voitures en fer-blanc retournant au stock de fer-blanc. Il leva les yeux juste à temps pour apercevoir le postérieur de la jeune femme, obscurci par un nuage. Il la suivit.
Il se dit que c'était, après tout, une façon agréable de passer une partie du chaud après-midi d'été. Aussi, possédant une grande expérience du voyage astral il s'élança vers le haut, montant, montant toujours jusqu'au moment où dépassant la jeune femme, il arriva ‘là’ avant elle.
Elle était morte physiquement, mais vivante de ‘l'Autre Côté’ et pour le Vieil Auteur, c'était toujours un spectacle intéressant que de voir les nouveaux venus s'approcher des métaphoriques Grilles Dorées. Il entra donc dans le royaume que certains appellent ‘l'Autre Côté’ et d'autres ‘le Purgatoire’, mais qu'on devrait simplement considérer comme un relais d'accueil. Il se tint au bord d'une route, et la jeune femme surgit soudain tout droit du milieu de la route, bondit quelques pieds (m) dans l'air puis retomba au niveau du sol.
De quelque part, un homme apparut et s'adressa à elle en demandant : "Nouvelle Arrivée ?" La jeune femme le regarda d'un air dédaigneux et tourna la tête. L'homme s'enquit alors :
— Hé ! Miss, vos vêtements ?
La jeune femme baissa les yeux avec une expression d'horreur et rougit de la tête aux pieds, devant, derrière, bref de partout. Elle regarda l'homme, puis le Vieil Auteur — oui, c'était un homme aussi ! — et elle partit en courant, ses pieds martelant la route lisse.
Elle allait, se hâtant, et atteignit une bifurcation. Elle s'arrêta un instant et murmura :
— Non, je ne vais pas prendre à droite, la droite c'est le parti conservateur ; je préfère prendre la gauche, j'ai une chance de finir avec des bons socialistes.
Elle partit donc en galopant sur la route de gauche, ignorant que les deux routes aboutissaient au même point. Tout comme dans le vieux chant des Highlanders Écossais : "Vous prenez la route du haut, je prends celle du bas et je serai en Écosse avant vous." Les deux routes n'étaient qu'une expérience permettant à l'ange enregistreur (il aime qu'on l'appelle ainsi) d'avoir quelque idée du type de personne qu'il allait rencontrer.
La jeune femme diminua progressivement son allure. Le Vieil Auteur, plein de sagesse en ce qui concerne les voies de l'astral, se contenta de flotter derrière elle en jouissant du paysage. La jeune femme s'arrêta. Devant elle se dressaient des grilles scintillantes, ou plutôt ce qui lui parut des grilles scintillantes, son esprit ayant été conditionné et prêt à croire au paradis et à l'enfer, aux Grilles Dorées, etc. Elle s'arrêta et un vieil ange charmant lui ouvrit les Grilles en disant :
— Voulez-vous entrer, Miss ?
Elle le regarda, répondant sur un ton hargneux :
— Ne m'appelez pas ‘Miss’, mon ami. Il faut me dire Madame (soit ‘Ms’, le nouveau terme neutre anglophone qui ne précise pas le statut marital — NdT), et souvenez-vous-en.
Le charmant vieil ange sourit et dit :
— Oh ! parce que vous êtes l'une d'entre ELLES, hein ? J'aurais cru que vous étiez une ‘Miss’, vu que vous n'avez pas de vêtements, voyez-vous ? (jeu de mots : ‘miss’, en anglais, signifie aussi manquer/ne pas avoir — NdT)
La jeune femme baissa les yeux, rougissant de nouveau, et le vieil ange ricana dans sa longue barbe en disant :
— Allons, voyons, ne soyez pas nerveuse, jeune femme, ou est-ce jeune homme ? J'ai tout vu, vous savez, plus rien ne m'étonne. Avant, arrière, et tout le reste. Vous entrez chez nous, et c'est tout. L'Ange Enregistreur vous attend.
Il ouvrit un peu plus les Grilles et elle entra, puis il les referma derrière elle avec un bruit retentissant — bruit bien inutile, pensa le Vieil Auteur tout en flottant au-dessus des Grilles. Mais le vieil ange — elle savait que c'était un ange à cause du joli peignoir qu'il portait, à cause aussi des ailes fixées à ses épaules et qui s'agitaient faiblement quand il marchait — mais, de toute façon, le vieil ange l'escorta jusqu'à une porte qu'il ouvrit en disant :
— Vous entrez là, vous suivez ce corridor et vous trouverez l'Ange Enregistreur assis dans le hall tout au bout. Vous feriez bien d'être gentille avec lui. Ne soyez pas trop méprisante et ne jouez pas exagérément du ‘Madame’ si vous ne voulez pas qu'il vous inscrive pour les régions inférieures, car ce qu'il déclare est définitif.
Il se détourna et buta presque dans le Vieil Auteur qui lui dit :
— Salut, Pop ! Alors, vous voilà avec une nouvelle arrivée, pas vrai ? Entrons ensemble voir le spectacle et nous divertir un peu.
— Oui, dit le Gardien de la Grille, le business n'a pas été bien drôle ce matin. Il est arrivé tant de gens vertueux que j'étais las de les laisser entrer. Je vais aller avec vous regarder et m'amuser un peu. Les autres peuvent attendre un moment.
C'est ainsi que l'Ange du Portail de la Mort et le Vieil Auteur s'en allèrent bras dessus bras dessous le long du corridor, puis dans le grand hall, s'asseyant finalement sur un siège astral pour observer la jeune femme dont le postérieur se tortillait nerveusement tandis qu'elle se dirigeait vers l'Ange Enregistreur.
C'était un homme petit et gros dont les ailes n'étaient pas très bien ajustées et qui s'entrechoquaient dès qu'il parlait, un peu à la manière d'une vieille dame dont le dentier mal fixé est toujours sur le point de tomber. Eh bien, c'était le cas pour l'Ange Enregistreur dont les ailes donnaient de petites saccades chaque fois qu'il bougeait et, pour aggraver les choses, menaçaient de faire choir son halo. Avec étonnement, la jeune femme découvrit que ce halo était, en fait, tenu par des bandes de ruban adhésif. Elle renifla violemment d'un air dégoûté, trouvant tout ici vraiment par trop spécial, mais juste à cet instant l'Ange Enregistreur regarda son visage — ayant d'abord lorgné tout le reste — et il demanda :
— Date de la mort ? À quel endroit ? Où votre mère est-elle morte ? Et où est votre père à présent, paradis ou enfer ?
La jeune femme renifla et renifla. Tout cela commençait à terriblement l'embarrasser ; la façon dont les gens la regardaient la gênait, et de toute façon le pollen de certaines fleurs des Champs Célestes lui chatouillait les narines. Soudain, elle eut un éternuement terrible qui faillit emporter le halo de l'Ange Enregistreur.
— Oh ! je vous demande pardon, dit-elle gênée. J'éternue toujours quand je sens d'étranges odeurs.
L'Ange du Portail de la Mort eut un petit rire sifflant :
— Oh ! oui, vous savez, lui, dit-il en montrant du doigt l'Ange Enregistreur, il pue un peu. Nous avons pas mal de gens qui éternuent dès qu'ils s'approchent de lui.
Ayant regardé les papiers qu'il avait devant lui, l'Ange Enregistreur marmonna :
— Oh oui, date de la mort, date de ceci, de cela. Bon, pas besoin de tout cela. Je lui pose des questions, mais si la jeune femme devait me donner les informations, j'en aurais pour la journée à remplir des formulaires... enfin toute la paperasserie, vous savez bien...
Il regarda soudain le visage de la jeune femme et demanda :
— Dites donc, vous n'auriez pas par hasard quelques mégots. J'en fumerais bien un. J'ai remarqué — et c'est drôle — que quand les gens viennent ici ils jettent toujours leurs mégots. Ils sont bigrement mieux dans les quartiers ‘enfer’, parce que là ils sont nombreux à fumer, en tout cas, avant leur fin.
La jeune femme secoua la tête, de plus en plus ahurie, indiquant que non, elle n'avait pas de cigarettes ni rien qui soit fumable. Ce qui amena un grognement de la part de l'Ange Enregistreur.
— Où êtes-vous morte ? Avez-vous eu un bon entrepreneur de pompes funèbres ? demanda-t-il.
Il fouilla dans ses papiers et en sortit une carte :
— ‘I. Digsem, Buryemall Unlimited. Pompes funèbres. Incinération.’ Voilà, c'est là où vous avez dû être traitée. Nous avons beaucoup de clients arrangés par leurs soins ; nous voyons immédiatement s'ils ont été bien traités en regardant leurs cicatrices, en voyant par où le sang a été retiré — il montra du doigt l'aine de la jeune femme — parce qu'un tas de jeunes spécialistes aiment mettre les aiguilles dans cet endroit-là pour vider le sang. Mais certains d'entre nous préfèrent que ce soit par le cou. Cette méthode évite que les gens ne crachent et n'expectorent.
Il s'arrêta, réfléchit un instant et ajouta :
— Mais je suppose que cela n'a pas beaucoup d'importance quand ils sont morts ! Pas vrai ? Je n'y avais jamais pensé avant.
La jeune femme qui se tenait toujours là finit par baisser les yeux et poussa un cri de fureur :
— Regardez ce que vous avez fait ! hurla-t-elle, vous m'avez enregistrée sur cette fiche comme ‘Miss’. Ce n'est pas ‘Miss’, c'est ‘Madame’. Je vous demande de rectifier cela sur-le-champ ; je ne permettrai pas cette discrimination.
Elle fulminait tant et si bien qu'elle devint rouge des pieds à la tête, ce qui était parfaitement visible, vu qu'elle n'avait aucun vêtement. Elle tapait du pied de colère. L'Ange Enregistreur émit quelques petits bruits apaisants, puis dit :
— Doucement, maintenant, doucement ! Vous savez où vous êtes, n'est-ce pas ?
Puis, en manière de rebuffade, il arrondit les lèvres et imita un certain bruit qu'on peut qualifier d'incongru.
— Eh bien, Miss — nous n'admettons pas de ‘Ms’, ici — vous avez déjà décidé où vous irez, parce que l'expérience Céleste est refusée à toute personne du M.L.F. ou à celles des médias. Au lieu de cela, elles descendent aux champs de l'enfer. Alors, voilà votre lot, ma belle. Préparez-vous à reprendre la route pour descendre. Je vais téléphoner maintenant au vieux Nick (le diable — NdT) pour lui signaler votre arrivée. Ne manquez pas de le saluer de ma part parce que, entre lui et moi, il y a une espèce de défi permanent — à savoir qui peut voler le plus de clients à l'autre. Avec vous, il marque un point, cela parce que vous êtes du M.L.F. !
Il se tourna vers la corbeille à papier, y jeta la fiche après l'avoir froissée, puis ayant soigneusement mis de l'ordre sur son bureau, il plaça dessus une pile de papiers vierges.
La jeune femme regarda autour d'elle d'un air incertain, puis se tourna vers le Vieil Auteur en disant :
— Jamais vu des gens manquant de serviabilité à ce point-là. Il y a une terrible discrimination. Je me plaindrai certainement au Gros Bonnet quand je le rencontrerai. Mais comment me rendre aux régions infernales à partir d'ici ?
Le Vieil Auteur la regarda avec pitié et trouva dommage qu'elle ait à aller en enfer, car elle pouvait s'attendre à y rôtir sérieusement étant donné son mauvais caractère et son attitude.
— Peu importe, répondit-il, la route que vous prenez. Toutes mènent en enfer à l'exception d'une — et c'est elle que vous avez ratée. Prenez ce chemin en pente, suivez-le et vous verrez que vous serez vite en bas.
La jeune femme laissa échapper une espèce de reniflement en disant :
— Eh bien ! n'allez-vous pas m'ouvrir la porte ? Vous vous croyez un gentleman ?
Le Vieil Auteur et le Gardien du Portail de la Mort la regardèrent avec étonnement, puis le Gardien lui répondit :
— Mais vous êtes une de ces femmes libérées ; si j'ouvre la porte pour vous, vous direz que nous vous dénigrons et que nous entravons vos droits, dont celui de pouvoir ouvrir vous-même cette damnée porte !
Le Gardien se tourna avec un grognement et s'empressa d'aller reprendre son poste ; quelqu'un essayait d'entrer et secouait les barreaux.
— Venez, suivez-moi, dit le Vieil Auteur, je vous montre le chemin. J'ai pas mal d'amis là, en bas, et naturellement, beaucoup plus d'ennemis encore. Mais soyez prudente quand vous serez là, car une bonne moitié de la population vient du monde des médias et ils ne sont pas très appréciés. Allons, venez.
Ils prirent une route qui descendait et le chemin sembla interminable pour la jeune femme qui se tourna soudain vers le Vieil Auteur en disant :
— Mais n'ont-ils aucun système plus rapide de transport ?
— Oh non, non, répondit-il, vous n'avez pas besoin de système de transport rapide ici, parce que les gens vont en enfer aussi vite qu'ils peuvent y aller. Regardez, là, en bas, les gens de la Terre, dit-il.
Il lui donna un petit coup de coude pour l'inviter à regarder depuis le bord de la route. Et là, à son grand étonnement, elle vit en bas les habitants de la Terre.
— Vous voyez, continua le Vieil Auteur, cet homme-là assis derrière son grand bureau ? Eh bien, je suis à peu près sûr que c'est un éditeur, ou peut-être...
Il s'arrêta un instant, joua à caresser sa barbe et reprit avec animation :
— Oui, oui, j'ai trouvé ; c'est un agent littéraire ! Quand vous serez dans les régions inférieures, vous pourriez l'arroser d'une bonne pelletée de braises bien rouges. Cela lui servira ‘d'inspiration à se repentir’.
La route fit une courbe et là devant eux se dressaient les Grilles de l'Enfer toutes rougeoyantes, leurs étincelles illuminant l'obscurité. Arrivée près des Grilles en compagnie du Vieil Auteur, la jeune femme vit un diable se saisir de son trident et d'une paire de gants en amiante. S'étant ganté rapidement, il attrapa les poignées de la Grille qu'il ouvrit toute grande en déchargeant un nuage de fumée et une pluie d'étincelles.
— Allez, venez, ma petite, dit-il à la jeune femme. Nous vous attendions pour vous joindre à nous. Nous savons comment traiter les jeunes féministes comme vous. Nous vous enseignerons que vous êtes un parfait ‘sexe symbole’.
Et se tournant, il poussa la jeune femme devant lui, et tout doucement lui planta les branches de sa fourche dans le postérieur. Elle bondit dans l'air en poussant un cri effroyable, ses pieds s'agitant désespérément avant de toucher à nouveau le sol. Le diable Gardien des Grilles se tourna vers le Vieil Auteur :
— Non, non, mon vieux, lui dit-il, vous ne pouvez pas venir ici ; vous avez eu votre temps d'enfer sur la Terre. Nous allons maintenant le faire payer à tous vos détracteurs et à tous ceux qui vous ont persécuté. L'heure a sonné pour eux d'être mis à rôtir. Vous rebroussez chemin et créez un peu plus de discorde, car nous voulons davantage de victimes ici pour pelleter le charbon et s'occuper des scories. Allez-vous-en !
Et la jeune femme disparut du rêve du Vieil Auteur. Elle disparaît également de nos pages et nous ne pouvons que conjecturer, peut-être de façon obscène ou libidineuse, sur le sort d'une telle jeune femme aux courbes et aux volumes harmonieusement placés, condamnée à une atmosphère si admirablement cauchemardesque, bien qu'elle aurait admis elle-même ne pas être tout à fait digne de l'atmosphère céleste.
Le Vieil Auteur s'en retourna donc au long du sentier, les yeux et les oreilles ouverts aux spectacles et aux sons qui composaient pour une large part la vie de cette région infernale de l'Autre Côté. Regardant autour de lui, il vit l'enfer. De grandes gerbes de flammes montaient dans le ciel, ainsi que des choses qui ressemblaient à des boules de feu — ces choses caractéristiques des feux d'artifice. Il y avait aussi des averses et des averses d'étincelles brillantes qui montaient et retombaient après avoir décrit leur parabole. À tout moment on entendait des cris, des hurlements, et toute cette zone était d'une teinte rougeâtre particulièrement désagréable. Comme le Vieil Auteur se détournait, il y eut le brouhaha de la porte rouge qui s'ouvrit, et les cris de : ‘Auteur ! Auteur !’ Une équipe infernale (quel dommage qu'elle ne fut pas céleste !) se précipita par les grilles ouvertes et grimpa la pente tout en criant : ‘Auteur ! Auteur !’
Le vieil homme laissa échapper un soupir apte à faire éclater les coutures de son pantalon — s'il en avait porté un — et revint en arrière. À présent, il serait sans doute préférable de préciser, à l'intention des lectrices, que s'il n'avait pas de pantalon il portait cependant la robe appropriée au lieu et à la situation.
Il y eut quantité d'appels, de gesticulations, de cris et tout le reste tandis que l'Auteur redescendait la colline pour s'asseoir sur un banc qu'il quitta bien vite à cause de la chaleur. Un homme de très forte taille, muni de cornes soigneusement polies, passa les grilles. Il avait une queue terminée par une touffe de poils agréablement ornée d'un nœud bleu. Je suppose que le bleu était là pour créer un contraste avec la note rouge dominante de l'atmosphère. Il sortit et vint saluer le Vieil Auteur en disant :
— Vous savez que vous pourriez m'être bien utile ici. Je pourrais vous offrir un bon boulot, là, en enfer. Qu'en dites-vous ?
Le Vieil Auteur jeta un coup d'œil autour de lui en répondant :
— Je ne sais pas ; c'est tout un dépotoir, vous savez.
Lord Satan paraissait encore plus diabolique et se curait les dents avec un éclat de bois provenant de quelque vieux cercueil sur lequel il avait trébuché en sortant. Comme il frottait le bois contre ses dents, il fit jaillir de minuscules étincelles. Certaines piquèrent en direction du Vieil Auteur qui s'en écarta très vivement.
— Vous écrivez à un rythme d'enfer, Mon Vieux, dit Satan. C'est ce que je veux. Vous pourriez m'être bigrement utile et j'ai beaucoup à vous offrir, savez-vous. Que voulez-vous ? Dames ou jeunes filles ? Petits garçons ? Non, ne vomissez pas ici ! Ce serait l'esclandre avec la presse si vous le faisiez. Ou qu'aimeriez-vous d'autre ?
Le Vieil Auteur se sentait, ma foi, un peu nauséeux à l'idée de se voir offrir des petits garçons, mais il pensa alors aux dames ou aux jeunes filles, aux petites femmes faciles — et cela ne lui parut pas plus attirant. Après tout, personne n'ignore quels ennuis les femmes peuvent vous apporter...
— Je vais vous dire ! s'exclama le diable, une lueur dans l'œil. Je sais ce que vous aimeriez ! Que diriez-vous d'un paquet de femelles du M.L.F. Vous pourriez leur démontrer la stupidité de cette histoire de libération. Oui, je peux vous en donner autant que vous voulez. Certaines sont vraiment d'horribles créatures. Vous n'avez qu'un mot à dire et vous serez servi.
— Non, répondit le Vieil Auteur d'un air renfrogné. Je ne veux pas de ces femmes libérées ; envoyez-les aussi loin que possible, gardez-les hors de mon chemin.
Satan éclata d'un rire sonore et l'œil allumé d'un éclair vraiment diabolique, il s'écria :
— Je sais, je sais ! Et que diriez-vous de quelques personnes des médias ? Vous pourriez vraiment avoir un sacré moment avec eux ! Vous pourriez les laisser pondre leurs écrits injurieux, et ensuite leur faire rentrer leurs paroles dans la gorge. Oui, ce serait la chose pour vous : vous amuser aux dépens des médias ; ils se sont suffisamment payé votre tête. Qu'en dites-vous, Mon Vieux, eh ?
L'Auteur, de nouveau, secoua la tête.
— Non, non, je ne veux pas avoir affaire avec ces gens à peine humains que sont les gens des médias. Ils sont véritablement diaboliques : vos servantes et vos hommes de main. Ne les laissez pas m'approcher car je n'ai aucune sympathie pour eux. J'aimerais même craquer une allumette supplémentaire sous la marmite où ils bouillent, ou quel que soit ce que vous leur faites subir.
Le diable s'assit sur un endroit frais, et de son postérieur s'éleva une vapeur inquiétante. Il croisa les jambes, et sa queue se mit à battre au rythme de sa pensée. Soudain, il bondit sur ses pieds avec un cri de triomphe :
— Je sais, je sais ! Que diriez-vous d'un beau yacht, ou bien, comme vous avez toujours été intéressé par les bateaux à aubes, que diriez-vous d'un beau bateau à aubes qui vous appartiendrait ? Vous pourriez avoir un équipage infernal mixte, et vous donner un diable de bon temps en vous promenant sur les lacs chauds et tout le reste. Vous pourriez avoir la Mer Rouge comme terrain de jeu. Vous savez qu'elle est rouge de sang humain ; vous aimeriez ça ; le sang chaud a vraiment un très bon goût.
Le Vieil Auteur le regarda dédaigneusement et dit :
— Diable, vous êtes plutôt ignorant. Ne comprenez-vous pas que si j'avais un bateau à aubes je serais dans l'eau bouillante, car c'est à peu près la température de la mer rouge de sang humain.
En riant le diable répondit :
— Vous faites une montagne d'une chose insignifiante. De toute façon, quel est le problème ? Vous avez été dans l'eau bouillante toute votre vie, pas vrai ? J'aurais pensé que depuis le temps vous en auriez pris l'habitude !
Le Vieil Auteur jouait avec ses pieds, s'amusant à faire des dessins dans le sable chaud. Le diable baissa les yeux et poussa un cri de douleur en reconnaissant divers symboles religieux tels que la Roue Tibétaine de la Vie, etc. Il hurla de douleur en sautant et, posant accidentellement un de ses sabots sur un symbole, il partit dans l'air avec un ‘whoosh’ et disparut directement au-dessus des grilles rougeoyantes. Quand on le vit pour la dernière fois, il volait en direction de la Mer Rouge de sang humain.
L'étonnement du Vieil Auteur fut tel qu'il s'assit de nouveau sur le banc mais le quitta plus vite encore — le siège étant littéralement en feu vu que le diable s'y était assis. Il secoua sa robe fumante et décida qu'il était temps pour lui de sortir de là — l'enfer n'était décidément pas une place pour lui. Il remonta donc encore une fois la colline, loin de la fosse, et cette fois il prit ses jambes à son cou !
Au sommet de la colline, il rencontra un gardien des fosses qui le salua avec affabilité.
— Hé ! je n'en ai pas vu beaucoup venir par ici, ils partent généralement par là-bas. Vous avez dû être trop bon pour qu'on vous laisse entrer.
Regardant alors le Vieil Auteur, il lui dit :
— Oh oui, mec, je vous reconnais. Vous êtes sûrement quelque chat ; vous écrivez les livres de Rampa, pas vrai ? (cf. ‘Vivre avec le Lama’, du même auteur — NdT) Vous n'êtes pas de nos amis, vous avez empêché trop de mauvaises âmes de venir à nous. Passez votre chemin, mec, nous ne voulons pas avoir de relations avec vous. Allez, partez.
Mais avant que le Vieil Auteur ait eu le temps de s'éloigner, le gardien le rappela :
— Une minute, attendez une minute. Il faut que je vous montre quelque chose.
Il désigna du doigt un étrange dispositif à son côté en disant :
— Vous regardez au travers et vous avez une excellente image de l'enfer. C'est intéressant. Vous voyez tous les systèmes de parcages. Dans l'un, nous avons les éditeurs, les agents dans l'autre, les gens des médias dans un autre, et là-bas, à gauche, ce sont les femmes du M.L.F. La porte à côté ce sont les anciens d'Eton — et vous savez, ils ne fraternisent pas du tout. Mais venez et regardez par vous-même.
Le Vieil Auteur approcha avec précaution, puis renonça bien vite devant la chaleur infernale qui s'échappait des voyants. Sans un mot, il reprit la route de la colline.
Arrivé au sommet, il revit les Grilles Dorées que le Gardien s'apprêtait à cadenasser pour la nuit.
— Salut, mec, dit celui-ci en faisant un geste de la main, alors vous avez aimé l'enfer ?
— Non, cria l'Auteur. L'atmosphère est trop infernale, là, en bas.
Le Gardien des Grilles Dorées répondit :
— C'est pire ici dans notre atmosphère céleste, il faut se surveiller constamment, ne jamais dire un vilain mot. Sinon c'est la descente à la fosse et la langue sur la plaque chauffée à blanc. Si j'étais vous, je m'en retournerais écrire un autre livre.
Et c'est ce que fit le Vieil Auteur.
Il poursuivit son chemin, se demandant ce qu'il pourrait bien regarder d'autre ; peut-être la Fontaine de Perles ou encore le Dallage d'Or ? Mais, comme il y réfléchissait, il entendit un bruit sonore quelque part. C'était comme le son de verres s'entrechoquant. Puis il ressentit une douleur soudaine qui le fit sursauter et il revint à la conscience pour entendre une voix qui disait :
— Allons, allons c'est l'heure de votre piqûre.
Et comme il levait les yeux, il vit une affreuse aiguille qui s'apprêtait à pénétrer dans la partie arrière de son individu. La voix reprit :
— Vous écrivez à nouveau sur la vie après la mort ?
— Non, dit le Vieil Auteur. J'en ai terminé. Ce sont les derniers mots de ce livre.