T. LOBSANG RAMPA
Titre original : I Believe
(Édition : 22/04/2020)
Je Crois — (Initialement publié en 1976) Dans ce livre le Dr Rampa nous parle de ce qui se passe exactement quand une personne se suicide et comment il lui faut par la suite rembourser la dette qu'elle a ainsi contractée, laquelle peut s'étendre sur de nombreuses vies à venir — chaque fois les conditions devenant de plus en plus difficiles si cette personne n'arrive pas à apprendre de ses erreurs. Toute personne envisageant le suicide se doit de lire ce volume avant de prendre une mesure aussi draconienne. Il nous parle de Dieu vu sous différentes perspectives, du mouvement de Libération de la Femme et à quel moment les femmes ont pris le mauvais chemin.
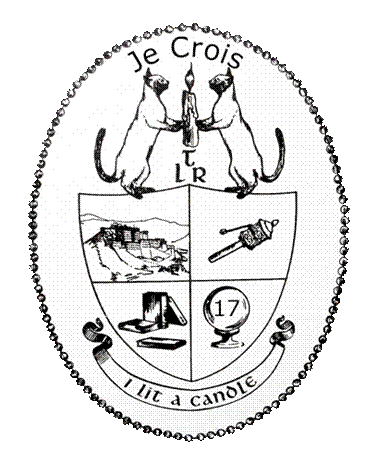
Mieux vaut allumer une chandelle
que maudire l'obscurité.
Le blason est ceint d'un chapelet tibétain composé de cent huit grains symbolisant les cent huit livres des Écritures Tibétaines. En blason personnel, on voit deux chats Siamois rampants (i.e. debout sur leurs pattes de derrière, le terme ‘rampant’ étant ici un adjectif propre à l'héraldique, c'est-à-dire, aux blasons — NdT : Note de la Traductrice) tenant une chandelle allumée. Dans la partie supérieure de l'écu, à gauche, on voit le Potala ; à droite, un moulin à prières en train de tourner, comme en témoigne le petit poids qui se trouve au-dessus de l'objet. Dans la partie inférieure de l'écu, à gauche, des livres symbolisent les talents d'écrivain et de conteur de l'auteur, tandis qu'à droite, dans la même partie, une boule de cristal symbolise les sciences ésotériques. Sous l'écu, on peut lire la devise de T. Lobsang Rampa : ‘I lit a candle’ (c'est-à-dire : ‘J'ai allumé une chandelle’).
Et ainsi les lettres arrivaient, lettres venant d'Ici, lettres venant de Là, lettres venant de Partout, du Nord au Sud, et de l'Est à l'Ouest — des lettres, des lettres, des lettres, exigeant toutes une réponse... Elles disaient : "Parlez-nous davantage de ce qui arrive après la mort. Parlez-nous davantage de ce qu'EST la mort. Nous ne comprenons pas la mort, vous ne nous en dites pas assez, vous n'êtes pas assez précis. Dites-nous tout."... C'est ainsi que, à contrecœur, il me fallut écrire un dix-septième livre, et l'accord général faisant suite à une lecture attentive de tant et tant de lettres fut que le titre en serait :
JE CROIS
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
À
John Henderson
qui croit
et
au Dr Bruce Dummett,
Humaniste
et
un honneur pour l'Humanité
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Table des matières
Chapitre Un
Assise près de la fenêtre entrouverte, Miss Mathilda Hockersnickler, de Upper Little Puddle-patch, était plongée dans une lecture qui semblait l'absorber. Visible au travers des rideaux de fine dentelle, un cortège funéraire défila. Deux voisins se chamaillaient ; mais l'aspidistra (plante d'intérieur — NdT) devant la fenêtre fit que l'incident échappa à Miss Mathilda. Elle était d'ailleurs occupée à lire.
Posant le livre sur ses genoux, rejetant sur son front les lunettes à monture métallique, elle frotta ses yeux rougis. Puis ayant replacé les lunettes sur son nez proéminent, elle reprit sa lecture.
Dans sa cage, un perroquet jaune et vert, aux yeux ronds comme des boutons de bottine, lança un cri rauque :
— Polly veut sortir, Polly veut sortir !
Miss Mathilda bondit.
— Oh, mon Dieu ! s'exclama-t-elle, je suis désolée, mon pauvre chéri ; j'avais complètement oublié de t'installer sur ton perchoir.
Ouvrant la petite porte dorée, elle glissa la main à l'intérieur de la cage et saisit le vieux perroquet déplumé.
— Polly veut sortir ! lança à nouveau l'oiseau.
— Oh, toi ! Stupide bestiole, répliqua Miss Mathilda, tu ES sorti ; je vais te mettre sur ton perchoir.
Et tout en lui parlant, elle le posa sur son perchoir familier qui, long de 5 pieds (1 m 50), portait un petit plateau à son extrémité. Puis ayant fixé une petite chaîne autour de la patte gauche du perroquet, elle s'assura que le bol à eau et le bol à graines étaient bien remplis.
Le perroquet, après avoir ébouriffé ses plumes, se mit alors la tête sous l'aile en accompagnant son geste de petits cris enjoués.
— Ah, Polly, dit Miss Mathilda, tu devrais lire avec moi. Ce livre traite de ce qu'il nous arrive quand nous ne sommes plus sur Terre. J'aimerais savoir ce que croit vraiment l'auteur, ajouta-t-elle en se rasseyant et en arrangeant ses jupes d'un geste pudique pour cacher ses genoux.
Elle reprit le livre, hésita, puis le replaça finalement sur ses genoux et tendit le bras pour se saisir d'une longue aiguille à tricoter. Et alors — avec une vigueur inhabituelle chez une personne de son âge — elle promena l'aiguille tout le long de son dos.
— Ah ! s'exclama-t-elle, comme c'est bon de se gratter. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans mon cache-corset — peut-être quelque cheveu. Oh ! il faut que je me gratte encore un peu ; c'est un tel soulagement.
Et de nouveau elle promena l'aiguille avec vigueur, tandis que son visage rayonnait de plaisir.
Sa démangeaison calmée, elle remit l'aiguille en place et reprit son livre.
— La Mort, se dit-elle à elle-même, si seulement je savais ce à quoi cet auteur croit VRAIMENT après la mort.
Elle s'arrêta de lire un instant, puis tendit la main vers quelques bonbons qu'elle avait placés près du pot d'aspidistra. En soupirant, elle se leva et alla offrir un bonbon au perroquet qui la fixait d'un regard féroce. Il le happa d'un mouvement brusque.
L'aiguille toujours à la main, un bonbon dans la bouche, Miss Mathilda s'installa pour reprendre sa lecture.
À peine avait-elle lu quelques lignes qu'elle s'arrêta : "Pourquoi le Père dit-il toujours que si l'on n'est pas un bon Catholique — un bon pratiquant — on ne peut atteindre le Royaume des Cieux ? Je me demande si le Père se trompe et si les gens d'autres religions vont eux aussi au Ciel."
Un silence intérieur l'envahit, silence qu'elle n'interrompit que par un faible marmonnement, tandis qu'elle cherchait à se représenter certains mots peu familiers : Registre Akashique, voyage astral, les Champs Célestes.
Miss Mathilda reprit sa lecture. La tête sous l'aile, le perroquet dormait profondément, et seuls quelques petits tressaillements rappelaient qu'il était bien vivant. L'horloge d'une église tinta au loin, et Miss Mathilda, en sursautant, revint sur Terre. "Oh Dieu, j'ai complètement oublié le thé, et je dois aller à la Réunion des Dames de l'Église."
Elle se leva, tout en prenant le temps de placer un signet brodé dans le livre qu'elle dissimula sous la table.
Elle se hâta d'aller préparer le thé et seul le perroquet aurait pu l'entendre murmurer :
— Oh ! comme j'aimerais savoir ce que cet auteur croit vraiment — comme je voudrais pouvoir lui parler. Quel réconfort ce serait !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sur une lointaine île ensoleillée, qui ne sera pas nommée — bien qu'en vérité elle puisse l'être, vu que tout ceci est véridique — un Gentleman de Couleur s'étirait paresseusement sous l'ombre généreuse d'un vieil arbre. D'un geste nonchalant, il déposa le livre qu'il lisait et tendit le bras pour atteindre un fruit savoureux qui se balançait au-dessus de lui. Toujours aussi nonchalamment il cueillit le fruit, l'inspecta pour voir s'il n'y avait pas d'insectes, puis il le fourra dans sa bouche.
— Sapristi ! marmonna-t-il, gêné par la grosseur du fruit. Je ne sais vraiment pas où ce type-là veut en venir. Pour sûr, j'aimerais savoir à quoi il croit vraiment.
Il s'étira, essayant de trouver une position plus confortable contre le tronc de l'arbre. Frappant une mouche qui volait, il la manqua et laissa retomber sa main. Il reprit le livre d'un geste lent.
‘La vie après la mort, le voyage astral, le Registre Akashique’. Le Gentleman de Couleur feuilleta rapidement le livre, désirant connaître la fin et se refusant à le parcourir en entier. Butinant, lisant une page par-ci, une phrase par-là, il ne cessait de se répéter : "J'aimerais savoir à quoi il croit."
Mais le soleil était chaud, et le bourdonnement des insectes, assourdissant. Le sommeil, graduellement, gagna le Gentleman. Ses mains laissèrent échapper le livre qui glissa doucement sur le sable. Il se mit bientôt à ronfler, indifférent à tout ce qui se passait autour de lui.
Un jeune homme qui passait jeta un coup d'œil au Noir endormi, puis regarda le livre, et à nouveau le dormeur. S'avançant, il parvint à saisir subrepticement le livre et il s'éloigna d'un air exagérément innocent.
Il entra dans un petit bosquet, puis reparut dans la lumière et traversa une étendue de sable, à la blancheur aveuglante. Le fracas des vagues résonnait dans ses oreilles ; mais il allait, indifférent à leur bruit, car c'était là sa vie : le son des vagues contre les rochers du lagon était une musique quotidienne. Le bourdonnement des insectes comme le crissement des cigales étaient sa vie — et il n'y prêtait plus attention.
Il marchait tout en soulevant le sable fin avec ses pieds, car il ne désespérait pas d'y trouver quelque objet de valeur ou quelque pièce de monnaie ; un de ses amis n'avait-il pas ainsi, un jour, déterré une pièce d'or ?
Un étroit filet d'eau le séparait d'une petite langue de terre où se dressaient trois arbres solitaires. Il le traversa et gagna la bande de terre. Il s'étendit confortablement après avoir un peu creusé le sable. Puis, la tête appuyée contre l'arbre, il regarda le livre qu'il avait subtilisé au dormeur.
Après s'être assuré que personne ne l'observait, et certain d'être en sécurité, il s'installa à nouveau, promenant une main à travers ses cheveux crépus, de l'autre tenant le livre ; il en regarda d'abord le dos afin de lire la présentation de l'éditeur, puis il le retourna et étudia l'image de la couverture avec ses yeux bridés ; son front et ses lèvres étaient sillonnés de rides minuscules tandis qu'il marmonnait tout en lisant des choses qu'il ne comprenait pas.
Il se gratta l'entrejambe et tira pour ajuster son pantalon. Puis, reposant sur son coude gauche, il tourna quelques pages et se mit à lire.
— Formes de pensée, mantras... Sapristi, mais c'est super ! Peut-être que je pourrais fabriquer une forme-pensée et alors Abigail serait obligée de faire ce que je voudrais. Ça alors, mec, wow ! Sûr que j'suis d'accord avec ça.
Il roula sur le côté, se gratta le nez pendant un moment puis ajouta :
— Je me demande si je peux croire tout ça.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Le renfoncement obscur de la pièce rayonnait d'une atmosphère de sainteté. Une paix absolue y régnait, rompue seulement par le pétillement des bûches qui brûlaient dans l'âtre de la vaste cheminée de pierre. De temps à autre, un jet de vapeur s'échappait, rencontrant les flammes avec un sifflement furieux — vapeur provenant de la moisissure emprisonnée dans les bûches encore humides. À d'autres moments c'était comme une petite explosion qui projetait une pluie d'étincelles. La lumière vacillante venait ajouter à l'ambiance étrange et au mystère qui baignaient la pièce.
Tournant le dos à la porte, un fauteuil très profond se trouvait près de la cheminée. Tout proche était placé un vieux lampadaire démodé fait de baguettes de cuivre, et dans un recoin, une ampoule électrique jetait une lumière douce, de teinte verte. La lumière baissa, puis disparut, cachée par le dos du fauteuil.
On entendit alors une toux sèche et le bruit de pages qu'on tourne. De nouveau ce fut le silence, ponctué par le pétillement du bois et le bruit régulier des pages qu'on tourne.
Une cloche tinta au loin. C'était un tintement lent qui fut bientôt suivi d'un bruit de pas chaussés de sandales et d'un doux murmure de voix. Une porte s'ouvrit, puis se referma avec un bruit sourd. Presque aussitôt s'éleva la musique d'un orgue tandis que des voix d'hommes entonnaient un chant. Quand il cessa, on entendit à nouveau le bruissement du papier, puis le silence retomba, interrompu par des voix marmonnant quelque chose d'incompréhensible, mais très bien pratiqué.
Le livre tomba sur le sol avec un bruit sec, et une silhouette se leva d'un bond.
— Oh Dieu, j'ai dû m'endormir. N'est-ce pas là quelque chose d'étonnant ?
La silhouette en robe sombre se baissa pour ramasser le livre, et le rouvrit à la bonne page. Ayant marqué celle-ci à l'aide d'un signet, l'homme referma le livre avec respect et le plaça sur la table, près de lui. Demeuré pendant un moment les mains jointes et le front plissé, il se leva alors et s'agenouilla en regardant un crucifix fixé au mur. Les mains toujours jointes, la tête baissée, il pria, suppliant Dieu de le guider. Sa prière achevée, il alla mettre une bûche sur les braises rougeoyantes. Il s'assit alors près de la cheminée et resta là, la tête dans ses mains.
D'un geste soudain, il se tapa sur la cuisse et bondit sur ses pieds. Traversant rapidement la pièce obscure, il se dirigea vers un bureau à peine visible dans l'ombre. Il tira un cordon et la pièce fut inondée de lumière. Repoussant le fauteuil, il ouvrit le tiroir du bureau et s'assit. Pendant un moment, il fixa, sans la voir, la feuille de papier qu'il venait de placer devant lui. D'une main distraite, il chercha le livre ; ne le trouvant pas, il grommela quelque chose, et se leva pour aller le prendre sur la table où il était resté.
Revenu au bureau, il feuilleta le livre pour y trouver ce qu'il cherchait — une adresse. Il se hâta de rédiger une enveloppe ; puis, il s'assit, se concentra, réfléchissant à la façon de tourner les phrases qu'il voulait rédiger.
Il se mit bientôt à écrire, et seuls le bruit de sa plume grattant le papier et le tic-tac d'une horloge venaient rompre le silence.
"Cher Docteur Rampa, je suis un prêtre jésuite, maître de conférences à notre collège où j'enseigne les humanités. J'ai lu votre livre et y ai pris un intérêt extraordinaire.
Je crois que seuls ceux qui suivent notre religion sont à même d'obtenir le salut par le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Je le crois fermement lors de l'enseignement que je donne à mes étudiants. Je le crois quand je suis au sein de l'Église elle-même. Mais seul dans l'obscurité de la nuit, sans témoin susceptible d'observer mes réactions ou d'analyser mes pensées, alors il m'arrive souvent d'errer. Ma Croyance est-elle la bonne ? Seul un Catholique peut-il être sauvé ? Les autres religions sont-elles erronées ou sont-elles les œuvres de Satan ? Ou bien ai-je été induit en erreur, ainsi que ceux de ma religion ? Vos livres m'ont grandement éclairé et m'ont permis de venir à bout des doutes dans lesquels se débat mon esprit. C'est pourquoi je vous demanderai, monsieur, de bien vouloir répondre à quelques-unes de mes questions afin de m'apporter une lumière nouvelle, ou de renforcer ce en quoi je crois."
Il signa et s'apprêtait à glisser la lettre dans l'enveloppe quand il éprouva comme un remords. Reprenant la lettre il la déplia et ajouta un post-scriptum : "Je fais appel à votre loyauté pour vous demander, tout dévoué que je suis à votre propre Croyance, de ne pas mentionner mon nom et de garder pour vous le fait que je vous ai écrit — car cela est contraire aux règles de mon Ordre." Puis, ayant apposé ses initiales, il glissa rapidement la lettre dans l'enveloppe et la cacheta. Fouillant ensuite dans ses papiers, il chercha un petit livre dans lequel il releva les frais d'affranchissement pour le Canada. Puis ayant fini par trouver les timbres qu'il lui fallait, il les colla sur l'enveloppe. Avec soin, le prêtre glissa la lettre dans sa soutane, éteignit les lumières et quitta la pièce.
— Ah, Père, dit une voix dans le corridor, allez-vous en ville ou y a-t-il quelque chose que je puisse y faire pour vous ? Je dois y aller et serais heureux de pouvoir vous être utile.
— Non, merci, Frère, répondit le professeur à son subordonné, j'ai envie de faire un tour en ville, j'ai besoin d'un peu d'exercice.
Puis s'étant salués mutuellement avec gravité, chacun partit de son côté ; le professeur sortit du vieux bâtiment de pierre grise patiné par les ans et à demi recouvert de lierre. Il s'éloigna lentement le long de l'avenue, les mains jointes sur son crucifix, marmonnant quelque chose pour lui-même comme avaient l'habitude de faire ceux de son Ordre.
Dans la rue principale, juste au-delà de la grande grille, les gens s'inclinèrent respectueusement sur son passage, certains même se signèrent. Toujours d'un pas lent, le professeur gagna le bureau de poste où se trouvait une boîte extérieure. Se sentant un peu coupable, il jeta un regard à la dérobée pour s'assurer qu'aucun membre de son Ordre ne se trouvait dans les environs. Certain de ne pas être vu, il retira la lettre de sa soutane et la jeta rapidement dans la boîte. Puis, soulagé, il refit la route en sens inverse.
De retour dans son bureau, il reprit sa place au coin de la cheminée où le feu pétillait, et près de la lampe projetant un flot de lumière dirigé vers son livre ; il lut jusqu'à une heure très avancée de la nuit. Quand le moment fut venu de se retirer, il rangea le livre en un lieu secret, et regagna sa cellule en murmurant pour lui-même :
— Que dois-je croire ? Que croire ?
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Le ciel bas enveloppait Londres d'austérité. La pluie ruisselait au long des rues et les passants se hâtaient tout en luttant contre le vent, cachés sous leur parapluie. Londres, les lumières de Londres, et les gens regagnant leur foyer après une journée de travail. Les autobus, ces grands géants rouges, roulaient en éclaboussant les trottoirs et des groupes de gens glacés reculaient à leur passage.
Devant les vitrines des magasins, les gens attendaient l'arrivée de leur propre bus, se précipitant dès que l'un d'eux apparaissait, puis reculant, découragés, en découvrant que ce n'était pas le leur. Londres : une moitié de la population rentrant chez eux et l'autre moitié arrivant au travail.
Dans une maison de Harley Street — cœur du monde médical londonien — un homme aux cheveux gris allait et venait nerveusement sur une peau d'ours jetée devant un feu crépitant. Il arpentait la pièce, les mains derrière le dos, la tête penchée en avant. Soudain il se laissa tomber dans un fauteuil de cuir et sortit un livre de sa poche. Il le feuilleta, cherchant le passage qui l'intéressait — un passage portant sur l'Aura humaine. L'ayant lu une première fois, il le relut. Il resta un long temps, le regard fixé sur le feu ; puis semblant avoir pris une décision, il se leva soudain et passa dans la pièce voisine. Fermant soigneusement la porte, il se dirigea vers son bureau. Écartant une masse de rapports médicaux et de certificats qui restaient à signer, il s'assit et, ouvrant un tiroir, en sortit une feuille de papier à lettre. D'une écriture presque illisible, il écrivit :
"Cher docteur Rampa,
J'ai lu votre livre avec une réelle fascination, une fascination accrue par ma propre croyance — par ma propre certitude — que ce que vous écrivez est vrai."
Il se renversa sur sa chaise et relut ce qu'il avait écrit avant de poursuivre. "J'ai un fils, un jeune garçon brillant qui a subi récemment une opération du cerveau. Depuis cette intervention, il prétend être capable de voir d'étranges couleurs autour du corps des humains, et aussi de voir des lumières autour de leur tête — et cela s'étend également au corps et à la tête des animaux. Nous avons longuement réfléchi à ce problème, nous demandant ce qui dans cette opération n'avait pas marché et pensant que le nerf optique avait peut-être été touché ; mais après avoir lu votre livre je comprends que mon fils est capable de voir l'Aura humaine, et je sais donc que vous écrivez la vérité.
Si vous êtes à Londres, j'aimerais beaucoup vous rencontrer, car je pense que vous pourriez être d'une grande aide pour mon fils.
Bien sincèrement vôtre."
Il se relut et, tout comme un certain prêtre l'avait fait avant lui, s'apprêtait à glisser sa lettre dans l'enveloppe, quand ses yeux rencontrèrent le buste d'un pionnier de la médecine. Comme s'il venait d'être piqué par une abeille, le spécialiste reprit sa plume et ajouta un post-scriptum à sa lettre : "J'ai confiance en vous et sais que vous tairez mon nom et ne révélerez à personne le contenu de cette lettre — la moindre fuite risquant de me déconsidérer aux yeux de mes collègues." Ayant mis sa lettre sous enveloppe, il éteignit soigneusement les lumières et quitta son bureau. Une somptueuse limousine l'attendait. Le chauffeur se précipita pour ouvrir la portière et le docteur ordonna :
— Au bureau de poste de Leicester Square.
La voiture s'éloigna. La lettre fut postée et partit vers sa destination.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Et c'est ainsi que les lettres arrivaient, lettres venant d'Ici, lettres venant de Là, lettres venant de Partout, du Nord au Sud, et de l'Est à l'Ouest — des lettres, des lettres, des lettres, un flot incessant de lettres demandant toutes une réponse, affirmant toutes le caractère exceptionnel de leurs problèmes. Lettres de condamnation, de louange, ou de supplication. Il en vint une de Trinidad, écrite sur une feuille de cahier d'écolier. L'expéditeur qui semblait illettré s'exprimait ainsi : "Je suis un Saint Missionnaire et travaille à la gloire de Dieu. Donnez-moi dix mille dollars et une camionnette neuve. Et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas me faire cadeau de la collection de vos livres parus ? Si vous le faites, alors, je croirai ce que vous écrivez."
Deux jeunes Chinois m'écrivaient de Singapour en me disant : "Nous voulons être docteurs, mais nous n'avons pas d'argent. Nous vous demandons de nous payer le voyage par avion en première classe, de Singapour jusqu'à vous. Nous vous entretiendrons de nos projets et vous dirons comment payer nos études, afin que nous puissions travailler au bien de l'humanité. Et peut-être pourriez-vous ajouter à votre envoi l'argent nécessaire pour nous arrêter à New York où nous serions heureux de voir un de nos amis. Faites cela pour nous, et alors nous vous croirons."
Les lettres arrivaient par centaines, par milliers, et toutes sollicitaient une réponse. Peu, pitoyablement peu de gens pensaient aux frais de la rédaction, de la papeterie, de l'affranchissement. Ils écrivaient : "Parlez-nous davantage de ce qui arrive après la mort. Parlez-nous davantage de ce qu'EST la mort. Nous ne comprenons pas la mort, vous ne nous en dites pas assez, vous n'êtes pas assez précis. Dites-nous tout."
D'autres m'écrivaient : "Parlez-nous des religions. Nous aimerions savoir si, n'étant pas Catholiques, nous avons un espoir après cette vie." D'autres encore disaient : "Fournissez-moi un mantra qui me fasse gagner le Sweepstake Irlandais et je vous donnerai dix pour cent de mes gains si je remporte le premier prix d'un million."
Et une autre personne me disait : "Je vis au Nouveau-Mexique. Il y a ici une mine dont on a perdu la trace. Dites-moi où elle est — il vous est possible d'aller dans l'astral et de le découvrir — et si vous m'informez de son emplacement et que je la trouve et m'en empare, je vous en saurai gré et vous ferai présent d'une somme d'argent."
Les gens demandaient que je leur en dise plus, que je leur dise tout, que je leur dise plus que tout, pour qu'ils arrivent à savoir en quoi croire.
Mrs Sheelagh Rouse, l'air grave, était assise à son bureau, repoussant de temps à autre ses lunettes à monture d'or qui glissaient sur son nez.
Elle regarda le fauteuil roulant passant devant sa porte et dit, assez farouchement :
— Tu n'as écrit que seize livres, pourquoi ne pas en écrire un autre, le dix-septième, et dire aux gens ce qu'ils PEUVENT croire ? Regarde cet amas de lettres qui toutes expriment le désir d'avoir un autre livre de toi, qui te demandent de leur dire ce qu'ils peuvent croire. Je taperai ton manuscrit ! ajouta-t-elle avec vivacité.
Dans le couloir, installées devant le fauteuil roulant, Miss Tadalinka et Miss Cleopatra Rampa sourirent avec contentement. Plongée dans ses pensées, Miss Taddy se gratta l'oreille, réfléchissant à ce qu'impliquerait la rédaction d'un autre livre. Satisfaite, elle se mit debout et d'un pas lent se dirigea vers son fauteuil préféré.
Mama San Ra'ab Rampa leva la tête, et son pâle visage exprima une certaine stupéfaction. Sans un mot — incapable peut-être de parler ! — elle me tendit une carte bleue avec l'en-tête de ‘Mama San Ra'ab Rampa, Pussywillow’, et, au centre de la page, je vis mon propre visage, en bleu, juste comme si j'étais mort depuis longtemps et avais été exhumé trop tardivement. Et au-dessous, le plus singulier et le plus étrange visage de chat siamois que j'aie jamais vu. Je restai muet pendant un moment ; mais je suppose qu'il est plaisant de voir la couverture de son premier livre. Je suis partial parce que ceci est mon dix-septième livre et qu'il n'y a plus rien de nouveau.
— Mama San, qu'est-ce que TU penses de l'idée d'un autre livre ? dis-je. Cloué au lit comme je le suis, est-ce que l'effort en vaut la peine, ou ne ferais-je pas mieux d'y renoncer ?
Mama San, s'étant ressaisie après le choc causé par la couverture, répondit sans hésiter :
— Certainement que tu dois écrire ce livre. Je songe à en écrire un second !
Ayant flairé longuement la couverture en question, Miss Cléo Rampa et Miss Taddy Rampa s'éloignèrent la queue droite. Elles approuvaient visiblement.
C'est alors que le téléphone sonna. L'homme qui appelait était John Henderson, perdu dans les grands espaces américains là où convergent de nombreuses eaux.
— Eh ! patron, dit-il, je viens de lire quelques articles sur vous qui sont fichtrement élogieux. Il y en a un particulièrement bon dans le magazine que je vous ai envoyé.
— Merci, John, répondis-je, mais peu m'importe ce qu'on peut dire de moi dans les journaux ou les magazines. Je ne les lis jamais. Mais que penses-tu d'un autre livre, un dix-septième ?
— Eh bien, patron, dit John, voilà ce que j'attends depuis longtemps de vous entendre dire ! Il est temps que vous sortiez un autre livre. Tout le monde est impatient de vous lire, et je sais que les libraires reçoivent de nombreuses requêtes.
Voilà qui me donnait un coup : tout le monde semblait s'unir, tout le monde semblait souhaiter un autre livre. Mais que peut faire un pauvre diable arrivant au terme de sa vie et contraint de faire face aux impôts féroces dont le taxe un pays totalement indifférent. Et pourtant il faut bien faire quelque chose pour alimenter les feux de la maison ou éloigner de la porte les chacals des contributions.
L'impôt sur le revenu est une des obligations qui m'emplit d'amertume. Je suis très handicapé physiquement et passe une partie de mes journées au lit. Je ne suis nullement une charge pour le pays, mais je suis honteusement taxé, et n'ai droit à aucun abattement du fait que je suis un auteur indépendant. Et cependant il existe ici certaines compagnies pétrolières qui sont exemptées de toutes taxes — cela pour la simple raison qu'elles sont lancées dans des ‘recherches’ qui sont purement mythiques. Et je ne peux m'empêcher de penser à certains de ces trafiquants du culte qui ont mis sur pied une organisation à but non lucratif et qui se payent à eux-mêmes, à leurs parents et à leurs amis, des salaires extravagants — leur étiquette les soustrayant à l'obligation de l'impôt.
Et ainsi, ce livre, le dix-septième, est donc pour moi comme une nécessité, et l'accord général faisant suite à une lecture attentive de tant et tant de lettres fut que le titre en serait : ‘Je crois’.
Ce livre traitera de la vie avant la naissance, de la vie sur Terre, et du passage de la Terre au retour à la Vie de l'Au-delà. Le titre en est ‘Je Crois’, mais c'est tout à fait incorrect : il ne s'agit pas de croyance, mais de CONNAISSANCE. Je peux faire tout ce dont je parle dans mes écrits. Je peux me rendre dans l'Astral aussi aisément qu'une personne passe d'une pièce à une autre. Ce que, sur cette Terre, je suis incapable de faire, jusqu'à la fin de mes jours, sans l'aide de béquilles ou de fauteuil roulant. Mais, dans l'astral, point n'est besoin de béquilles, de fauteuil roulant ou de médicaments. Ainsi, ce sur quoi j'écris dans ce livre est la vérité. Je n'exprime pas une opinion, je ne fais que dire les choses comme elles sont VRAIMENT.
L'heure est maintenant venue d'attaquer le sujet et de passer au Second Chapitre.
Chapitre Deux
Algernon Reginald St Clair de Bonkers venait de s'affaisser sur le sol de la salle de bains. De son corps s'échappaient des sons ressemblant à des miaulements ou à des râles. Une femme de chambre qui passait dans le couloir s'arrêta, saisie de peur, et en tremblant appela derrière la porte.
— Êtes-vous bien, Sir ? Vous sentez-vous bien ?
Ne recevant aucune réponse, elle se décida à entrer.
Au spectacle qu'elle découvrit, elle poussa un hurlement terrible qui monta dans un crescendo de plus en plus nourri. À bout de souffle, elle s'effondra, évanouie, à côté d'Algernon.
Puis des voix agitées se firent entendre ainsi que des bruits de pas dans l'escalier et le long du corridor. Les premiers arrivés s'arrêtèrent devant la porte avec une telle violence qu'ils arrachèrent presque la moquette. Puis, se groupant comme pour se donner du courage, ils risquèrent un œil par la porte restée entrouverte.
Algernon Reginald St Clair de Bonkers gisait la face contre le sol ; le sang s'écoulait d'une large entaille dans la gorge et avait déjà atteint le corps de la femme de chambre tombée inconsciente auprès de lui. Soudain, elle eut un petit mouvement convulsif et ouvrit les yeux. Regardant la mare de sang dans laquelle elle baignait — et avec un cri affreux qui ébranla les nerfs de ceux qui l'entouraient — elle eut une autre syncope, son visage bien immergé, cette fois, dans le présumé sang bleu de son employeur.
Toujours gisant à terre, Algernon avait l'impression que les choses tournaient autour de lui, et que tout était fantastiquement irréel. Il entendait un bruit pénétrant, comme un râle, un bruit horrible de bouillonnement qui allait en diminuant à mesure que le sang s'écoulait de son corps mutilé.
Il était conscient qu'un travail s'opérait en lui. Il y eut soudain un cri perçant qui projeta la femme de chambre contre lui. Le choc soudain chassa Sir Algernon hors de sa propre enveloppe, et il bondit vers le haut comme un ballon relié à une ficelle.
Pendant quelques secondes, il regarda autour de lui, confondu par cette expérience. Il lui semblait qu'il flottait la face tournée vers le sol, et comme il regardait les deux corps situés au-dessous de lui, il vit qu'un Cordon d'Argent reliait son ‘nouveau’ corps à l'ancien corps gisant inerte. Tandis qu'il observait le Cordon, qui devenait gris sombre, d'horribles marques apparurent au point où il joignait le corps, puis il se détacha et tomba tel un cordon ombilical. Mais Algernon demeurait comme collé au plafond. Il appelait à l'aide, ne se rendant pas compte qu'il était à l'extérieur d'un corps désormais sans vie, et dans le plan astral. Il était là, collé au plafond décoré de la maison ancestrale — invisible à tous ceux qui venaient jeter un coup d'œil dans la salle de bains, inspectant les lieux avec effroi, puis disparaissaient, remplacés par d'autres. Il vit la femme de chambre revenir à elle et l'entendit hurler d'effroi en se découvrant dans une mare de sang, puis s'évanouir de nouveau.
Ce fut la voix du maître d'hôtel — une voix ferme et distinguée — qui vint rompre le silence.
— Voyons, voyons, dit-il, ne paniquons pas. Vous, Bert, ajouta-t-il à l'intention du valet de pied, allez appeler la police ; appelez également le Dr Mackintosh et, pendant que vous y êtes, je pense que vous feriez bien de demander aussi l'entrepreneur des pompes funèbres.
Ayant donné ses ordres, il eut un geste impérieux à l'adresse du valet, qui s'en alla.
Remontant les jambes de son pantalon pour ne pas le froisser, il se baissa, saisit avec précaution le poignet de la femme de chambre et poussa une exclamation de dégoût quand sa main toucha le sang. Il l'essuya bien vite sur la jupe de la pauvre fille. Puis, l'agrippant par les chevilles, il la traîna hors de la salle de bains. Ce qui provoqua pas mal de rires étouffés, car la jupe de la malheureuse remontée d'abord jusqu'à la taille finit par s'enrouler à hauteur des épaules. Mais sur un coup d'œil du maître d'hôtel, les rires furent vite réprimés.
La gouvernante s'avança et, d'un air posé, se baissa pour arranger la jupe de la femme de chambre. Ainsi la pudeur était sauve. Puis les autres serviteurs soulevèrent la femme de chambre et la portèrent rapidement le long du couloir, car le sang dégouttait abondamment de sa jupe.
Le maître d'hôtel se lança ensuite dans une inspection minutieuse de la salle de bains.
— Ah, voilà l'instrument, dit-il, avec lequel Sir Algernon a mis fin à ses jours.
Il désigna du doigt un rasoir ouvert, tout maculé de sang, et qui avait glissé sur le côté de la baignoire.
Et il demeura comme pétrifié sur le seuil de la porte, jusqu'au moment où lui parvint le bruit de chevaux lancés au galop. Le valet de pied arriva en annonçant :
— La police est ici, Mr Harris, et le docteur, lui, sera là d'un moment à l'autre.
On parlait dans le hall et des pas lourds retentirent dans l'escalier, puis dans le couloir.
— Eh bien, que s'est-il passé ici ? dit une voix rude. Si je comprends bien, il y a eu un suicide, mais êtes-vous bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un meurtre ?
L'homme qui venait de parler — un policier en uniforme bleu — passa la tête par la porte de la salle de bains, cherchant d'un geste mécanique son carnet de notes dans la poche de sa veste. Puis prenant un crayon dont il commença par sucer consciencieusement la mine, il s'apprêta à écrire. On entendit alors le bruit d'un cheval trottant allègrement et quelqu'un s'agita à la porte d'entrée ; un pas léger franchit l'escalier, puis le couloir, et un homme jeune et mince apparut portant une mallette noire ; c'était le docteur.
— Ah, Mr Harris, dit-il, il s'est passé quelque chose de grave, si j'ai bien compris ?
— Doucement, docteur, dit le policier au visage rougeaud, nous n'avons pas encore terminé nos investigations. Il nous faut trouver la cause de la mort...
— Mais sergent, rétorqua le docteur, êtes-vous sûr qu'il est bien mort ? Ne faudrait-il pas d'abord s'en assurer ?
Sans un mot, le policier désigna du doigt le corps dont la tête était presque tranchée. Le corps s'était vidé de tout son sang par l'énorme blessure faite à la gorge, et le spectacle était celui d'une véritable boucherie.
— Voyons, Mr Harris, dit le sergent, racontez-moi comment les choses se sont passées. Qui a fait cela ?
Le maître d'hôtel pinçait les lèvres nerveusement, effrayé du tour que prenaient les choses. Il commençait à redouter d'être accusé de meurtre, bien que point n'était besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre qu'il s'agissait d'un suicide.
Mais conscient qu'il était préférable d'être en règle avec la loi, le maître d'hôtel répondit :
— Comme vous le savez, je m'appelle George Harris. Je suis premier maître d'hôtel dans cette maison. Le personnel et moi-même avons entendu hurler une femme de chambre — Alice White, c'est son nom. Mais hurler à rendre fou quelqu'un ; puis les cris furent suivis du bruit d'une chute, et plus rien. Nous nous sommes précipités et nous avons trouvé (il fit une pause spectaculaire, puis un geste ample en direction de la salle de bains), ceci !
Le sergent grommela quelque chose pour lui-même tout en mordillant sa moustache aux pointes tombantes, puis, il dit :
— Amenez-moi cette Alice White, que je l'interroge.
La gouvernante intervint :
— Oh non, sergent, c'est impossible. Nous devons lui faire prendre un bain, car elle est couverte de sang et est, de plus, en proie à une crise de nerfs. Pauvre chose ! Maintenant, ne vous imaginez pas que vous pouvez venir ici nous malmener — parce que ce n'est pas nous qui avons commis une telle horreur, et j'aimerais que vous vous souveniez du nombre de fois où vous êtes venu ici par la porte de la cuisine pour vous faire offrir un bon repas !
S'avançant calmement, le docteur insista :
— Nous ferions mieux de jeter un coup d'œil au corps, car il semble que nous perdions notre temps et n'arrivions à rien.
Et cela dit, il retira délicatement ses boutons de manchettes, les mit dans sa poche et roula ses manches de chemise après avoir confié son veston au maître d'hôtel.
Sans le toucher, le docteur examina le corps attentivement. Puis d'un rapide mouvement du pied, il le retourna complètement et l'on vit les yeux grands ouverts qui regardaient fixement le plafond.
L'entité qui avait été Sir Algernon regardait vers le bas, fasciné par ce qu'il voyait. Tout lui semblait étrange, et pendant un moment il fut incapable de comprendre ce qui s'était passé ; mais une force inconnue le maintenait cloué au plafond — l'Algernon vivant regardant, sous lui, les yeux morts, vitreux et ensanglantés du défunt Algernon. Il fixait le spectacle, son attention concentrée sur les mots de Harris.
— Oui, Sir Algernon avait fait la guerre des Boers comme lieutenant, combattant noblement, et avait été blessé très sérieusement. Cette blessure, malheureusement, concernait une partie délicate de son anatomie que, par égard pour les dames ici présentes, je ne peux préciser plus amplement. Et ces derniers temps, son impossibilité à — à accomplir certaines choses — le plongeait dans des crises de dépression, et d'autres que moi l'ont souvent entendu dire qu'une vie dans laquelle ces nécessités sexuelles ne pouvaient être satisfaites ne valait pas la peine d'être vécue. Et il menaçait d'y mettre fin.
La gouvernante laissa échapper un petit reniflement de commisération, et la seconde femme de chambre renifla, elle aussi, par sympathie. Le premier valet de pied murmura en acquiesçant, disant que lui aussi avait entendu parler de telles choses. Le docteur regarda ensuite les serviettes de toilette soigneusement disposées sur le porte-serviettes ; d'un geste brusque, il les fit tomber sur le sol de la salle de bains et, du pied, épongea le sang qui commençait à se coaguler. Tournant les yeux vers la baignoire et voyant un tapis de bain très épais, il le posa à terre près du corps et s'agenouilla. Puis il se saisit de son stéthoscope en bois et appliqua l'une des extrémités sur la poitrine du cadavre, plaçant l'autre contre son oreille. Chacun retenait son souffle. Le docteur secoua la tête d'un geste négatif en disant :
— Toute vie est éteinte ; il est vraiment mort.
Il retira son stéthoscope, le remit dans la sacoche destinée à cet usage, et se leva, s'essuyant les mains à la serviette que lui tendit la gouvernante.
Le sergent désigna d'un geste le rasoir en disant :
— Est-ce là, docteur, l'instrument qui a mis fin aux jours de Sir Algernon ?
Le docteur jeta un regard vers le sol, puis ramassa le rasoir en se servant de la serviette et répondit :
— Oui, ceci a tranché la carotide. La mort a dû être presque instantanée. J'estime qu'il a pris environ sept minutes pour mourir.
Le sergent Murdock était très occupé — griffonnant abondamment dans son carnet. Soudain, il y eut un grondement, comme le bruit d'un wagon que tireraient des chevaux. De nouveau, la sonnerie de la porte d'entrée retentit dans la cuisine. De nouveau, on entendit un bruit de voix dans le hall, puis un petit homme monta l'escalier, s'inclina respectueusement devant le maître d'hôtel, le docteur, et enfin devant le sergent, et demanda :
— Le corps est-il prêt pour moi ? On m'a dit de venir ici pour prendre possession d'un corps, celui d'un suicidé.
Le sergent regarda le docteur, le docteur regarda le sergent et tous deux regardèrent Mr Harris.
— Savez-vous, demanda le sergent, s'il y a des parents du mort qui doivent venir ?
— Non, sergent, ils n'auraient pas le temps d'arriver. Je crois que le plus proche parent est à une demi-heure d'ici — avec des chevaux rapides — et j'ai déjà envoyé un messager ; je pense qu'il serait bien que le corps soit emmené aux pompes funèbres, car il n'est pas possible de permettre que les parents voient Sir Algernon dans l'état où il est. Ne pensez-vous pas ?
Le sergent regarda le docteur, lequel regarda le sergent et tous deux dirent : "Oui", simultanément. Le sergent, en sa qualité de représentant de la loi, prit la parole :
— C'est bien, emmenez le corps, mais nous devons avoir au poste de police un rapport très complet — et cela le plus vite possible. Le Commissaire exigera de l'avoir d'ici à demain matin.
Le docteur l'interrompit.
— Je devrai en informer le Coroner, car il est probable qu'il voudra une autopsie.
Le docteur et le sergent s'éloignèrent. L'employé des pompes funèbres congédia gentiment le maître d'hôtel, les laquais, la gouvernante et les femmes de chambre ; puis deux de ses hommes montèrent l'escalier en apportant un cercueil. Ils le déposèrent sur le sol, à l'extérieur de la salle de bains, et enlevèrent le couvercle. L'intérieur était empli de sciure de bois sur un quart environ de sa hauteur ; se rendant dans la salle de bains, ils soulevèrent alors le corps qu'ils lâchèrent sans le moindre respect sur la sciure, et ils remirent soigneusement le couvercle.
Par pure forme, ils se rincèrent les mains sous le robinet et, ne trouvant pas de serviette propre, s'essuyèrent avec les rideaux. Puis ils suivirent le corridor, traînant du sang coagulé tout au long de la moquette.
En grommelant ils soulevèrent le cercueil et se dirigèrent vers l'escalier.
— Eh, vous, là, donnez un coup de main ! cria l'employé aux deux laquais. Prenez-le par là, il ne faut pas le renverser.
Les deux hommes se précipitèrent en avant, et le cercueil fut descendu, puis atteignit la rue où on le glissa dans une voiture couverte de noir. L'employé entra dans le véhicule, ses deux assistants s'installèrent sur le cercueil, le conducteur prit les rênes et les chevaux partirent de leur allure tranquille.
Le sergent Murdock descendit l'escalier pesamment et se dirigea vers la salle de bains. Il ramassa le rasoir à l'aide d'un tissu, le mit de côté, puis il procéda à une petite inspection afin de voir s'il n'existait pas, par hasard, une quelque autre preuve.
Collé au plafond, l'esprit de Sir Algernon regardait vers le bas, complètement fasciné. Soudain, pour une quelconque raison, le sergent Murdock leva les yeux vers le plafond, laissa échapper un cri d'effroi et s'écroula sur le siège des toilettes qui se fêla sous son poids. Sur ce, l'esprit de Sir Algernon disparut et lui-même perdit connaissance, conscient seulement d'un étrange bourdonnement, d'un tourbillonnement mystérieux, et de nuages noirs semblables à ceux qui s'échapperaient d'une lampe à pétrole dont on aurait oublié de régler la mèche.
Et ainsi l'obscurité descendit sur lui, et l'esprit de Sir Algernon se désintéressa de ce qui se passait — pour le moment du moins.
Algernon Reginald St Clair de Bonkers s'agita, comme on le fait dans un sommeil artificiel provoqué par des drogues. De curieuses pensées se pressaient dans sa conscience incertaine ; puis des éclats d'une musique céleste s'élevèrent, suivis d'un flot de sons diaboliques. Mal à l'aise, il remua, et la conscience lui revenant pendant un moment, il fut surpris par la lourdeur de ses mouvements ; il avait l'impression d'être comme englué.
S'éveillant en sursaut, Algernon essaya de s'asseoir, mais s'aperçut que ses mouvements étaient restreints, qu'il ne pouvait bouger qu'au ralenti. Gagné par la panique, il tenta de se débattre, mais ses mouvements étaient lents, engourdis, et cela le calma passablement. Il toucha ses yeux pour voir s'ils étaient ouverts ou fermés, car aucune lumière ne lui parvenait. Puis, baissant la main il chercha à sentir la texture du lit ; mais le choc le fit hurler, car sous lui, il n'y avait rien. Il était suspendu — comme il l'a exprimé lui-même — ‘tel un poisson englué dans du sirop dans un aquarium’.
Il essaya pendant un moment d'agiter faiblement les bras, comme fait le nageur cherchant à avancer contre le flot. Mais malgré les efforts de ses pieds, de ses bras ouverts, ‘quelque chose’ le maintenait sur place.
Comprenant l'inutilité de ses efforts — mais surpris de découvrir qu'ils ne le fatiguaient pas — il resta immobile et se prit à réfléchir.
"Où suis-je ? se dit-il. Oh, oui, je me souviens... J'avais décidé de me tuer, estimant inutile de continuer à vivre, frustré de la compagnie des femmes, à cause de mon impuissance. Quel malheur pour moi, murmura-t-il en lui-même, que ces sales Boers aient choisi de me blesser à CET ENDROIT !"
Il se prit à repenser au passé ; il revit le Boer barbu qui levant son fusil avait tiré sur lui, non pas pour le tuer, mais visant délibérément avec un objectif bien défini — celui de le frustrer de sa virilité. Il songea ensuite au ‘cher vicaire’ qui avait recommandé la maison d'Algernon comme étant un refuge sûr pour les jeunes servantes ayant besoin de gagner leur vie. Puis il revit son père qui avait dit, alors que le jeune homme était encore écolier :
— Algernon, mon garçon, tu dois apprendre les réalités de la vie et les découvrir avec quelques-unes des servantes que nous avons ici ; tu verras qu'elles seront très utiles pour certains petits jeux ; mais fais en sorte de ne pas prendre les choses au sérieux. Ces classes inférieures sont là pour notre commodité. Tu seras de cet avis.
"Oui, pensa-t-il, même la gouvernante avait eu un petit sourire particulier, le jour où l'on avait engagé une jeune servante spécialement avenante. Elle lui avait dit :
— Vous serez tout à fait en sécurité ici, ma fille, le Maître ne vous importunera pas ; il est comme un de ces chevaux dans le pré — vous savez — qui ont subi des soins spéciaux. Je vous répète que vous n'avez rien à craindre."
Et la gouvernante s'en était allée avec un petit ricanement espiègle.
Algernon revit sa vie dans les moindres détails. L'ébranlement qu'avait causé la balle quand il l'avait reçue, et les vomissements qui avaient suivi. Et il entendait encore le rire rauque du vieux fermier Boer s'écriant :
— Plus de filles pour toi, mon gars. Ce n'est pas toi qui assureras la descendance. Tu seras comme un de ces eunuques dont on a souvent entendu parler.
Algernon se sentit rougir au souvenir de cette honte et il se rappela le plan à long terme qu'il avait conçu — celui de se suicider après avoir décidé qu'il ne pouvait continuer à vivre dans de si étranges conditions ; il avait trouvé intolérables les allusions du vicaire, un jour où, venu lui rendre visite, il lui avait parlé de son accident — ajoutant combien il était heureux d'avoir un jeune homme sûr et digne de confiance pour l'aider dans les réunions des paroissiennes et aux sessions d'ouvrages pour les œuvres. Le vicaire avait ajouté :
— Nous ne saurions être trop prudents, car nous ne pouvons pas risquer de ruiner le bon renom de notre église. Vous ne pensez pas ?
Ensuite, il y avait eu le docteur, le vieux docteur de famille, Davis Mortimer, qui avait l'habitude de venir le soir, montant son vieux cheval Wellington.
Nous prenions un verre de bon vin tous les deux, mais le plaisir s'évanouissait dès qu'il disait :
— Ah, Algernon, je crois qu'il faut que je vous examine. Vous le savez... il importe de s'assurer que vous ne développez pas de caractéristiques féminines — il faut veiller par exemple, et très sérieusement, à ce que le poil de votre visage ne tombe pas et que vous vous mettiez à développer des seins comme ceux d'une femme. Il importe surtout d'observer tout changement pouvant survenir dans le timbre de votre voix, car la chimie de votre corps s'est modifiée depuis que vous avez perdu certaines glandes.
Le docteur l'avait alors regardé de façon cocasse, pour voir comment il ‘encaissait’ la chose, puis il avait enchaîné en disant :
— Maintenant, je prendrais bien un autre verre. Vous avez là un excellent vin et votre père s'y connaissait en luxes de toutes sortes et spécialement ceux d'une certaine qualité !
Le pauvre Algernon en avait eu plus que son compte, le jour où il avait entendu le maître d'hôtel dire à la gouvernante :
— Une chose terrible, vous savez, que celle qui est arrivée à Sir Algernon — un jeune homme viril et si plein de vie, un tel honneur pour sa famille. Avant que vous ne soyez ici, et avant qu'il ne parte pour la guerre, il était de toutes les chasses à courre et il était la coqueluche des matrones de la région. Invité dans toutes les soirées, on le considérait comme un gendre très souhaitable, et la mère de toute jeune fille débutant dans le monde avait les yeux sur lui. Mais, à présent, les mères de famille n'ont plus pour lui que commisération et elles savent que leurs filles n'ont plus besoin de chaperon quand elles se trouvent en sa compagnie. Un jeune homme inoffensif, très inoffensif, en vérité.
"Oui, pensa Algernon. C'est bien vrai. Je me demande ce qu'ils auraient fait à ma place, gisant, tout sanglant, sur le champ de bataille ; puis le chirurgien venant à moi, découpant mon pantalon, et armé d'un couteau pointu amputant les restes de ce qui me différenciait d'une femme. Oh ! Quelle agonie ce fut. Il existe maintenant cette drogue qu'on appelle chloroforme et qui supprime la douleur au cours des opérations ; mais, sur le champ de bataille, il n'y avait rien que le couteau et ce qu'on vous plaçait entre les dents afin de vous éviter de crier. Et ensuite la honte de la chose, la honte d'être privé LÀ, en cet endroit."
Le soupir de ses subordonnés avec leur air embarrassé et faisant des plaisanteries égrillardes dans son dos.
"Oui, la honte de toute cette aventure. Le dernier descendant d'une très ancienne famille — les de Bonkers venus avec l'invasion normande et qui avaient choisi de se fixer dans cette région de l'Angleterre, y bâtissant un grand manoir et y installant des fermiers. Maintenant, lui, le dernier de la lignée, rendu impuissant en servant son pays, impuissant et ridicule aux yeux de ses pairs. Et qu'y a-t-il de risible dans un homme mutilé au service des autres ? Pour s'être battu pour son pays, la famille allait s'éteindre."
Algernon gisait toujours, ni dans l'air ni sur le sol. Il était incapable de décider où il se trouvait et ce qu'il était. Comme un poisson fraîchement jeté hors de l'eau. Il se dit alors : "Suis-je mort ? Qu'est-ce que la mort ? Je me suis vu mort, alors comment suis-je ici ?"
Ses pensées revinrent inévitablement aux événements survenus depuis son retour en Angleterre. Il se revit marchant avec une certaine difficulté, notant soigneusement les réactions de ses voisins, de sa famille et de ses domestiques. Puis l'idée avait germé en lui de se tuer, de mettre fin à une vie inutile. Un jour, décidé à mettre son projet a exécution, il s'était enfermé dans son bureau, avait nettoyé son pistolet et l'avait chargé. Il l'avait alors placé contre sa tempe en pressant la détente, mais rien ne s'était produit ; il n'était sorti de l'arme qu'une espèce de bouillie. Ne parvenant pas à le croire, il s'était assis, confondu. Son pistolet en lequel il avait confiance, dont il s'était servi durant toute la guerre, venait de le trahir et lui avait laissé la vie. Prenant une feuille de papier et la posant sur son bureau, il avait examiné l'arme. Tout y était en ordre de marche. Il avait remis en place poudre, cartouche et, sans penser, pressé la détente. Il y avait eu une détonation terrible et la balle avait traversé la fenêtre. Quelqu'un s'était précipité, frappant à la porte. Il s'était levé lentement et avait ouvert la porte derrière laquelle se tenait le maître d'hôtel, l'air effrayé.
— Oh, Sir Algernon, avait-il dit, au comble de l'agitation, j'ai cru qu'il était arrivé quelque chose d'affreux.
— Rien d'affreux ne s'est passé. Je nettoyais simplement mon pistolet, et il est parti — occupez-vous de trouver quelqu'un pour réparer la fenêtre.
Il y avait eu l'autre tentative, à cheval, celle-là. Il avait choisi de monter une vieille jument grise et sortait des écuries quand un lad en riant avait murmuré au palefrenier :
— Deux vieilles juments ensemble, eh, qu'est-ce que tu en penses ?
Se retournant, il avait cravaché le lad, laissé tomber les rênes, mis pied à terre, et s'était précipité dans la maison ; depuis, il n'était jamais plus monté à cheval.
Une autre fois, il avait songé à s'empoisonner avec l'étrange plante originaire du Brésil — un pays presque inconnu. Les baies de cette plante renferment un jus qui est un poison presque instantané. Un grand voyageur lui avait offert la plante en question. Il l'avait soignée et, un jour, il avait cueilli les baies et les avait avalées. Agonie, pensa-t-il. Il s'en était tiré, mais en piteux état avec un désordre gastrique pire que la mort. Une dysenterie qui le couvrit de honte aux yeux du personnel, car il souillait son linge, n'ayant même plus la force d'aller aux toilettes. Il rougissait encore en y songeant.
Et enfin, il y eut la dernière tentative. Il avait envoyé quelqu'un à Londres pour qu'on lui rapporte le rasoir à la lame la plus effilée. C'était un splendide instrument portant, gravés, le nom et l'écusson du fabricant. Il s'était saisi de ce bel objet, l'avait longuement repassé sur le cuir et, d'un coup sec, s'était ouvert la gorge d'une oreille à l'autre — et seules les vertèbres du cou avaient maintenu la tête sur les épaules.
Ainsi, il s'était vu mort. Il savait qu'il l'était, conscient de s'être tué, et ensuite, de ses yeux devenus vitreux, il s'était vu sur le sol, depuis le plafond où il était fixé. Dans l'obscurité totale, il réfléchissait, et réfléchissait, et réfléchissait.
La Mort ? Qu'était-ce donc que la mort ? Y avait-il quelque chose après elle ? Il avait souvent agité le sujet, au mess, avec les officiers. Le Père avait essayé de leur expliquer la vie immortelle, la montée au Paradis, et un hussard hardi, un major, avait répondu :
— Oh non, Père, je suis sûr que tout ceci est sottise. La mort est la fin de tout. Si je tue un Boer, allez-vous me dire qu'il ira tout droit au Ciel ou dans l'Autre Lieu ? Si je le tue en lui traversant le cœur d'une balle et le maintiens au sol en posant le pied sur sa poitrine, je peux vous assurer qu'il est mort, aussi mort qu'un porc empaillé. Quand on est mort, tout est bel et bien fini.
Tous les arguments concernant la vie après la mort lui revenaient à l'esprit. Il se demandait comment quelqu'un pouvait dire qu'il y avait une vie après la mort ? "Si vous tuez un homme — eh bien, il est mort. Et si l'âme existe, vous verrez alors quelque chose quitter ce corps."
Il ne pouvait cesser de méditer, se demandant ce qui s'était passé et où il était. Puis une idée terrible lui traversa l'esprit : peut-être ne s'agissait-il que d'un cauchemar et était-il enfermé dans un asile à la suite de délire ? Il promena ses mains autour de lui, tâtonnant soigneusement pour voir s'il n'était pas attaché ou ceinturé, comme il arrive à certains fous. Mais non, il flottait, tout comme un poisson flotte dans l'eau. Où était-il donc ? "Mort ? Suis-je mort ? Si oui, ou suis-je, et qu'est-ce que je fais ainsi à flotter paresseusement ?"
Les mots du Père revenaient à sa mémoire :
— Quand vous quittez votre corps, un ange est là pour vous accueillir et vous guider. Vous serez jugé par Dieu Lui-même, et connaîtrez la punition qu'Il décidera de vous infliger.
Algernon réfléchit à l'ensemble du problème : "Si Dieu était un Dieu bon, pourquoi un homme devrait-il, sitôt mort, être puni ? Et s'il était mort, comment pourrait-il être affecté par une punition ?" Il était là, pensa-t-il, gisant paisiblement, sans souffrance et sans joie particulières.
Soudain, il eut peur. Quelque chose se passa en lui. C'était comme s'il y avait une main à l'intérieur de son crâne. C'était seulement une impression, la sensation que quelqu'un pensait à lui : "Sois en paix, ne bouge pas et écoute." Mais aucune voix ne lui parvenait.
Pendant un moment, il essaya de se sauver, de courir. Tout cela était par trop mystérieux, trop troublant ; mais il était cloué là. De nouveau l'impression revint : "Sois en paix, reste calme, et sois libéré de ceci."
Algernon pensa en lui-même : "Je suis un officier et un gentleman. Je ne dois pas me laisser aller à la panique, mais être un exemple pour mes hommes." Et, bien que très troublé, il se reprit et se laissa envahir par la paix et la tranquillité.
Chapitre Trois
Soudain, il trembla et la panique l'envahit de nouveau. Il lui semblait que son crâne allait exploser.
En lui l'obscurité se faisait plus dense, et bien qu'incapable de voir, il pouvait cependant SENTIR que de gros nuages plus noirs encore que l'obscurité tournaient autour de lui en l'enveloppant.
Puis dans toute cette noirceur ambiante, il lui sembla qu'un mince rai de lumière le touchait et tout au long de ce rai de lumière venait l'impression : "Paix, paix, sois calme et nous te parlerons."
Grâce à un effort surhumain, il parvint à maîtriser sa panique. Le calme se fit en lui graduellement et de nouveau il resta immobile, attendant de futurs développements. Ils ne tardèrent pas : "Nous voulons vous aider — nous sommes très désireux de vous aider, mais vous ne nous laissez pas agir."
Algernon réfléchit, retournant cette idée dans sa tête. "Vous ne nous laissez pas agir, répéta-t-il en lui-même. Mais je ne leur ai pas dit un mot ; comment peuvent-ils dire que je ne les laisserai pas m'aider ? J'ignore qui ils sont et ne sais rien de ce qu'ils vont faire. De plus je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où je suis. Si ceci est la mort, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Négation ? Néant ? Suis-je condamné à vivre ainsi dans cette obscurité pour l'éternité ? Mais, même ceci, pensa-t-il, pose un problème. Vivre ? Est-ce que je vis ?"
Des pensées multiples tourbillonnaient dans son cerveau. Les enseignements de sa prime jeunesse lui revenaient en mémoire : ‘La mort n'existe pas — Je suis la Résurrection — Dans la maison de mon Père il y a de nombreuses demeures ; je vais préparer la Voie pour vous — Si vous vous conduisez bien, vous irez au Paradis — Si vous vous conduisez mal, vous irez en Enfer — Seuls les Chrétiens ont une chance d'aller au Ciel.’ Tant d'affirmations contradictoires, tant de malentendus — l'aveugle enseignant l'aveugle, les prêtres et les maîtres de l'école du dimanche — gens qui s'aveuglent eux-mêmes, essayant d'éclairer ceux qu'ils estiment être encore plus aveugles. "L'enfer ? Qu'est-ce que l'enfer ? Qu'est-ce que le Paradis ? Y a-t-il un Paradis ?"
Une pensée puissante interrompit ses cogitations : "Nous sommes prêts à vous aider, si vous acceptez d'abord le principe que vous êtes vivant et qu'il existe une vie après la mort. Nous sommes prêts à vous aider, si vous-même êtes disposé à croire en nous sans réserve et à ce que nous pouvons vous enseigner."
À cette idée, le cerveau d'Algernon se révoltait. Qu'est-ce que c'était que toute cette sotte histoire d'aide ? Qu'est-ce que c'était que cette absurdité de croire ? En quoi POUVAIT-il croire ? S'il devait croire, cela impliquait donc qu'il y avait un doute. Ce qu'il voulait, c'était des faits et non des croyances. Le premier fait était qu'il s'était tué de sa propre main ; le second, qu'il avait vu son cadavre, et le troisième — qu'il se trouvait maintenant dans l'obscurité totale, apparemment immergé dans une substance visqueuse et poisseuse qui entravait ses mouvements. Et des gens stupides envoyaient, il ne savait d'où, des pensées à son cerveau, lui disant qu'il devait croire. Soit — mais croire à QUOI ?
Ce qui était une voix, une pensée ou une impression lui dit alors : "Vous êtes dans le premier stade qui suit la mort. Sur la Terre, vous avez été mal informé, induit en erreur, on vous a égaré, et si vous voulez sortir de la prison dans laquelle vous vous êtes enfermé vous-même, alors nous vous en sortirons." Calmement, il réfléchit à la question, puis il renvoya fortement une pensée : "Eh bien, si vous voulez que je croie, dites-moi d'abord ce qui m'arrive. Vous prétendez que je suis dans le stade qui suit la mort, alors que je croyais que la mort était la fin de toutes choses."
"Précisément ! rétorqua avec force la pensée ou la voix. Précisément ! Vous êtes enveloppé dans les nuages noirs du doute, les nuages noirs de la déraison. Vous êtes entouré de la noirceur de l'ignorance et, de cet isolement, vous êtes responsable, vous vous l'êtes imposé, et vous seul pouvez le détruire."
Algernon n'appréciait pas ce jugement, qui ressemblait à un blâme. "Je n'ai aucune raison de croire, dit-il, je ne peux que suivre ce que l'on m'a appris. L'Église m'a enseigné diverses choses — j'ai eu les maîtres de l'école du dimanche, ainsi qu'une gouvernante, et vous pensez que je peux effacer tout ce qu'ils m'ont dit, simplement parce qu'une impression inconnue et non identifiée s'adresse à mon esprit ? FAITES quelque chose pour me montrer qu'il existe une chose derrière cette noirceur."
La noirceur se rompit soudain, s'écartant comme les rideaux d'une scène pour permettre l'entrée des acteurs. Algernon fut soudain ébloui par le déversement d'une brillante lumière et par de prodigieuses vibrations dans l'atmosphère. Ce fut pour lui une extase qui faillit lui arracher un cri, et ensuite — le doute, et avec le doute la noirceur revint l'envelopper à nouveau. Doute, panique, récrimination contre lui-même et reproches contre les enseignements du monde. Il se prit à douter de son bon sens. Comment de telles choses pourraient-elles être possibles ? Il était certain maintenant d'avoir l'esprit dérangé, certain d'être victime d'hallucinations. Il songea à cette plante brésilienne dont il avait absorbé les fruits. Et s'il souffrait des effets secondaires de cette ingestion, et partant, d'hallucinations longtemps retardées ? Il avait vu son cadavre sur le sol — mais l'avait-il vu ? Comment pouvait-il se voir, s'il était mort ? Il pensa à la calvitie qu'il avait vue depuis le plafond, au sommet de la tête du maître d'hôtel. Si c'était vrai, pourquoi alors ne l'avait-il pas vue plus tôt ? Pourquoi n'avoir pas remarqué que la gouvernante, visiblement, portait une perruque ? Il réfléchit au problème et oscilla entre la pensée que la vie après la mort était possible, et l'idée qu'il était incontestablement dément.
"Nous vous laisserons prendre votre décision, car la Loi est qu'une personne ne peut être aidée que si elle demande à l'être. Quand vous aurez décidé, dites-le, et nous viendrons. Et souvenez-vous que vous n'avez aucune espèce de raison de vous imposer cet isolement. Cette noirceur est une invention de votre imagination."
Le temps n'avait aucune signification. Les pensées allaient et venaient, mais — se demandait Algernon — quelle est la vitesse de la pensée ? Combien de pensées avait-il eues ? S'il le savait, il lui serait possible, alors, de déterminer depuis combien de temps il était dans cette position et dans cette situation. Mais non, le temps n'avait désormais plus de sens. Pour autant qu'il pût en juger plus rien n'en avait. Il essaya de baisser les mains, en tâtant sous lui, mais il n'y avait rien. Au prix d'un effort extrême, il parvint à lever les bras. Là encore, il ne trouva rien, ne sentit rien, si ce n'est l'impression d'arracher ses bras à une substance gluante... Puis il ramena ses mains sur son corps. Sa tête était bien là, ainsi que son cou et ses épaules — et ses bras, bien sûr, puisqu'il avait l'usage de ses mains. Mais il bondit véritablement en découvrant qu'il était nu, et cette idée le fit rougir. Et si quelqu'un me trouvait ainsi ? On ne se montrait pas nu dans la classe à laquelle il appartenait. Ces choses ‘ne se faisaient pas’. Mais pour autant qu'il pût l'affirmer, il avait encore sa dépouille humaine. Et ses doigts qui tâtaient et erraient s'immobilisèrent soudain, et il conclut qu'il était vraiment fou — fou — car ses doigts qui exploraient son corps rencontrèrent certaines parties intimes, meurtries par le soldat Boer, et dont le chirurgien avait pratiqué l'ablation. Ainsi il venait de se retrouver intact. Il était clair que c'était son imagination. Très clairement, pensa-t-il, il avait regardé son corps qui sur le sol achevait de quitter le monde. Mais à cet instant l'idée lui vint qu'il avait regardé vers le bas. Comment POUVAIT-il regarder vers le bas, s'il était vraiment ce corps en train de mourir ? Et s'il avait été capable de regarder vers le bas, alors c'était qu'une partie de lui — son âme ou autre chose que vous appellerez comme vous voudrez — avait dû s'échapper du corps, et le simple fait qu'il ait pu regarder son propre corps indiquait qu'il existait ‘quelque chose’ après la mort.
Il resta à méditer très longuement. Son cerveau lui donnait l'impression de cliqueter comme une machine. De petites bribes de connaissances ramassées çà et là en divers points du monde se mettaient en place. Il pensa à une certaine religion — laquelle était-ce donc ? Hindoue ? Musulmane ? Il ne savait pas, mais c'était une de ces étranges religions auxquelles seuls croient les indigènes, mais qui cependant enseignent l'existence d'une vie après la mort ; elles enseignent que les hommes bons, quand ils meurent, se rendent en un lieu plein de filles consentantes. Eh bien, il ne voyait aucune fille, consentante ou pas, mais cela le conduisit à raisonner : la vie DOIT exister après la mort ; il doit y avoir quelque chose, et il doit y avoir quelqu'un — sinon comment pourrait-il avoir une pareille projection lumineuse de pensée dans son esprit ?
Algernon sursauta d'étonnement.
— Oh ! L'aube vient ! s'exclama-t-il.
Il était vrai que l'obscurité maintenant faiblissait, de même que tout s'allégeait autour de lui ; il s'enfonçait doucement jusqu'au moment où ses mains étendues sous lui sentirent ‘quelque chose’. Et son corps continuant à s'enfoncer, Algernon découvrit alors que ses mains étaient capables de serrer — non, c'était impossible ! Mais d'autres tentatives confirmèrent cette réalité. Oui, ses mains étaient en contact avec une herbe tendre, et son corps détendu reposait sur un gazon dru.
La lumière se fit en lui : il comprit enfin qu'il n'était plus dans le néant, mais dans un lieu physique où se trouvaient d'autres choses que l'obscurité. Et tandis qu'il en prenait conscience, l'obscurité continuait de décroître et il se trouva comme enveloppé dans une brume légère, au travers de laquelle il voyait des formes vagues. Il ne pouvait les voir clairement, mais ces ‘silhouettes’ étaient bien là.
Il regarda vers le haut et une forme sombre apparut au-dessus de lui. Seules lui étaient visibles deux mains étendues comme dans un geste de bénédiction, puis une voix — et non pas une pensée à l'intérieur de sa tête, cette fois, mais indéniablement une authentique voix anglaise appartenant de toute évidence à quelqu'un d'Eton (école de l'élite anglaise — NdT) ou d'Oxford (l'une des plus prestigieuses universités sur le plan mondial — NdT) — lui parla !
— Levez vos pieds, mon fils. Levez vos pieds et prenez ma main ; sentez que je suis solide, tout comme vous, et ceci sera une preuve de plus que vous êtes vivant — dans un état différent, je l'admets, mais vivant — et plus vite vous prendrez conscience que vous l'êtes et comprendrez que la vie existe après la mort, plus vite vous serez en mesure d'entrer dans la Grande Réalité.
Faiblement, Algernon tenta de se mettre sur ses pieds, mais maintenant les sensations avaient changé ; il semblait incapable de se servir de ses muscles comme il en avait l'habitude ; de nouveau la voix s'éleva.
— Imaginez-vous dans l'acte de vous lever, essayez de vous voir vous mettant debout.
Ce que fit Algernon. À son grand étonnement, il découvrit qu'il se tenait debout et qu'une forme l'étreignait ; forme qui se faisait de plus en plus brillante et plus précise, jusqu'au moment où il vit clairement devant lui un homme d'âge moyen, d'un aspect lumineux et vêtu d'une robe jaune. Algernon chercha à évaluer la hauteur de la silhouette, et son champ de vision le fit se rencontrer lui-même.
Découvrant qu'il était nu, il laissa échapper un cri d'effroi.
— Oh ! mais où sont mes vêtements ? Je ne peux pas être vu ainsi !
La forme lui sourit avec gentillesse en disant :
— Les vêtements ne font pas l'homme, mon ami. On vient au monde sur Terre sans vêtements, et on renaît à ce monde sans vêtements. Réfléchissez à ce que vous aimeriez porter et vous vous en trouverez vêtu.
Algernon pensa qu'il lui serait plaisant de se voir en jeune sous-lieutenant, long pantalon bleu marine et tunique garance. Autour de la taille, il aurait un ceinturon passé au blanc d'Espagne et garni de cartouchières. Il vit les boutons de cuivre astiqués pour briller comme de véritables miroirs. Et sur sa tête, il imagina la coiffure à jugulaire. Et l'épée, dans son fourreau, pendait à son côté. Puis il sourit en lui-même et pensa : "Qu'ils m'habillent donc AINSI !" Ahuri, il se sentit comme sanglé soudain dans un uniforme à ceinturon et fut surpris d'être dans des bottes militaires très serrées. L'épée était à son côté et son poids ainsi que celui de l'étui de revolver pesaient sur le ceinturon. La jugulaire était tendue sous son menton. Et comme il tournait la tête, il aperçut les épaulettes sur ses épaules. C'en était trop — beaucoup trop. Algernon s'évanouit et se serait retrouvé sur la gazon si l'homme en robe jaune n'était pas intervenu.
Les paupières d'Algernon battirent et, d'une voix faible, il murmura :
— Je crois, Seigneur. Pardonnez-moi mes péchés et pardonnez les offenses que j'ai commises.
L'homme laissa tomber sur lui un sourire de bienveillance et lui dit :
— Je ne suis pas le Seigneur ; je ne suis que celui dont la tâche est d'aider ceux qui viennent de la vie terrestre et pénètrent dans celle-ci — le stade intermédiaire — et je suis prêt à vous offrir mon aide dès que vous serez disposé à la recevoir.
Sans difficulté cette fois, Algernon se mit sur ses pieds et dit :
Je suis prêt à recevoir l'aide que vous pouvez me donner. Mais... dites-moi, êtes-vous allé à Eton, étiez-vous à Balliol (l'un des collèges constitutifs de l'université d'Oxford au Royaume-Uni — NdT) ?
La forme sourit tout en répondant :
— Appelez-moi simplement ‘ami’, et nous traiterons plus tard de ces questions. Vous devez tout d'abord entrer dans notre monde.
Se détournant, il fit un geste de la main comme s'il écartait des rideaux — et le résultat, en fait, fut le même. Les nuages obscurs se dissipèrent, les ombres s'évanouirent et Algernon se trouva debout sur une herbe du vert le plus intense qui se puisse imaginer. L'air, autour de lui, était comme chargé de vie, vibrant d'énergie. S'échappant de sources inconnues, des impressions de musique — non pas des sons, mais des impressions de musique lui parvenaient ; il l'aurait décrite comme ‘une musique dans l'air’, et il trouva cela remarquablement apaisant.
Des gens allaient et venaient, se promenant comme ils l'auraient fait dans un jardin public. Au premier abord, il eut devant ce spectacle l'impression qu'il pouvait se trouver à Green Park ou à Hyde Park, à Londres ; mais dans un Green Park ou un Hyde Park particulièrement embelli. Sur les bancs, des couples étaient assis, tandis que d'autres flânaient, et de nouveau Algernon fut saisi par la peur, car quelques personnes circulaient un peu au-dessus du sol ! Quelqu'un courait dans l'air, à une dizaine de pieds (3 m) au-dessus du sol, poursuivi par une autre personne, et tous deux riaient joyeusement, semblant pleinement heureux. Un frisson parcourut Algernon, mais son Ami le prit gentiment par le bras en lui disant :
— Venez, allons nous asseoir là, car je tiens à vous parler un peu de ce monde avant que nous n'allions plus avant — sinon votre rétablissement risquerait d'être retardé par ce que vous verrez ensuite.
— Rétablissement ! répéta Algernon. Mais point n'est besoin de me rétablir de quoi que ce soit. Je suis en excellente santé et parfaitement normal.
Son Ami sourit gentiment et dit à nouveau :
— Venez, asseyons-nous ici, d'où nous pourrons voir les cygnes et autres oiseaux aquatiques, et je vais vous donner un aperçu de la nouvelle vie qui vous attend.
En rechignant, et mécontent à la pensée qu'il était considéré comme malade, il se laissa guider vers un banc proche.
— Asseyez-vous confortablement, lui dit l'Ami, car j'ai beaucoup à vous dire. Vous êtes à présent dans un autre monde, sur un autre plan d'existence, et plus vous m'accorderez d'attention, plus vous progresserez aisément dans ce monde-ci.
Algernon fut très favorablement impressionné par le confort du siège sur lequel il se trouvait assis ; semblant épouser ses formes, il ne ressemblait en rien à ceux des parcs de Londres où l'on pouvait avoir le malheur de s'enfoncer une écharde si l'on remuait un peu trop sur son banc.
Devant eux, une eau bleue sur laquelle glissaient majestueusement des cygnes éclatants de blancheur. L'air était chaud et vibrant. Une pensée soudain frappa Algernon, une pensée si soudaine et si choquante qu'il faillit bondir de son siège : il n'y avait pas d'ombre ! Levant les yeux, il vit que le soleil lui non plus n'existait pas. Le ciel entier était incandescent.
L'Ami interrompit le cours de sa pensée.
— Nous devons maintenant parler de certaines choses ; il me faut vous éclairer sur ce monde avant que vous n'entriez dans la Maison du Repos.
Algernon l'interrompit en disant :
— Je suis tout à fait étonné que vous portiez une robe jaune. Êtes-vous membre de quelque culte, ou appartenez-vous à quelque Ordre religieux ?
— Bonté Divine, quelle curieuse disposition d'esprit vous avez ! Quelle importance peut bien avoir la couleur de ma robe et le fait que j'en porte une ? Je ne le fais que parce que je trouve cela convenable dans la tâche que j'ai à accomplir. (Et tout en souriant il ajouta :) Vous portez bien un uniforme, un pantalon bleu marine, une jaquette rouge vif, et une bien curieuse coiffure. De plus vous avez un ceinturon blanc. Pourquoi êtes-vous affublé de si étrange façon ? Ici, on s'habille selon son désir, et personne ne critiquera la manière dont vous êtes vêtu. Et, de la même façon, je m'habille dans le style qui me convient et parce que c'est ma tenue habituelle. Mais nous sommes en train de perdre du temps.
Algernon, ainsi réprimandé, se radoucit ; regardant autour de lui, il vit d'autres personnes en robe jaune, conversant avec des hommes et des femmes en tenues très exotiques. Mais son compagnon lui parlait :
— Je dois vous dire que, sur la Terre, vous êtes gravement mal informés en ce qui concerne la vérité de la vie et la vérité de l'après-vie. Vos chefs religieux sont constitués en gang, chacun faisant sa propre publicité, prêchant pour sa propre marchandise, et complètement indifférent à la vérité de la vie et de l'après-vie. (Il fit une pause et poursuivit :) Regardez tous ces gens autour de vous. Pouvez-vous dire lequel est Chrétien, Juif, Musulman ou Bouddhiste ? Et cependant tous les gens que vous voyez dans ce parc — à l'exception de ceux en robe jaune — ont une chose en commun : ils se sont tous suicidés.
Algernon eut un sentiment d'horreur — tous étaient des suicidés. Il se dit alors qu'il était peut-être dans un asile de fous et que l'homme en robe jaune pouvait être un Gardien. Il pensa à toutes les choses étranges qui lui étaient arrivées et qui imposaient une contrainte à sa crédulité.
— Vous devez vous rendre compte que le suicide est un crime extrêmement grave. Personne ne devrait commettre un tel acte. Aucune raison ne peut le justifier, et si les gens savaient ce qu'ils auront à endurer par la suite, ils ne se laisseraient pas aller à s'y livrer. Ceci, poursuivit son compagnon, est un centre de réception où sont réhabilités ceux qui ont mis fin à leurs jours ; ils sont conseillés, puis renvoyés sur la Terre dans un autre corps. Je vais d'abord vous parler de la vie sur Terre et sur ce plan d'existence.
Ils s'installèrent plus confortablement, et Algernon observa les cygnes qui glissaient paresseusement sur l'étang. Il remarqua que les arbres étaient emplis d'oiseaux et aussi d'écureuils ; il nota également avec intérêt d'autres hommes et d'autres femmes en robe jaune qui parlaient à ceux dont ils avaient la charge.
— La Terre est une école d'enseignement où les gens vont pour apprendre à travers les épreuves puisqu'ils n'apprendront pas par la bonté. Les gens vont sur la Terre tout comme ceux qui sur Terre vont à l'école, et avant de descendre sur la Terre, les Entités qui vont occuper un corps terrestre sont conseillées sur ce qui est pour elles le meilleur type de corps et les meilleures conditions leur permettant d'apprendre ce qu'elles ont à apprendre — ou, pour être plus précis, pour apprendre ce pour quoi elles vont vraiment sur Terre, vu qu'elles sont, bien sûr, conseillées avant leur départ. Vous ferez cette expérience vous-même, aussi laissez-moi vous parler de ce plan particulier. Nous avons ici ce qui est connu comme étant l'astral inférieur. Sa population de passage n'est faite que de suicidés exclusivement, cela pour la raison que le suicide est un crime, et que ceux qui le commettent sont mentalement des instables. Dans votre cas, votre suicide est dû au fait que vous ne pouviez procréer, que vous aviez été mutilé ; mais, vous êtes allé sur la Terre pour endurer cette condition et apprendre à la surmonter. Et je vous dis avec gravité qu'avant d'aller sur la Terre, vous avez pris les arrangements qui feraient de vous un homme mutilé — ce qui veut dire que vous avez échoué à votre test, et que vous devez revivre à nouveau toute cette épreuve, et la revivre encore si vous échouez une nouvelle fois.
Algernon se sentit nettement abattu. Il avait cru qu'en mettant fin à une existence qu'il estimait inutile, il avait fait là un geste noble — et on lui disait maintenant qu'il avait commis un crime et devrait l'expier. Mais son compagnon parlait...
— Ceci, l'astral inférieur, est très proche du plan terrestre. C'est celui qui se trouve aussi bas que possible, juste au-dessus du plan terrestre. Ici, nous vous placerons dans un Lieu de Repos pour vous faire subir un traitement. Nous tenterons de stabiliser votre état mental ; cette tentative visera à vous fortifier en vue de votre retour définitif sur la Terre sitôt que la situation semblera être celle qui convient. Mais ici, sur ce plan astral, vous pouvez marcher si vous le désirez, ou voler dans les airs si cela vous plaît, simplement en y pensant. De même, si vous arrivez à la conclusion que votre accoutrement est absurde — ce qu'il est, en fait — vous pouvez en changer simplement en pensant à ce que vous aimeriez porter.
Algernon pensa à un très joli costume, aperçu un jour dans un pays chaud. Léger, d'un blanc cassé, la coupe en était très élégante. Il y eut soudain comme un bruissement, et il vit avec effroi que son uniforme se volatilisait, le laissant complètement nu. Avec un cri, il bondit sur ses pieds cachant de ses deux mains la zone intime de son anatomie ; mais à peine était-il debout qu'il se trouva revêtu du costume qu'il avait revu en pensée. Timidement et tout rougissant il s'assit de nouveau.
— Vous découvrirez qu'ici vous n'avez besoin d'aucune nourriture, bien que si vous avez des impulsions gourmandes, il vous sera possible d'obtenir n'importe lesquels des aliments que vous souhaitez. Il vous suffira d'y penser pour voir cette nourriture se matérialiser dans l'atmosphère. Songez, par exemple, à votre plat préféré.
Algernon réfléchit un moment, puis rêva de rosbif, de pommes de terre rôties, de Yorkshire pudding, de carottes, de navets et de choux avec un grand verre de cidre — le tout terminé par un bon gros cigare. Tandis qu'il pensait à toutes ces choses, une forme vague apparut devant lui, se solidifia pour devenir une table couverte d'une nappe éclatante de blancheur. Puis des mains et des avant-bras apparurent, plaçant devant lui des soupières d'argent, des carafes de cristal ; les couvercles, un par un, furent soulevés et Algernon vit — et sentit — la nourriture de son choix. Ensuite, sur un simple geste de son compagnon, aliments et tables disparurent.
Il n'y a vraiment nul besoin de ces choses théâtrales, aucun besoin de ce type de nourritures grossières, car le corps, sur ce plan astral, absorbe la nourriture contenue dans l'atmosphère. Comme vous le voyez, il n'y a pas de soleil dans le ciel, mais le ciel tout entier est resplendissant, donnant à chacun la nourriture dont il a besoin. Ici, nous n'avons ni gens très maigres, ni gens très gros, mais chacun est comme le corps l'exige.
Ayant regardé autour de lui, Algernon reconnut que c'était indéniablement exact. Il n'y avait pas de personnes grasses, pas de gens maigres, il n'y avait pas de nains ni non plus de géants ; tous semblaient remarquablement bien formés. Certaines personnes qui se promenaient avaient de profonds sillons de concentration sur leur front, s'interrogeant sans aucun doute sur le futur, soucieuses du passé et regrettant leurs actes insensés.
Le compagnon se leva.
— Maintenant, dit-il, nous devons aller à la Maison du Repos et nous pourrons, tout en marchant, poursuivre notre conversation. Votre arrivée ici a été plutôt précipitée, bien que nous soyons toujours vigilants pour les suicides, vous y avez pensé pendant si longtemps que — ah ! — vous nous avez pris assez au dépourvu avec ce dernier acte désespéré.
Se levant, Algernon suivit son compagnon à contrecœur. Ils prirent en flânant le sentier qui longeait l'étang, passant devant de petits groupes de gens en pleine conversation. De temps en temps, on voyait deux personnes se lever à leur tour et se mettre à marcher tout comme Algernon et son compagnon.
— Ici, les conditions sont particulièrement confortables parce que, à ce stade du processus, vous devez être reconditionné en vue d'un retour aux épreuves et aux souffrances terrestres ; mais souvenez-vous que la vie sur la Terre n'est qu'un battement de paupières dans ce qui est, en fait, le Temps Réel ; et quand vous aurez terminé votre vie terrestre, l'ayant achevé avec succès, notez bien que vous ne retournerez pas dans ce lieu, mais que vous le contournerez et irez vers un autre niveau du plan astral, un plan dépendant de vos progrès sur Terre. Pensez à l'école sur Terre : si vous vous en tirez tout juste aux examens, vous pouvez être maintenu dans la même classe, mais si vous réussissez bien, vous pouvez alors passer dans la classe supérieure, et si vous réussissez avec ce que l'on pourrait appeler une mention honorable, alors, vraiment, vous pouvez même passer à deux niveaux supérieurs. C'est la même chose pour les plans astraux. Vous pouvez à cet instant que vous appelez la mort être enlevé de la Terre et transporté en un certain plan astral, ou bien, si votre comportement est particulièrement satisfaisant, être placé sur un plan beaucoup plus élevé ; et, bien sûr, plus vous vous élevez, meilleures sont les conditions.
Algernon se laissait distraire par le spectacle sans cesse changeant. Quittant les bords de l'étang, ils se glissèrent par une ouverture faite dans une haie. Une pelouse merveilleusement entretenue s'étendait devant eux, et là des groupes de gens étaient assis et écoutaient quelqu'un qui, visiblement, faisait une conférence. Mais le compagnon poursuivit sa route et ils arrivèrent devant une petite élévation qu'ils gravirent. Un élégant bâtiment se dressait devant eux ; il était d'un blanc verdâtre, une couleur très reposante, génératrice de tranquillité et bien faite pour donner la paix à l'esprit. Une porte devant eux. Elle s'ouvrit automatiquement et ils pénétrèrent dans un hall brillamment éclairé.
Intéressé, Algernon promena son regard sur ce qui l'entourait. Ce lieu était d'une beauté rare et, de par son appartenance à la haute société anglaise, Algernon se considérait comme un connaisseur en matière d'élégance architecturale. Des colonnes s'élevaient dans le hall, duquel partaient plusieurs couloirs. Il semblait y avoir, en son milieu, un bureau rond autour duquel plusieurs personnes étaient assises. S'avançant, le compagnon d'Algernon le présenta :
— Voici notre ami, Algernon St Clair de Bonkers. Il était attendu et je crois que vous lui avez attribué une chambre.
Une jeune femme chercha dans ses papiers et répondit :
— C'est exact, sir ; on va la lui montrer.
Un jeune homme se leva presque immédiatement et dit en s'avançant vers eux :
— Je vais vous conduire à votre chambre. Si vous voulez bien me suivre...
Ayant salué Algernon, le compagnon quitta le bâtiment. Algernon suivit son nouveau guide le long d'un corridor recouvert d'un tapis moelleux, puis dans une chambre très spacieuse qui contenait un lit et une table et donnait sur deux autres petites pièces attenantes.
— Maintenant, sir, vous allez avoir la gentillesse de bien vouloir vous coucher ; une équipe médicale va venir vous examiner. Vous n'avez pas le droit de quitter cette chambre avant que le docteur, habilité à le faire, vous en donne la permission.
Puis, avec un sourire, il sortit. Algernon inspecta sa chambre et les deux autres pièces. L'une lui sembla être un salon, car elle était meublée d'un divan confortable et de fauteuils, et l'autre n'avait qu'une chaise dure pour tout mobilier. Algernon pensa tout à coup que ce lieu semblait n'avoir pas de toilettes ; puis réfléchissant, il se dit en lui-même : "Pourquoi y en aurait-il ?" Il n'en éprouverait sans doute pas la nécessité et peut-être ne faisait-on pas de telles choses en ce lieu !
Debout près du lit, il resta à s'interroger. Allait-il essayer de s'échapper d'ici ? Il marcha jusqu'à la fenêtre et fut surpris de découvrir qu'elle s'ouvrait librement ; il essaya de sortir, mais une barrière invisible l'en empêcha. La panique qui avait commencé à le gagner tomba et, regagnant son lit, il s'apprêtait à se déshabiller quand il pensa soudain : "Que vais-je faire sans vêtements de nuit ?" Simultanément il entendit ce bruissement qui ne lui était plus inconnu ; se regardant, il vit qu'il était vêtu d'une longue chemise de nuit blanche. Au comble de l'étonnement, il leva les sourcils, et lentement, tout en réfléchissant, il se mit au lit. Quelques minutes plus tard, on frappait à la porte. "Entrez", dit Algernon, et trois personnes — deux hommes et une femme — apparurent. Se présentant, elles lui apprirent qu'elles faisaient partie de l'équipe de réhabilitation. Ces gens ne firent pas usage du stéthoscope, ne tâtèrent pas son pouls, mais se contentèrent de le regarder, et l'un d'eux commença à parler :
— Vous êtes ici parce que vous vous êtes rendu coupable de suicide, crime qui a fait que votre vie sur Terre a été perdue, gaspillée. Vous devrez donc la recommencer et subir de nouvelles expériences dans l'espoir que cette fois vous réussirez sans commettre ce crime qu'est le suicide.
L'homme lui apprit qu'il recevrait un traitement de rayons apaisants qui, on l'espérait, améliorerait rapidement sa santé. Puis Algernon s'entendit dire qu'il importait qu'il retourne sur Terre aussi vite que possible. Plus vite il s'y rendrait, et plus ce serait facile pour lui.
— Mais comment puis-je retourner sur Terre ? s'exclama Algernon. Je suis mort, ou tout au moins mon corps physique est mort, et comment alors pensez-vous pouvoir me faire réintégrer ce corps ?
Ce fut la jeune femme qui répondit :
— Vous êtes victime d'un grave malentendu, à cause de toutes les épouvantables balivernes qu'on vous a enseignées sur la Terre. Le corps physique n'est qu'un vêtement que l'esprit endosse afin que des tâches particulièrement inférieures puissent être accomplies, afin que certaines dures leçons puissent être apprises, car l'esprit ne peut pas expérimenter lui-même des vibrations aussi basses ; et il doit, de ce fait, revêtir un costume qui lui permet d'expérimenter les choses. Vous irez sur Terre et naîtrez de parents qui seront choisis pour vous. Votre naissance sera entourée de conditions qui vous permettront de profiter au maximum de votre expérience terrestre, et souvenez-vous que ce que nous impliquons par ‘profiter’ ne signifie pas nécessairement ‘argent’, car certains des êtres les plus imprégnés de spiritualité sur Terre sont pauvres, alors que les riches sont vilains. Tout dépend de ce qu'une personne a à faire, et il est à penser que dans votre cas vous avez été élevé dans une telle richesse et un tel confort que, cette fois, vous devrez connaître des conditions plus dures.
Ils parlèrent longuement et, en les écoutant, Algernon en vint à saisir progressivement des choses très différentes de celles en lesquelles on l'avait amené à croire. Très vite, il fut à même de se rendre compte que le Christianisme n'était qu'un nom, que le Judaïsme n'était qu'un nom, tout comme le Bouddhisme, l'Islamisme ou autres croyances n'étaient que des noms, et qu'il n'existait réellement qu'une seule religion, une religion que jusqu'ici il n'avait pu comprendre.
Les trois personnes se retirèrent et, dans la chambre, la lumière faiblit. Algernon eut l'impression que la nuit se refermait sur lui. Il se détendit, puis perdit conscience et dormit, dormit, dormit. Il n'aurait pu dire pendant combien de temps — quelques minutes peut-être, quelques heures, ou durant des jours. Mais Algernon dormit, et au cours de ce sommeil son esprit fut ravivé et il recouvra la santé.
Chapitre Quatre
Le soleil brillait quand il s'éveilla et il entendait le chant des oiseaux... Le soleil ? Il se rappela que ce n'était pas le soleil qui brillait. Ici, il n'existait pas, mais l'air semblait vivant. Repoussant le couvre-pied, il se leva et alla à la fenêtre. Tout, à l'extérieur, était aussi brillant et aussi gai qu'hier... était-ce HIER ? Algernon avait perdu le sens des jours et des nuits ; il lui semblait qu'il n'y avait plus de preuve du passage du temps. Il regagna son lit et s'étendit sur le couvre-pied, les mains derrière la tête, réfléchissant à tout ce qui s'était passé.
Un petit coup à la porte et un homme entra. C'était un personnage à l'aspect grave qui donnait l'impression d'être pleinement conscient de l'importance de ses fonctions.
— Je suis venu vous parler, dit-il, car nous craignons que vous ne soyez pas convaincu de la vérité de l'expérience que vous traversez.
Les mains le long du corps et presque au garde-à-vous, comme s'il se trouvait dans un hôpital militaire, Algernon répondit :
— Tout ce que j'ai vu, sir, contredit les enseignements de l'Église Chrétienne. Je m'attendais à être accueilli par des anges qui joueraient de la harpe ; je m'attendais à voir les Portes du Paradis et des chérubins, et au lieu de cela je découvre que ce lieu pourrait tout aussi bien être une sorte de Green Park ou de Hyde Park magnifiés, ou tout autre parc bien entretenu. J'aurais pu, également, avoir eu des hallucinations dans Richmond Park.
Le docteur rit et lui dit :
— Vous n'êtes pas un Chrétien particulièrement fervent. Si vous aviez été disons un Catholique Romain vraiment croyant, alors vous auriez vu des anges en arrivant ici, et vous auriez vu ces anges jusqu'au moment où le côté trompeur de leur apparence vous aurait, au contraire, fait comprendre qu'ils n'étaient que des visions de votre imagination. Ici nous nous occupons de réalité. Vu que vous êtes un homme qui a vécu et a de l'expérience, vu également que vous avez été soldat et avez vu mourir, vous êtes capable de nous voir tels que nous sommes vraiment.
Algernon se prit à penser à certaines scènes de son passé.
— La mort, dit-il. Je suis des plus intrigués par cette question, car elle est sur Terre un tel objet de terreur ; les gens ont une peur horrible de mourir. Et ce qui m'a toujours frappé c'est que ce sont souvent les gens les plus religieux qui sont le plus effrayés par la pensée de la mort. (Joignant les mains en souriant, il continua :) J'ai un ami, fervent Catholique, qui, dès qu'il entend que quelqu'un est au plus mal, ne manque jamais de dire combien il est heureux que M. X ou Y aille mieux et soit en aussi bonne santé ! Mais dites-moi, sir, pourquoi se fait-il que les gens aient si peur de la mort, s'il existe une vie après ?
Souriant d'un air plutôt narquois, le docteur répondit :
— J'aurais pensé qu'un homme de votre sensibilité et instruit comme vous l'êtes aurait deviné la réponse ; comme il est clair que vous ne la connaissez pas, permettez-moi de vous la donner : les gens vont sur Terre pour accomplir certaines choses, pour apprendre certaines choses, pour faire l'expérience de certaines épreuves grâce auxquelles l'esprit, ou l'âme, ou le Sur-Moi — peu importe le nom — peut être purifié et fortifié. Et ainsi, quand une personne se suicide, elle commet un crime contre le programme, contre l'ordre des choses. Et si les gens voyaient que la mort est naturelle et comprenaient qu'elle n'est que naissance à un autre stade d'évolution, alors ils aspireraient à mourir et tout le sens de la Terre et des autres mondes serait perdu.
Pour Algernon l'idée était nouvelle et logique, en vérité. Mais il n'était cependant pas satisfait.
— Dois-je comprendre, alors, que la peur de la mort est provoquée artificiellement et est totalement illogique ?
— C'est exact, répondit le docteur. C'est une disposition de la Nature qui veut que chacun craindra la mort, fera tout pour préserver la vie, afin que les expériences sur Terre puissent être maintenues et menées jusqu'à leur fin logique et programmée. Aussi quand une personne se suicide, elle désorganise tout le système. Mais, attention, dit-il, quand le temps est venu pour une mort naturelle, il n'y a normalement aucune crainte, il n'y a normalement aucune douleur, car les gens qui sont dans un autre royaume astral sont à même de dire quand une personne est destinée à mourir ou à subir la transition (formule que nous préférons) ; une forme d'anesthésie est alors produite et les affres de la mort sont remplacées par de plaisantes pensées de délivrance, le désir de rentrer à la Maison.
Algernon eut un mouvement d'indignation.
— Mais c'est impossible, dit-il, car les gens qui agonisent se tordent souvent dans d'atroces douleurs !
Le docteur dit en secouant la tête tristement :
— Non, non, vous êtes dans l'erreur. Quand une personne se meurt il n'y a pas de douleur, mais une libération de la douleur. Le corps peut se contracter, le corps peut gémir, mais ce n'est qu'une réaction automatique de certains nerfs stimulés. Cela ne signifie pas du tout que la personne souffre. Celui qui en est le témoin n'est généralement pas apte à juger de ce qui se passe. Chez le mourant, la partie consciente qui va subir la transition est détachée de la partie physique qui n'est que l'être animal. C'est ainsi que... quand vous avez commis votre suicide, vous n'avez pas souffert... C'est exact ?
Se grattant le menton, Algernon réfléchit profondément et répondit en hésitant :
— Eh bien, non, je suppose que je n'ai pas souffert. Je ne me souviens pas avoir ressenti quoi que ce soit, si ce n'est une extrême sensation de froid. Non, sir, peut-être avez-vous raison : en y pensant bien, je n'ai ressenti aucune douleur, j'étais stupéfait, ahuri.
Le docteur rit et dit en se frottant les mains :
— Maintenant, je vous tiens ! Vous venez de reconnaître que vous n'avez pas souffert et, pourtant, vous avez crié comme un porc qu'on saigne. Et, à ce propos, avec un porc qu'on saigne, tout ce qui se passe c'est que l'air contenu dans les poumons est expulsé rapidement en agitant les cordes vocales — ce qui provoque un cri aigu. Le même genre de réaction a eu lieu avec vous — un long cri perçant interrompu par un bouillonnement de votre sang s'échappant abondamment par la blessure de votre gorge. Et c'est ce cri perçant qui a poussé la malheureuse femme de chambre à entrer dans la salle de bains.
Oui, cela semblait assez logique. Commençant à voir que, dans tout cela, il ne s'agissait pas d'hallucinations mais de faits, Algernon dit alors au docteur :
— Mais j'avais cru comprendre qu'une personne, à sa mort, était tout de suite conduite devant Dieu pour y être jugée — qu'immédiatement elle rencontrait Jésus et peut-être la Vierge et les disciples.
Secouant la tête d'un air triste, le docteur répondit :
— Vous parlez de voir Jésus ; mais si vous aviez été Juif, si vous aviez été Musulman, si vous aviez été Bouddhiste, auriez-vous espéré voir Jésus ? Ou bien pensez-vous que le Paradis est divisé en différents pays où vont les gens de chaque religion ? Non, l'idée est totalement absurde. C'est une folie criminelle et les prêcheurs terrestres empoisonnent l'esprit des hommes avec leurs monstrueuses histoires. Les gens viennent ici, et ils se croient en enfer. L'enfer N'EXISTE PAS — hormis la Terre !
Algernon bondit. Il sentit son corps se tordre comme s'il était enveloppé de flammes.
— Mais, alors, suis-je au Paradis ? demanda-t-il.
— Non, certainement pas, répliqua le docteur. Un tel lieu n'existe pas. Il n'y a pas de Paradis, il n'y a pas d'enfer, mais il y a un purgatoire. Le purgatoire est l'endroit où vous expiez vos péchés, et c'est ce que vous faites ici. Très bientôt, vous rencontrerez un comité qui vous aidera à décider ce que vous allez faire à votre retour sur Terre. Vous devez y retourner afin de matérialiser le plan décidé par vous-même, et la raison de ma visite est précisément de voir si vous êtes prêt à être présenté au comité.
Algernon fut gagné par une étrange peur et il eut l'impression que des mains glacées lui parcouraient le dos. Ce qui s'annonçait lui semblait pire qu'une commission militaire dans laquelle les médecins chercheraient des preuves, lui posant les questions les plus embarrassantes touchant à ses réactions à telle ou telle chose, et allant jusqu'à le questionner sur la façon dont se déroulait sa vie sexuelle ; était-il marié, avait-il une amie ? Algernon, décidément, ne parvenait pas à éprouver un quelconque enthousiasme à l'idée de se présenter devant une commission de — quoi au juste ?
— Eh bien, j'espère, dit-il, qu'on me laissera le temps de me remettre du traumatisme que représente le passage de la vie à CECI. J'admets que je suis responsable de ma venue ici, en ayant mis fin à mes jours — ce qui apparaît comme étant un crime méprisable — mais je continue cependant à estimer qu'on devrait me donner le temps de récupérer et de décider ce que je veux faire. Et puisque nous sommes sur ce sujet, poursuivit-il, comment se peut-il que le suicide soit un crime aussi odieux, si les gens ne savent pas qu'ils commettent un crime. J'avais toujours pensé que si une personne n'était pas consciente de faire une mauvaise action, elle ne pouvait pas être punie pour l'avoir faite.
— Sottises ! s'exclama le docteur. Voilà bien un trait des gens de votre acabit ; ils considèrent que du fait qu'ils appartiennent à une classe supérieure, ils ont droit à une considération spéciale. Vous essayez toujours de rationaliser. C'est comme un vice inhérent à votre classe. Vous saviez parfaitement qu'il est mal de se suicider. Même votre propre forme particulière de religion, telle qu'elle est enseignée sur Terre, vous inculque l'idée que mettre fin à ses jours est un crime contre l'homme, contre l'état et contre l'église.
Algernon répliqua d'un ton acerbe :
— Alors, que pensez-vous du Japonais qui se fait hara-kiri quand les circonstances l'exigent ? Quand il estime qu'il a perdu la face, il s'ouvre le ventre publiquement. C'est bien un suicide ? Il fait alors ce qu'il croit devoir faire. Vous ne pensez pas ?
L'air affligé, le docteur répondit :
— Le fait qu'au Japon le suicide soit devenu une habitude sociale permettant de mettre fin à ses jours plutôt que d'affronter le déshonneur ne modifie en rien le problème. Permettez-moi de vous dire, et d'enfoncer ceci dans votre subconscient : le suicide n'est JAMAIS admissible. Le suicide est TOUJOURS un crime. Aucune circonstance ne peut faire qu'il soit acceptable. Il signifie qu'une personne n'est pas suffisamment évoluée pour poursuivre ce qu'elle a choisi de sa propre volonté. Mais ne perdons plus de temps. Vous n'êtes pas ici en vacances, vous êtes ici afin que nous puissions vous aider à profiter au mieux de votre prochaine vie sur Terre. Venez !
Il se leva brusquement, dominant Algernon qui protestait d'un ton plaintif :
— Ne me laisserez-vous pas prendre un bain ? N'aurai-je pas un petit déjeuner avant d'être traîné hors d'ici ?
— Foutaise ! s'exclama le docteur d'un ton irrité, ici vous n'avez pas besoin de bain, pas besoin de nourriture. L'atmosphère vous nourrit et vous nettoie. Vous minimisez la question pour la simple raison que vous n'êtes pas vraiment adulte, mais quelqu'un qui essaye d'échapper à ses responsabilités. Suivez-moi.
Se détournant, le docteur se dirigea vers la porte.
À son corps défendant, Algernon se leva et le suivit. Le docteur tourna à droite et entra dans un jardin qu'Algernon n'avait pas encore vu. L'atmosphère y était exquise ; l'air était plein d'oiseaux, et de jolis animaux étaient étendus sur l'herbe ; après un dernier tournant, un autre bâtiment apparut. Orné de nombreuses flèches il évoquait une cathédrale, et cette fois on y accédait non pas par une rampe, mais par de très nombreuses marches. Les ayant montées, ils se dirigèrent vers un coin frais d'un bâtiment très vaste. L'entrée était occupée par de nombreuses personnes ; d'autres étaient assises sur des bancs confortables disposés contre les murs. Là encore, il y avait, au centre du vestibule, ce qui ressemblait à un bureau de réception, de forme circulaire comme le précédent, mais pourvu, cette fois, d'un personnel beaucoup plus âgé. Le docteur y conduisit Algernon et s'adressa au préposé en disant :
— Nous sommes venus pour nous présenter devant le Conseil.
L'un des assistants se leva.
— Suivez-moi, dit-il.
L'assistant ouvrit la marche, le docteur et Algernon le suivant. Marchant quelques minutes au long d'un corridor, ils tournèrent à gauche dans une antichambre.
— Veuillez attendre ici, dit l'assistant.
Il frappa à une porte et entra, après en avoir été prié. La porte se ferma et un faible murmure de voix devint perceptible.
L'assistant revint après quelques instants, et dit, tenant la porte ouverte :
— Vous pouvez entrer.
Se levant rapidement, le docteur prit Algernon par le bras, et le fit entrer.
À peine à l'intérieur, Algernon s'arrêta au comble de l'étonnement. C'était une pièce aux proportions très vastes et, en son centre, un globe avec des taches bleues et vertes tournait dans un mouvement lent. Algernon comprit qu'il s'agissait d'une représentation de la Terre. En voyant que le globe terrestre tournait sans aucun système de support, Algernon resta fasciné et intrigué. Il lui semblait être dans l'espace et regarder, de là, la Terre illuminée par quelque soleil invisible.
Il y avait une longue table, merveilleusement polie, aux sculptures délicates — et à un des bouts de cette table se tenait un très vieil homme dont la barbe et les cheveux étaient blancs. Son expression était pleine de bienveillance, mais aussi de gravité. Il donnait l'impression que, si les circonstances l'exigeaient, il serait capable de se montrer vraiment très dur.
Algernon jeta un coup d'œil rapide à la ronde et, autour de la table, il crut voir huit personnes — quatre hommes et quatre femmes. Le docteur le fit asseoir à l'autre bout de la table. La forme de celle-ci, remarqua Algernon, permettait à tous les autres membres de le voir sans avoir à tourner leur chaise ; l'espace de quelques secondes, il songea à l'artisan qui avait su élaborer une géométrie si compliquée.
— Voici Algernon St Clair de Bonkers, dit le docteur. D'après nous, il est maintenant en état de profiter de vos conseils.
Le vieil homme, d'un petit mouvement de tête, leur fit signe de s'asseoir, puis il parla :
— Algernon St Clair de Bonkers, vous êtes ici parce que vous avez mis fin à vos jours. Vous vous êtes tué en dépit des plans que vous aviez faits, et à l'encontre de la Loi Supérieure. Avez-vous d'abord quelque chose à dire pour votre défense ?
Tremblant, Algernon s'éclaircit la gorge.
— Levez-vous, lui murmura le docteur en se penchant vers lui.
À contrecœur, Algernon se mit debout et dit avec un air de défi :
— Si j'ai décidé de faire une certaine tâche, et si des conditions que je n'ai pas choisies m'ont empêché de l'accomplir, alors étant donné que ma vie m'appartient, j'ai le droit d'y mettre fin — si je choisis de le faire. Je n'ai pas décidé de venir ici ; je n'ai décidé que de mettre fin à ma vie.
Et, sur ces mots, il s'assit lourdement.
Le docteur le regarda d'un air triste. Le vieil homme lui jeta un regard de pitié et les huit autres personnes le fixèrent avec compassion, comme s'ils avaient déjà entendu ce qu'il venait de dire. Le vieil homme, de nouveau, parla :
— Vous avez fait votre plan, mais votre vie ne vous appartient pas. Elle appartient à votre Sur-Moi — ce que vous appelez votre âme — et vous l'avez blessé par votre esprit récalcitrant et par votre façon idiote de le priver de sa marionnette. Pour cette raison, vous devrez retourner sur Terre, y vivre à nouveau une vie entière, et, cette fois, ne vous suicidez surtout pas. Il nous faut maintenant décider quel sera le moment le plus favorable pour votre retour ainsi que les meilleures conditions, et vous trouver les parents appropriés.
Il y eut un grand bruit de papiers froissés, puis l'un des membres se leva et s'approcha du globe. Silencieux, il demeura quelques minutes à le regarder. Puis il regagna sa place et nota quelque chose sur un feuillet.
— Algernon, dit le vieil homme, vous êtes allé sur Terre dans des conditions de grande aisance. Vous êtes allé dans une vieille famille bien établie où l'on veillait à vous donner tout le confort possible. Vous receviez tous les égards possibles. L'argent n'était pas un problème. Votre éducation a été la meilleure qui se pouvait obtenir dans votre pays. Mais avez-vous pensé au mal que vous avez fait dans votre vie ? Avez-vous pensé à votre brutalité, à la façon dont vous aviez coutume de frapper les serviteurs ? Avez-vous pensé aux jeunes servantes que vous avez séduites ?
Bondissant d'indignation, Algernon s'exclama :
— On me disait toujours que les jeunes filles qui servaient à la maison étaient là pour la commodité du fils célibataire, pour lui servir de divertissement, pour lui permettre d'apprendre ce qui touche au sexe. Je n'ai rien fait de mal, quel que soit le nombre de servantes que j'ai séduites !
Il se rassit, écumant d'indignation.
— Algernon, dit le vieil homme, vous savez parfaitement que la notion de classe, comme vous la considérez, n'est qu'une chose purement artificielle. Dans votre monde, si quelqu'un a de l'argent ou s'il vient d'une vieille famille qui a été favorisée, il obtient une quantité de privilèges. Tandis que si une personne est pauvre et qu'elle doive travailler pour l'une de ces familles, on ne lui accorde aucun privilège et elle est traitée comme une créature inférieure. Vous connaissez la loi aussi bien que quiconque car vous avez vécu de nombreuses fois et toute cette connaissance est emmagasinée dans votre sub-conscience.
Faisant la moue comme si elle venait de goûter à une groseille aigre, une des femmes assises à la table prit la parole et dit d'un air pincé :
— Je tiens à dire que, de mon point de vue, ce jeune homme devrait recommencer sa vie comme un non-privilégié. Il a toujours fait ce qui lui plaisait. J'estime qu'il devrait recommencer comme fils d'un petit négociant ou même fils de vacher.
Furieux, Algernon bondit en criant :
— Comment osez-vous dire cela ? Savez-vous que du sang bleu coule dans mes veines ? Savez-vous que mes ancêtres sont allés à la Croisade ? Ma famille jouit d'un très grand respect.
Le vieil homme l'interrompit au milieu de son discours en disant :
— Voyons, voyons, les discussions ne mèneront à rien. Elles ne feront qu'ajouter au fardeau que vous avez à porter. Nous essayons de vous aider, non pas d'ajouter à votre Karma, mais de l'alléger.
Algernon l'interrompit brutalement.
— Je ne permettrai pas qu'on touche à mes aïeux. Je suppose que les vôtres, dit-il en pointant un doigt vers la femme qui avait parlé, étaient des propriétaires de bordels ou autre chose du même ordre.
Saisissant Algernon par le bras, le docteur le fit asseoir en lui disant :
— Tenez-vous tranquille, espèce de clown ; vous aggravez votre cas. Vous n'avez pas la moindre idée de là où vous êtes, alors taisez-vous et écoutez ce que l'on a à vous dire.
Algernon s'apaisa à l'idée qu'il était en vérité au Purgatoire — comme on le lui avait dit — et il écouta le chairman qui s'adressait à lui :
— Algernon, vous vous comportez comme si nous étions vos ennemis. Mais ce n'est pas le cas. Vous devez savoir que vous n'êtes pas ici en tant qu'invité d'honneur. Vous y êtes à cause du crime que vous avez commis, et avant que nous n'allions plus avant, je tiens à mettre les choses au point : vous n'avez pas de sang bleu dans les veines. La classe, la caste, ou les statuts ne sont pas des choses dont on hérite. Vous avez subi un lavage de cerveau, vous êtes confus suite aux légendes et aux contes de fées qu'on vous a racontés. (Il s'arrêta, but une gorgée d'eau et, avant que de poursuivre, jeta un regard aux autres membres du Conseil.) Vous devez garder à l'esprit la pensée nette, très nette, que les entités viennent d'innombrables mondes, d'innombrables plans d'existence et descendent sur Terre, l'un des mondes les plus bas, pour y apprendre par les épreuves ce qu'elles semblent incapables d'apprendre par la bonté et la bienveillance. Et quand on se rend sur la Terre, on adopte le corps qui paraît le plus adapté à la réalisation de sa tâche. Si vous étiez un acteur, vous comprendriez que vous n'êtes que l'homme, l'acteur, et vous pourriez être appelé à jouer de très nombreux rôles au cours de votre vie. Ainsi, en tant qu'acteur, vous pourriez avoir à vous vêtir comme un prince, un roi ou un mendiant. En roi, peut-être auriez-vous à prétendre que vous êtes de Sang Royal, mais ce ne serait que feinte. Chacun dans le théâtre le saurait. Il est certains acteurs qui entrent à un point tel dans la peau de leur personnage — comme vous l'avez fait — qu'ils en viennent à se croire princes ou rois, mais se refusent à être mendiants. Peu importe d'ailleurs ce que vous êtes et ce qu'est votre degré d'évolution ; si vous êtes ici, c'est parce que vous avez commis un crime — et le suicide en est vraiment un. Vous êtes ici pour expier ce crime. Vous êtes ici afin que nous, qui sommes en contact avec des plans plus élevés et aussi avec la Terre elle-même, puissions vous suggérer la façon la meilleure d'accomplir cette expiation.
Algernon n'avait pas du tout l'air content et demanda sur un ton toujours considérablement agressif :
— Comment pouvais-je savoir qu'il était mal de mettre fin à ses jours, et qu'avez-vous à dire sur les Japonais qui se suicident par sens de l'honneur ?
Le chairman répondit :
— Le suicide n'est jamais ce qu'il convient de choisir. Il ne se justifie même pas pour les prêtres Bouddhistes ou les prêtres Shinto qui s'immolent par le feu, qui s'éviscèrent, ou qui se précipitent du haut d'une falaise. Les lois faites par l'homme ne peuvent jamais prendre le pas sur les lois de l'Univers. (Regardant ses papiers, il reprit :) Vous étiez destiné à vivre jusqu'à un certain âge, et vous avez mis fin à votre vie trente ans avant l'heure prévue ; ainsi, vous aurez donc à retourner sur la Terre pour y vivre pendant trente années et y mourir, et les deux existences, celle à laquelle vous avez mis fin et celle que vous allez maintenant vivre, ne compteront que pour une — une session d'étude, comme nous pourrions l'appeler.
Une des femmes leva la main pour attirer l'attention du chairman.
— Vous désirez parler, madame ?
— Oui, sir. Je pense que le jeune homme n'a pas conscience de sa position. Il se croit terriblement supérieur à tout le monde. Peut-être devrait-on lui parler des morts dont il est responsable, et insister davantage sur son passé.
— Oui, bien sûr, mais comme vous le savez fort bien, répondit le chairman plutôt irrité, il va revoir son passé dans le Hall des Souvenirs.
— Mais, sir, répliqua la femme, l'interlude du Hall des Souvenirs vient ensuite, et nous voulons que ce jeune homme nous écoute maintenant de façon sensée. S'il en est capable, ajouta-t-elle en jetant un regard sombre à Algernon. Je pense qu'il devrait être mieux informé de sa situation dès à présent.
Le chairman soupira et haussa les épaules en disant :
— Bien ! puisque vous le souhaitez, nous allons modifier nos habitudes. Je suggère que nous amenions maintenant le jeune homme dans le Hall des Souvenirs, afin qu'il puisse voir ce qui nous déplaît dans son comportement.
Les membres du Conseil repoussèrent leur chaise et se levèrent. L'air consterné, le docteur se leva également.
— Venez, dit-il à Algernon. Vous l'avez cherché.
Promenant de l'un à l'autre un regard indigné, Algernon explosa.
— Je n'ai pas demandé à venir ici. Je ne comprends pas le pourquoi de toute cette agitation. Si je dois retourner sur Terre, eh bien, laissez-moi le faire et n'en parlons plus !
— Nous allons maintenant vous accompagner jusqu'au Hall des Souvenirs, dit le chairman. Là, vous serez à même de revoir tous les événements de votre vie passée, et de décider si nous abusons de notre autorité — comme vous semblez l'imaginer — ou si nous nous montrons indulgents. Venez !
Ayant ainsi parlé, il le conduisit au-dehors. Il se sentit bien d'être à l'air ; les oiseaux chantaient et les abeilles bourdonnaient amicalement autour de lui. Ici, il n'y avait pas d'insectes qui piquaient ou qui harcelaient, mais seulement des bestioles qui ajoutaient ce que l'on pourrait appeler une musique familière à l'environnement.
Le chairman et les autres membres du Conseil montraient le chemin, presque comme dans une promenade scolaire — à la différence, pensa Algernon, que pour lui ce n'était pas une partie de plaisir. Jetant un regard de côté, il dit au docteur :
— Vous avez l'air d'être mon geôlier !
Le docteur ignora la réflexion et se contenta de lui serrer le bras un peu plus fort en l'entraînant.
Ils arrivaient bientôt devant un autre bâtiment, et à peine l'avait-il aperçu qu'Algernon s'écria :
— Oh ! l'Albert Hall ! Comment sommes-nous revenus à Londres ?
Le docteur, que l'idée amusa, éclata de rire en disant :
— Ce n'est pas l'Albert Hall ; regardez bien son architecture. Cet endroit est MAGNIFIQUE !
Ensemble, ils pénétrèrent dans le Hall qui, comme l'avait dit le docteur, était ‘magnifique’. Ils s'enfoncèrent plus avant. Algernon jugea qu'ils devaient être à peu près au cœur du bâtiment. Une porte s'ouvrit et Algernon recula si violemment qu'il buta sur le docteur, lequel rit en lui disant :
— Oh non, ce n'est pas le bord de l'Univers, vous ne pouvez pas chuter, c'est tout à fait normal. Reprenez-vous, rien de dangereux ne peut se produire.
Le chairman se tourna vers Algernon en lui disant :
— Avancez jeune homme, avancez, vous saurez à quel moment vous arrêter, et soyez très attentif.
Algernon s'immobilisa sur place pendant quelques instants, terrifié, et redoutant de tomber du bord de l'Univers et de s'écrouler parmi les étoiles, à ses pieds. Une poussée ferme dans le dos le fit avancer et, s'étant mis en mouvement, il s'aperçut qu'il ne pouvait plus s'arrêter.
Il continuait à aller de l'avant, mû par quelque force inconnue. À mesure qu'il avançait, les ombres, les formes et les couleurs glissaient autour de lui, les ombres allant s'épaississant jusqu'à devenir un obstacle solide. Il s'arrêta net, sans l'avoir voulu. Il regarda autour de lui, confus, puis, une voix dit :
— Entrez.
Toujours sans avoir à faire le moindre effort, il avança au travers de ce qui semblait être un mur impénétrable. Le sentiment de chute qu'il éprouva avait quelque chose de traumatisant. Ensuite, Algernon eut l'impression d'être désincarné ; il regarda vers le bas où une scène se déroulait. Une nurse tenait un bébé qui venait de sortir du ventre de sa mère. Un homme à l'air menaçant regardait le bébé et dit à la nurse en tortillant soudain sa moustache : "Horrible petite créature, ne trouvez-vous pas ? Il ressemble beaucoup plus à un rat noyé qu'à ce qui, je l'espère, sera un homme. C'est bien, nurse, emmenez-le." La scène changea et Algernon se vit dans une salle de classe en face de son précepteur, à qui il faisait des farces. Mais l'homme ne pouvait protester vu que le père d'Algernon, un aristocrate tyrannique et hautain, regardait précepteurs, gouvernantes et autres gens de maison comme des inférieurs méprisables. Algernon rougit en revoyant l'horreur de certains de ses actes. Puis la scène changea à nouveau. Il était plus âgé — peut-être entre quatorze et quinze ans ; il se vit, regardant furtivement depuis le seuil d'une porte, dans une partie assez déserte du manoir. Une jeune et jolie servante s'avançait et Algernon s'était caché ; mais comme elle passait devant la porte, il l'avait saisie par le cou et l'avait entraînée dans sa chambre. Il avait rapidement fermé la porte et, tenant toujours la servante par le cou pour l'empêcher de crier, il lui avait arraché ses vêtements. Son visage s'empourpra à la pensée de ce qu'il avait fait. Autre scène : il était debout dans le bureau de son père, ainsi que la servante en larmes. Son père tout en tortillant ses moustaches avait écouté ce que la fille avait à dire et il avait alors éclaté d'un rire dur en disant : "Dieu du Ciel, ne comprenez-vous pas, femme, qu'un jeune homme se doit de découvrir le sexe, et pourquoi croyez-vous que vous êtes ici ? Si vous ne pouvez pas accepter une petite chose comme celle-ci... sortez de ma maison !" Et ce disant, il l'avait giflée. Elle s'était sauvée de la pièce en pleurant. Le père s'était alors tourné vers Algernon en disant : "Ainsi, jeune homme, tu n'es plus vierge, désormais ! C'est bien, continue ! Je veux voir naître beaucoup de fils robustes avant que je ne quitte ce monde." Ce disant, il avait congédié Algernon d'un geste.
Les scènes se succédaient. Eton et les régates sur la rivière, Oxford, l'armée, l'instruction des hommes et cette guerre contre les Boers. Il regarda ces images avec horreur ; il se vit donnant l'ordre à ses hommes de massacrer une malheureuse famille sans défense — qui n'avait d'autre tort que de ne pas comprendre un ordre donné en anglais puisqu'ils ne parlaient que l'africaans. Il vit leurs corps projetés dans le fossé, et son rire à lui, quand un homme avait traversé d'un coup de baïonnette le corps d'une jeune fille.
Les images continuaient de défiler. Algernon baignait dans sa sueur. Il éprouva le besoin de vomir, mais ne le put. Le total des morts continuait de s'élever : soixante-dix, soixante-quatorze, soixante-dix-huit. Soixante-dix-huit morts, et comme il s'apprêtait à tuer le soixante-dix-neuvième, un tireur d'élite s'était levé et l'avait émasculé d'un coup de fusil.
Les images continuèrent jusqu'à ce que, apparemment, elles cessèrent d'avoir un sens pour lui. Il chancela et s'appuya contre le mur ; sans s'expliquer comment, car il n'avait fait aucun mouvement, il se retrouva de nouveau en compagnie du docteur et des membres du Conseil. Ils le regardèrent d'un air interrogateur et pendant quelques instants un éclair de compassion passa sur le visage du chairman. Toutefois, il se contenta de dire :
— Reprenons notre discussion.
Quittant le Hall des Souvenirs, ils regagnèrent la Salle du Conseil.
Là, le chairman dit à Algernon :
— Vous avez vu les événements de votre vie. Vous avez vu que sang bleu ou sang rouge, vous avez commis une suite de crimes dont le couronnement a été votre suicide. Maintenant nous devons décider, ou plutôt nous devons vous aider à décider de la meilleure vocation qui vous permettra d'expier le mal que vous avez fait dans la cruauté de la guerre et d'expier votre suicide. Avez-vous une idée de ce que pourrait être cette vocation ?
Algernon se sentait très châtié, il était très troublé. Tout ce qu'il avait éprouvé dans sa vie n'était rien à côté de ce qu'il ressentait à cet instant. La tête dans ses mains, il appuya ses coudes sur la table. Un silence absolu régnait dans la pièce. Il resta ainsi longtemps à penser à tout ce qu'il avait vu, bien pire, à penser à toutes les choses qu'il avait vues des actes qu'il avait commis, et il réfléchit à ce qu'il pourrait être. La pensée lui vint qu'il pourrait peut-être devenir un prêtre, un ecclésiastique, possiblement un évêque et, avec quelques influences, il pourrait même devenir archevêque. Mais arrivé à ce point, il éprouva un tel sentiment de négativité qu'il modifia tout de suite sa ligne de pensée.
Un vétérinaire, pensa-t-il. Mais il n'aimait pas assez les animaux pour cela, et la profession n'impliquait pas un rang social très élevé. Être vétérinaire constituait un tel déclassement pour quelqu'un de sa caste.
Il eut l'impression d'entendre rire de façon moqueuse — et ce rire indiquait que là encore il était sur la mauvaise voie. Il pensa alors à devenir docteur, un docteur à la mode, dont la clientèle se recruterait parmi la noblesse ; et s'il lui était donné de sauver soixante-dix ou quatre-vingts vies dans sa carrière, il aurait alors le ‘linge blanc des pénitents’ avec lequel commencer une autre vie à la fin de ceci, celle qui l'attendait.
Un des hommes parla pour la première fois.
— Nous avons, bien sûr, suivi vos pensées dans ce globe.
Il fit un geste en direction d'un globe posé sur la table et qu'Algernon n'avait pas vu, car il était recouvert d'un tissu ; mais maintenant il rougeoyait et révélait les pensées d'Algernon. Réalisant que tout ce qu'il avait pensé avait été révélé, Algernon rougit vivement, de sorte que l'image dans le globe devint tout aussi rouge.
Le chairman parla.
— Oui, je peux tout à fait vous recommander de devenir docteur, mais certainement pas un docteur mondain. Le plan que je conseillerai dans votre cas est le suivant. (Il fouilla dans ses papiers et reprit :) Vous avez tué, vous en avez blessé et mutilé d'autres.
— Non, cria Algernon en se dressant, je n'ai pas blessé, je n'ai pas mutilé...
Le chairman l'interrompit :
— Vous l'avez fait ; d'autres, sur vos ordres, ont été tués, d'autres ont été blessés et mutilés et vous en portez le blâme au même titre que les exécutants. Mais je vous prie de m'écouter attentivement, car je ne répéterai pas ce que je vous dis. Vous deviendrez un médecin, mais dans un district pauvre, où vous travaillerez parmi les miséreux. Vous recommencerez votre existence dans les conditions les plus humbles — non plus comme un membre de l'aristocratie, mais comme quelqu'un qui devra lutter pour atteindre le sommet. À votre trentième année de vie, celle-ci sera terminée et vous reviendrez ici si vous répétez votre suicide ; sinon, vous irez à un niveau plus élevé de l'astral où vous serez préparé en fonction de la façon dont vous aurez agi dans la vie que vous êtes sur le point d'entreprendre.
Les discussions durèrent pendant très longtemps, puis le chairman, après un coup de marteau sur la table, reprit la parole :
— Nous nous rencontrerons à nouveau pour décider des parents que vous aurez, de la région où vous naîtrez et aussi de la date. Jusqu'à ce moment, vous pouvez regagner la Maison du Repos. La réunion est terminée.
L'air sombre, Algernon et le docteur refirent le chemin en silence. Le docteur l'installa dans la chambre qui convenait, en lui disant :
— Je reviendrai plus tard quand on me dira de le faire.
Avec un salut très bref, il s'éloigna, et Algernon s'assit, la tête dans les mains. L'image même de l'extrême misère, pensant à tout ce qu'il avait vu, à tout ce qu'il avait fait et se disant en lui-même : "Eh bien, si ceci est le Purgatoire, alors c'est que l'Enfer n'existe pas !"
Chapitre Cinq
Se sentant vraiment très malheureux, il passait ses doigts crispés à travers ses cheveux en désordre. Il expiait maintenant le crime dont il s'était rendu coupable, et il l'expierait encore pendant longtemps. Où et comment cela finirait-il ? Il repassa dans son esprit tous les incidents survenus depuis son arrivée ici — le plan du purgatoire.
— Ainsi, il était mal d'être un aristocrate ? Mal d'être de sang bleu ? marmonna-t-il à haute voix en fixant le sol.
Puis, entendant ouvrir la porte, il pivota brusquement. À la vision qui apparut — une nurse très séduisante — il bondit, le visage rayonnant :
— Oh ! s'écria-t-il joyeusement, un ange est venu pour m'arracher à ce lieu ténébreux ! (Il considéra la nurse avec des yeux avides :) Quelle beauté en un endroit comme celui-ci. Quel...
— Assez ! interrompit la nurse. Je suis complètement immunisée contre vos flatteries. Vous êtes tous les mêmes, vous les hommes. Vous ne pensez qu'à une chose en venant ici, et je préfère vous dire que nous, les femmes, sommes vraiment lasses de vos avances. Asseyez-vous, ajouta-t-elle, j'ai à vous parler et je dois vous emmener ailleurs. Avant tout, je vous dirai que j'ai, involontairement, surpris ce que vous disiez quand je suis entrée.
Il l'invita à s'asseoir. Ce qu'elle fit, et Algernon s'empressa d'avancer sa chaise pour être près d'elle. Mais voyant qu'elle avait choisi de se tenir en face de lui, il en fut irrité.
— Maintenant, Cinquante-Trois..., lui dit-elle.
Algernon leva la main.
— Vous vous trompez, miss, je ne suis pas Cinquante-Trois ; je suis Algernon St Clair de Bonkers.
La nurse renifla de manière audible et rejeta la tête en arrière en répliquant :
— Ne soyez pas stupide. Il ne s'agit plus maintenant de jouer ; vous êtes ici entre deux actes — si l'on peut dire. (Rejetant ce qu'il voulait dire d'un geste de la main, elle reprit :) Je veux tout d'abord vous parler de deux choses en particulier. L'une est qu'ici vous n'êtes pas Algernon de... ce que vous voudrez ; vous êtes le numéro Cinquante-Trois. Ici, votre position n'est pas loin de celle d'un condamné — condamné pour crime de suicide — et ici ce nombre Cinquante-Trois se rapporte aux derniers chiffres de votre fréquence de base.
Algernon sentit que son cerveau tâtonnait.
— Fréquence de base, répéta-t-il. J'ai peur de ne pas comprendre ce dont vous parlez. Mon nom est Algernon, et non pas Cinquante-Trois.
— Il vous reste beaucoup à apprendre, jeune homme, rétorqua la nurse d'un ton sévère. Vous me semblez d'une ignorance incroyable pour quelqu'un qui se targue d'être de sang presque royal. Mais voyons d'abord ce point. Vous semblez penser que, venu ici en tant que personne titrée, votre position demeure inchangée. Vous vous trompez !
Algernon explosa :
— Vous devez être une Communiste ou quelque chose de cet acabit ! C'est le thème communiste classique qui veut que tous les hommes soient sur le même plan, socialement !
La nurse soupira d'un air exaspéré puis reprit d'une voix lasse :
— C'est bien vrai que vous êtes terriblement ignorant. Je vais vous dire, une fois pour toutes, que le Communisme est un crime — au moins égal au suicide. Et ceci pour la raison que la personne qui se tue commet un crime contre elle-même, et que le Communisme est un crime contre la race entière, un crime contre l'humanité. En fait, le Communisme est un cancer dans le corps du monde. Nous sommes contre le Communisme et un jour viendra — un jour encore lointain — où il sera anéanti, car il repose sur de faux préceptes ; mais là n'est pas l'objet de ma présence ici.
Ayant consulté quelque papiers, elle se tourna de nouveau vers Algernon et lui dit en le regardant bien dans les yeux :
— Nous devons vous arracher cette détestable idée que, ayant été titré, vous allez continuer à le demeurer. Considérons les choses du point de vue terrestre. Pensez à l'écrivain William Shakespeare et aux pièces qu'il nous a laissées. Les personnages qu'il campait étaient parfois des scélérats et parfois des rois. Mais je vais vous dire brutalement qu'on aurait un rire méprisant pour l'acteur qui, ayant joué le rôle du roi dans Hamlet, se comporterait dans la réalité comme s'il était vraiment un roi. Les gens sont sur Terre pour apprendre leur rôle particulier dans la pièce qu'est la vie — rôle qui leur permet d'accomplir les tâches qui leur sont dévolues ; et les ayant accomplies, ils reviennent au monde astral et abandonnent, bien sûr, leur identité imaginaire pour retrouver leur identité naturelle, déterminée par leur propre Sur-Moi supérieur.
Frissonnant, Algernon — ou plutôt Cinquante-Trois — répliqua :
— Oh, la, la ! Je déteste sincèrement le genre bas-bleu. Quand une ravissante jeune femme commence à prêcher et à faire la leçon, cela me coupe vraiment tous mes moyens.
— Oh, ce n'en est que mieux ! répondit la nurse, car votre tournure d'esprit me déplaît passablement et je suis ravie d'avoir douché vos pensées libidineuses.
Ayant regardé ses notes une nouvelle fois, elle s'adressa à Algernon.
— Vous n'avez pas été envoyé dans la bonne Maison de Repos ; aussi je dois vous conduire dans une autre qui ne sera que temporaire, vu que vous devez retourner aussi vite que possible sur Terre. En fait, vous n'êtes ici qu'en transit, et tout ce que nous pouvons faire pour vous est de vous transférer aussi rapidement que possible. Veuillez me suivre.
Elle se leva et gagna la porte. Cinquante-Trois, ex-Algernon, se précipita pour lui tenir la porte et, s'inclinant légèrement d'un air moqueur :
— Après vous, madame, après vous, dit-il.
Avec dignité, la nurse franchit la porte et vint buter contre le docteur qui s'apprêtait à entrer.
— Oh, désolée, docteur ; je ne vous avais pas vu ! s'exclama la nurse.
— Ce n'est rien, miss. Je venais chercher Cinquante-Trois. Le Conseil désire à nouveau le voir. Avez-vous quelque chose à lui dire ?
La nurse sourit et répondit :
— Non, je ne suis que trop heureuse de me débarrasser de lui. Il me paraît assez effronté pour quelqu'un dans sa position. J'ai essayé de lui apprendre qu'ici le sang bleu ne compte pas, bien qu'il soit toutefois un peu supérieur au sang communiste. Mais, docteur, quand le Conseil en aura terminé avec lui, vous savez qu'il doit aller à la Maison pour gens de passage ; il y a eu confusion dans les ordres et je pense que c'est pourquoi vous l'avez amené ici. Voulez-vous vous assurer qu'il se rendra bien à la Maison de Transit ?
— Je m'en occuperai, répondit le docteur. (Puis, faisant un signe à Cinquante-Trois :) Venez, nous sommes déjà en retard.
Ils prirent un corridor qu'Algernon — non, Cinquante-Trois — n'avait pas encore vu.
Le pauvre garçon avait décidément l'air très abattu et répétait :
— Purgatoire ? C'en est un vraiment. Je suis certain que j'aurai plusieurs pouces (cm) en moins en sortant d'ici. Je me sens sur les genoux de toute la marche qu'on me fait faire !
Le docteur, auquel le soliloque de Cinquante-Trois n'avait pas échappé, se mit à rire et rétorqua :
— Oui, en effet, vous serez beaucoup, beaucoup plus petit en sortant d'ici, puisque vous serez un enfant dans le ventre de sa mère !
Le docteur et Cinquante-Trois se dirigèrent alors vers un long corridor. Deux gardes étaient assis de chaque côté de l'entrée. L'un d'eux salua rapidement le docteur et demanda :
— Est-ce Cinquante-Trois ?
— Oui, c'est lui, dit le docteur. Êtes-vous celui qui va nous accompagner ?
Le garde assis à droite de l'entrée se leva en disant :
— Oui, c'est moi qui vous accompagne, mais ne perdons plus de temps, voulez-vous ?
Se retournant, il partit à grandes enjambées le long du corridor. Cinquante-Trois et le docteur durent s'élancer d'un pas vif afin de pouvoir le suivre. Ils marchèrent, marchèrent, et Cinquante-Trois fut horrifié de ce que le corridor paraissait s'étirer à l'infini ; mais soudain, diversion : un embranchement. Le garde, ou le guide — Cinquante-Trois ne savait trop — prit à gauche, avança encore, puis frappa sans tarder à une porte.
— Entrez, dit une voix.
Le garde, bien vite, ouvrit toute grande la porte. Le docteur entra le premier, suivi de Cinquante-Trois et du garde qui ferma la porte derrière lui d'une poigne vigoureuse.
— Venez vous asseoir ici, dit une voix.
Cinquante-Trois s'avança vers le siège qu'on lui désignait.
— Nous devons maintenant discuter de votre futur. Nous voulons que vous retourniez sur Terre très rapidement, mais au moment qui sera compatible avec les fonctions biologiques d'une femme, dit la voix.
Cinquante-Trois regarda autour de lui — l'intensité de la lumière dans le bâtiment était telle qu'il en était ébloui. Il vit un mur ; mais ce fut pour lui un étonnement, car ce mur donnait l'impression d'être un verre dépoli sur lequel, à intervalles, des lumières colorées passaient puis disparaissaient. Il vit qu'il était dans une pièce, d'une espèce à laquelle il n'avait jamais songé auparavant. Elle était d'une austérité de chambre de clinique, pas blanche, mais d'un vert pâle très reposant. Cinq ou six personnes étaient autour de lui, vêtues de blouses du même vert. Il n'aurait pu dire le nombre exact de ces gens, car certains entraient et d'autres sortaient — mais ces choses n'avaient aucune importance, car la voix de nouveau parlait :
— J'ai examiné et considéré avec beaucoup d'attention toutes les informations qui m'ont été transmises. Je suis allé à travers tout votre passé — le passé précédant votre venue sur la Terre, et je découvre que d'après vos lumières vous vous en êtes assez bien tiré sur Terre, toutefois, selon les mœurs et les valeurs de la vie réelle, vous avez été un échec et vous avez, à cet échec, ajouté le crime du suicide. Aussi nous voulons maintenant vous aider.
Cinquante-Trois, qui paraissait très irrité, ne put s'empêcher d'éclater :
— M'aider ? M'aider ! Depuis ma venue ici, je n'ai cessé d'être critiqué, blâmé pour avoir appartenu à la haute société, blâmé pour avoir dit que peut-être j'aurais dû être un Communiste. Qu’est-ce que je DOIS croire ? Si je suis ici pour recevoir un châtiment, alors pourquoi ne pas me l'infliger ?
Le vieil homme svelte aux cheveux gris assis en face de Cinquante-Trois semblait réellement peiné et remarquablement compatissant.
— Je suis navré, dit-il, de votre attitude ; elle rend les choses très difficiles pour nous, parce que nous sommes venus à la conclusion inévitable qu'étant allé sur Terre avec un statut assez favorable qui a affecté votre psyché, il est nécessaire que vous y retourniez dans des conditions humbles et pauvres. Sinon, vous allez vous rendre intolérable et donner à votre Sur-Moi des impressions absolument fausses. Me suis-je bien fait comprendre ?
Cinquante-Trois qui faisait grise mine rétorqua :
— Non, définitivement non ; je ne comprends absolument pas à quoi vous faites allusion quand vous parlez de Sur-Moi. Jusqu'ici je n'ai entendu que ce que j'appellerai un charabia, et je n'ai pas le moindre sentiment de culpabilité pour ce que j'ai fait. Par conséquent, d’après la loi anglaise, je n'ai rien fait de mal !
Le vieil homme sentit sa détermination se durcir. Il avait l'impression que cet homme — ce Cinquante-Trois — s'amusait à créer des difficultés.
— Vous êtes dans l'erreur pour ce qui est de votre référence à la loi anglaise, dit l'interrogateur, car si vous aviez la moindre connaissance de la loi anglaise, vous sauriez qu'existe une déclaration qui veut que l'ignorance de la loi ne soit pas une excuse ; et, de ce fait, si vous enfreignez une loi en Angleterre et prétendez ignorer l'existence d'une telle loi — eh bien, vous êtes bel et bien jugé coupable, étant censé ne pas ignorer l'existence d'une telle loi. Et je vous prierai de ne pas être agressif avec moi, car je suis un de ceux qui tiennent votre destinée entre leurs mains, et si vous faites par trop d'opposition, alors nous pouvons rendre vos conditions très dures. Prenez garde et contrôlez votre arrogance.
Cinquante-Trois frissonna ; le ton sur lequel on venait de lui parler prouvait qu'il n'était pas en position de force.
— Mais, sir, dit-il, que dois-je faire quand les termes employés par vous n'ont aucun sens pour moi ? Qu'est-ce, par exemple, que le Sur-Moi ?
— On vous éclairera plus tard sur ce terme, dit l'interrogateur. Il suffira, pour l'instant, que vous sachiez que votre Sur-Moi est ce à quoi vous faites référence quand vous parlez de votre âme éternelle, de votre âme immortelle ; et vous n'êtes maintenant qu'un pantin, ou une extension de ce Sur-Moi, presque comme un pseudopode — une extension de votre Sur-Moi matérialisé, afin de vous permettre d'apprendre par la dure expérience physique ce que ne peut obtenir le Sur-Moi infiniment plus subtil.
Le pauvre Cinquante-Trois eut l'impression que sa tête éclatait. Il n'avait pas compris un mot de tout cela, mais étant donné qu'on devait l'éclairer un peu plus tard sur toutes ces choses, il avait avantage à se contenter d'écouter. Et, d'un signe de tête, il répondit à l'interrogateur qui le fixait les sourcils levés.
Ce dernier, qu'il serait peut-être préférable d'appeler un conseiller, regarda ses papiers et dit à Cinquante-Trois :
— Vous devez retourner sur Terre comme un enfant de gens pauvres, de parents sans statut social, parce que le rôle que vous avez été appelé à jouer dans votre précédente existence semble avoir considérablement faussé votre compréhension et vos perceptions, et vous vous placez dans une classe à laquelle vous n'avez pas droit. Nous suggérons — et c'est votre droit de refuser — que vous naissiez à Londres dans le secteur de Tower Hamlets. Il y a, près de Wapping High Street, de futurs parents très convenables. Vous aurez l'avantage de naître tout près de la Tour de Londres et près des célèbres docks, zone de pauvreté écrasante et de souffrance. Là, si vous êtes d'accord, et si vous avez la force mentale et morale, vous pourrez commencer à travailler au développement qui fera de vous un médecin ou un chirurgien ; et en sauvant les vies autour de vous, vous pourrez expier vos fautes : les morts dont vous êtes responsable. Mais vous devrez vous décider rapidement car ces femmes que nous avons choisies comme mères futures sont déjà enceintes, ce qui veut dire que nous n'avons pas de temps à perdre. Je vais vous montrer, dit-il, la zone où vous pourrez naître.
Se tournant, il fit un geste de la main vers le mur que Cinquante-Trois avait cru être en verre dépoli. Aussitôt la couleur apparut et il prit vie. Cinquante-Trois vit une zone de Londres qu’il ne connaissait que de façon indifférente : la Tamise, Southwark Bridge, London Bridge, et Tower Bridge apparurent sur l'écran. La Tour de Londres elle-même était visible sur un côté. Charmé, il regardait ces images parfaitement claires, et observait la circulation. Les voitures sans chevaux l'intriguaient tout particulièrement. Il en fit la remarque au conseiller qui lui répondit :
— Oh oui, ce mode de transport a presque disparu ; de grands changements se sont produits depuis que vous êtes ici, et vous savez que vous y avez passé pas mal de temps. Vous avez été inconscient pendant environ trois ans. Tout maintenant est motorisé — bus, camionnettes, voitures, etc. Les choses sont censées s'être améliorées, mais je regrette quant à moi de ne plus voir des chevaux passer dans les rues.
Cinquante-Trois se concentra de nouveau sur les images de Londres : Mint Street, Cable Street, Shadwell, East Smithfield, the Highway, Thomas More Street, St Catherines, Wapping High Street et Wapping Wall. Il fut interrompu par le conseiller qui lui disait :
— Nous avons cinq femmes enceintes. Je veux que vous choisissiez parmi toutes les zones qu'on vous a montrées, celle que vous préférez. Parmi ces cinq femmes, l'une est l'épouse d'un aubergiste ou, dirons-nous, d’un hôtelier, la seconde est l'épouse d'un marchand de fruits et légumes. La troisième, l'épouse d'un quincaillier. Quant à la quatrième, son époux est conducteur d'autobus, et la cinquième est concierge d'hôtel meublé. Vous êtes libre maintenant de faire votre choix et personne ne vous influencera. Je peux vous en soumettre la liste et vous aurez vingt-quatre heures pour réfléchir. Et si vous avez besoin d'un conseil, il vous suffira de le demander.
Cinquante-Trois retourna aux tableaux vivants, montrant les gens qui se déplaçaient ; il s'étonnait de la façon étrange dont les femmes étaient vêtues, admirait les voitures sans chevaux et s'émerveillait aussi en voyant la quantité de constructions en cours. Il se tourna alors vers le conseiller en disant :
— J'aimerais vous demander de me permettre de voir les cinq pères et les cinq mères parmi lesquels je dois sélectionner mes parents. J'aimerais les voir, voir leurs conditions de vie.
— Ah, mon ami, répondit le conseiller d'un ton de regret et secouant la tête tristement, c'est une requête que je dois vous refuser, car nous ne faisons jamais, jamais ce genre de choses. Nous ne pouvons que vous donner les détails et vous laisser faire votre choix. Si vous étiez autorisé à voir vos parents, ce serait une intrusion dans leur vie privée. Je suggère que vous regagniez maintenant votre Hôtel de Transit et réfléchissiez à la question.
Il se leva, s'inclina devant le docteur et devant Cinquante-Trois, ramassa ses papiers et sortit.
— Venez, maintenant, dit le docteur.
Cinquante-Trois le suivit à contrecœur. Ils refirent le chemin en sens inverse, accompagnés par le garde. Ils marchèrent le long de ce corridor qui semblait si interminable et qui, maintenant, paraissait plus interminable encore.
Se retrouvant enfin à l'extérieur, Cinquante-Trois prit une respiration profonde, reprenant vie et énergie.
Le garde les quitta pour rejoindre son poste. Le docteur et Cinquante-Trois se dirigèrent ensuite vers un bâtiment gris et banal que Cinquante-Trois avait vaguement remarqué sans s'y intéresser. Ils y pénétrèrent par la porte principale ; un homme était assis derrière un bureau.
— La troisième à gauche, dit-il, sans leur prêter plus d’intérêt.
La troisième à gauche était une chambre presque nue : un lit, une chaise et une table sur laquelle était posée une grande chemise de carton portant le numéro 53.
— Nous y sommes, dit le docteur. Vous avez maintenant vingt-quatre heures pour réfléchir et prendre votre décision. Ce délai écoulé, je reviendrai et nous pourrons voir ce qui peut être fait pour votre retour sur Terre. Au revoir !
Le docteur referma la porte derrière lui et laissa Cinquante-Trois qui, se tenant d’un air abattu au milieu de la chambre, feuilletait avec appréhension les pages contenues dans la chemise.
Jetant un regard noir à la porte, il se mit à arpenter la chambre les mains derrière le dos. Tête baissé, il marcha, et marcha, et marcha encore. Heure après heure il arpenta la pièce ; finalement fatigué de l’effort, il se laissa tomber sur une chaise en regardant d'un air buté à travers la fenêtre.
— Cinquante-Trois !, murmura-t-il. Comme un condamné, et pour avoir fait ce que je croyais être la seule chose à faire dans mon cas. Pourquoi vivre, quand on n'est ni homme ni femme ?
Prenant son visage entre ses mains et offrant l'image du malheur, il se prit à réfléchir. "Ou bien ai-je simplement pensé que je faisais la chose qui convenait ? Peut-être, après tout, y a-t-il, dans ce qu'ils disent, quelque chose de juste. Il est très probable que je me suis laissé aller à m'apitoyer sur moi-même ; mais ici je suis maintenant comme un condamné qui a un numéro, et je dois décider ce que je serai ensuite. Je ne sais pas ce que je vais être. Quelle importance cela a-t-il de toute façon ? Je finirai probablement par me retrouver ici encore une fois."
Il se leva brusquement, alla à la fenêtre et décida qu'il allait faire le tour du jardin. Il toucha la fenêtre et celle-ci s'ouvrit sans la moindre difficulté. Il s'apprêta à sortir, et ce fut comme l'impression d'entrer dans une couche mince et invisible de latex. Elle s'étira afin qu'il puisse passer sans se faire mal puis, à son grand étonnement, elle se contracta et elle le projeta gentiment dans la chambre. "Condamné, après tout, n'est-ce pas ?" se dit-il. Et il retourna à sa chaise.
Il resta assis pendant des heures, à penser et à méditer, mais incapable d'arriver à une décision. "J'avais cru qu'après la mort, j'irais au Ciel. Au fait, je ne pense pas que j'y avais le moins du monde songé. Je ne savais que penser. J'ai vu tant de gens mourir sans apercevoir jamais le moindre signe d'une âme quittant le corps ; aussi en ai-je conclu que toutes ces histoires de vie après la mort n'étaient que sottises." Ne pouvant tenir en place il se leva, recommença à aller et venir, se parlant inconsciemment à lui-même. "Je me souviens d'un soir, au mess, où nous discutions de ce problème, le Capitaine Broadbreeches avait donné son très net point de vue qu'après la mort il n'y avait plus rien. Il avait ajouté qu'ayant vu beaucoup mourir — hommes, femmes, enfants et chevaux, aucune âme, jamais, ne s'était élevée de ces cadavres pour s'envoler vers le ciel."
Puis Cinquante-Trois revit la vie telle qu'elle était en Angleterre au temps où il allait à l'école, et quand il était élève à l'école militaire. Il se revit jeune officier montant fièrement à bord d'un bateau pour s'en aller combattre les Hollandais. Il avait l'habitude de penser aux Boers comme étant des Hollandais, parce que c'était leur groupe ethnique d'origine. Mais, regardant en arrière, il se rendait compte que les Boers n'étaient que des fermiers luttant pour ce qu'ils croyaient être le droit de choisir leur propre style de vie, libre de la domination anglaise.
La porte s'ouvrit et un homme entra :
— Je suggère que vous essayiez de prendre un peu de repos. Vous ne faites que vous épuiser à piétiner ainsi. Vous aurez à subir dans quelques heures une expérience très traumatisante. Si vous êtes reposé, les choses, pour vous, n'en seront que plus faciles.
Se tournant vers lui d'un air courroucé et d'un ton de commandement militaire, Cinquante-Trois cria :
— Sortez ! (En haussant les épaules, l'homme se retira, et Cinquante-Trois se remit à ruminer et à marcher.)
"Qu'était-ce donc que cette histoire au sujet du Royaume des Cieux ? se demanda-t-il. Les prêtres parlaient toujours d'autres demeures, d'autres plans d'existence, d'autres formes de vie. Je me souviens du Père nous disant qu'avant la venue du Christianisme sur la Terre, chaque être était condamné à la damnation et aux tourments éternels et que seuls les Catholiques Romains iraient au ciel. Je m'interroge et me demande depuis combien de temps le monde a existé, et pourquoi tous ces gens d'avant le Christianisme devaient tous être damnés, vu qu'ils ne savaient pas qu'il leur fallait être sauvés ?" Et il marchait, marchait toujours à travers la chambre en un va-et-vient continuel. S'il avait été sur un tapis roulant, pensa-t-il, il aurait déjà parcouru un bon nombre de milles (km) en augmentant le pas, ce qui au moins l'aurait fatigué davantage que de marcher de long en large à travers la chambre.
Irrité et frustré, il se jeta sur son lit. Cette fois aucune obscurité ne descendit ; il resta là simplement, empli de haine et d'amertume, et de chaudes larmes salées jaillirent de ses yeux. Furieusement, il essaya de les balayer d'un revers de main, puis il enfouit son visage dans l'oreiller et pleura longuement.
Après ce qui semblait être une éternité, il y eut à la porte un coup discret qu'il ignora. On frappa de nouveau et de nouveau il ne broncha pas. Quelques secondes s'écoulèrent, puis la porte s'ouvrit doucement. C'était le docteur. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et demanda :
— Êtes-vous prêt ? Les vingt-quatre heures sont écoulées.
Cinquante-Trois avança léthargiquement une jambe au bord du lit, puis l'autre, et s'assit lentement.
— Avez-vous choisi dans quelle famille vous voulez aller ? demanda le docteur.
— Du diable, si j'y ai pensé !
— Ah ! Je vois que vous lutterez jusqu'au bout, hein ? C'est sans importance en ce qui nous concerne, bien que vous ne le croirez peut-être pas. Nous essayons sincèrement de vous aider et si, par vos atermoiements, vous laissez passer cette chance, vous découvrirez que les occasions se raréfient et que les familles, elles aussi, se font rares.
— Vous avez là le choix entre cinq familles, dit-il en feuilletant négligemment la chemise marquée 53. Certains n'ont droit à aucun choix et sont simplement directement renvoyés. Laissez-moi vous dire quelque chose. (Il se cala sur sa chaise, croisa les jambes et ayant fixé Cinquante-Trois d'un air sévère, il lui dit :) Vous êtes comme un enfant gâté qui se laisse aller à ses colères puériles. Vous avez commis un crime, vous avez gâché votre vie et vous devez maintenant payer pour cela, et nous essayons de faire en sorte que ce soit dans les meilleures conditions possibles. Mais si vous vous refusez à coopérer et continuez à vous conduire comme un bébé gâté, vous arriverez à un moment où vous n'aurez plus le choix. Vous pouvez fort bien vous retrouver l'enfant d'une pauvre famille noire déshéritée de Mombasa, ou être envoyé en tant qu'enfant du sexe féminin dans une famille de Calcutta. Les filles là-bas n'ont pas grande valeur ; les gens veulent des garçons, car ils peuvent aider la famille ; et une enfant du sexe féminin risque d'être vendue pour la prostitution, ou d'être réduite à des conditions de véritable esclavage.
Cinquante-Trois s'était assis sur le bord du lit, ses mains agrippant le matelas, la bouche grande ouverte, les yeux fixes tels ceux d'un animal sauvage qu'on viendrait de capturer et de mettre en cage. Le docteur le regarda, mais Cinquante-Trois ne parut pas le reconnaître ou entendre ses remarques.
— Si vous persistez dans votre attitude récalcitrante et stupide et rendez notre tâche beaucoup plus difficile, en dernier recours nous pourrions alors choisir de vous expédier dans une île entièrement peuplée de lépreux. Vous devez vivre les trente années que vous avez voulu éviter de vivre, il n'y a pas d'autre issue, il n'y a aucun moyen de passer à côté, c'est la Loi de la Nature. Aussi vous feriez mieux d'entendre raison.
Voyant l'état presque catatonique de Cinquante-Trois, le docteur se leva et le gifla. L'autre bondit, furieux, puis s'effondra.
— Que PUIS-je faire ? dit-il, on me renvoie sur Terre pour y vivre la forme de vie la plus inférieure. J'ai été habitué à avoir un rang social.
L'air accablé, le docteur alla s'asseoir sur le lit à côté de Cinquante-Trois et lui parla.
— Savez-vous, mon garçon, que vous faites une grave erreur. Supposons que vous soyez sur Terre actuellement, appartenant au milieu théâtral. Imaginez qu'on vous ait offert le rôle du Roi Lear, ou celui d'Hamlet, ou quelque autre personnage semblable. Vous sauteriez très probablement sur une telle chance. Mais la représentation terminée, les spectateurs partis, le producteur ayant décidé de son prochain spectacle, insisteriez-vous sur le fait que vous avez tenu le rôle du Roi Lear, d'Othello, ou d'Hamlet ? Si l'on vous proposait, par exemple, d'être le Bossu de Notre-Dame, ou Falstaff, ou quelqu'un de moindre statut, diriez-vous que de tels rôles sont indignes d'un acteur qui a été Hamlet ou le Roi Lear ?
Le docteur se tut. Cinquante-Trois, assis sur le lit, grattait le sol — le tapis — avec le pied d'un geste oisif, puis répliqua :
— Mais ceci n'est pas une pièce de théâtre ; je vivais sur Terre, j'appartenais à la haute société, et vous voulez maintenant que je sois — qu'était-ce donc ? — le fils d'un aubergiste, d'un conducteur d'autobus, ou autre chose semblable !
Le docteur soupira et lui dit :
— Vous étiez sur la Terre pour y jouer un rôle. Avant d'y aller, vous avez choisi les conditions qui vous semblaient celles susceptibles de vous permettre d'être un acteur qui réussit. Or, vous avez échoué. L'acte était un fiasco, aussi votre retour sera accompagné de conditions différentes. Vous avez un choix entre cinq propositions. Certains n'ont pas ce choix. Venez, ajouta-t-il, nous avons déjà perdu trop de temps et le Conseil doit s'impatienter. Suivez-moi.
Il se dirigea vers la porte et brusquement revint à la table prendre le dossier marqué 53. Le plaçant sous son bras gauche, de sa main droite il saisit Cinquante-Trois par le bras, le secoua avec rudesse en disant :
— Venez. Soyez un homme. Vous ne pouvez chasser de votre pensée l'idée de votre importance au temps où vous étiez officier. Un officier et un gentleman ne se comportent certainement pas comme ce lâche larmoyant que vous êtes devenu.
Maussade, Cinquante-Trois se leva et ils quittèrent la chambre. Un homme à cet instant avançait dans leur direction.
— Oh ! dit-il, je venais pour voir ce qui était arrivé. Je pensais que notre ami était peut-être si affligé qu'il ne pouvait sortir du lit.
— Patience, ami, patience, reprit le docteur. Un cas comme celui-ci demande que nous soyons tolérants.
Les trois hommes suivirent le corridor, prirent de nouveau le long tunnel, passèrent devant les gardes qui, cette fois, se contentèrent de les examiner, et ils arrivèrent à la porte.
— Entrez, dit la voix. Cette fois, il y avait le vieil homme aux cheveux gris assis au bout de la table et, de chaque côté, se tenaient deux autres personnes, un homme et une femme en long sarreau vert. Tous les trois se tournèrent pour regarder entrer Cinquante-Trois.
— Alors, avez-vous décidé qui vous seriez ? demanda l'homme en bout de table, haussant les sourcils.
Le docteur poussa du coude son compagnon en lui murmurant :
— Parlez, ne voyez-vous pas qu'ils sont en train de perdre patience ?
L'air renfrogné, Cinquante-Trois s'avança et sans y être invité s'affala sur une chaise.
— Non, dit-il, comment le pourrais-je ? Je ne sais presque rien de ces gens. Je n'ai pas la moindre idée des conditions qui m'attendent. Je sais seulement qu'un aubergiste me semble détestable — un quincaillier plus encore peut-être. J'ignore de tels gens, ne les ayant jamais rencontrés dans ma vie sociale. Peut-être que vous, sir, avec votre expérience indiscutable, seriez en mesure de me donner un conseil.
Cinquante-Trois lança un regard insolent à l'homme en bout de table, mais celui-ci se contenta de sourire d'un air indulgent en lui disant :
— Vous avez un esprit de caste très excessif et je conviens, avec vous, que la respectable activité qu'est celle d'un aubergiste ou d'un quincaillier serait plus que n'en peut accepter votre subconscient. Toutefois je pourrais vous recommander fortement cette auberge célèbre de Cable Street ; mais pour quelqu'un de snob comme vous, je suggérerai plutôt la famille de l'épicier. L'homme se nomme Martin Bond et sa femme, Mary. Elle est sur le point d'accoucher et si vous devez occuper son corps en tant qu'enfant à naître, vous n'avez pas une minute à perdre, il vous faut reprendre vos esprits et décider, car vous seul pouvez le faire.
"Un épicier ! pensa Cinquante-Trois. Pommes de terre moisies, oignons puants, tomates trop mûres. Pouah ! Comment ai-je pu me mettre dans un pétrin pareil ?" Se grattant la tête, il se tortillait misérablement sur sa chaise. Autour de lui, les autres faisaient silence, conscients de ce qu'il y avait de désespérant dans le fait de devoir prendre une telle décision. Levant la tête, Cinquante-Trois dit enfin sur un ton de défi :
— C'est bien, je choisis l'épicier. Peut-être découvriront-ils que je suis l'homme ‘le mieux’ qu'ils aient jamais eu dans leur famille !
La femme assise sur le côté de la table dit alors :
— Sir, je pense que nous devrions procéder à un examen afin de voir s'il est encore compatible avec la mère. Ce serait, pour elle, un coup très rude si après tout ce qu'elle a enduré elle donnait naissance à un bébé mort-né.
L'homme assis de l'autre côté acquiesça et se tourna vers Cinquante-Trois.
— Si l'enfant est mort-né, cela n'aidera pas à votre problème, lui dit-il, car vous serez ramené ici du fait que votre manque de coopération et votre intransigeance auront provoqué, pour cette femme, la perte de son enfant. Je suggère — et ceci dans votre seul intérêt — que vous nous aidiez, que vous essayiez d'être plus calme, plus coopératif, sinon il nous faudra vous expédier n'importe où, comme on le fait des choses jetées au rebut.
— Venez avec moi, dit la femme après un instant d'hésitation. Le vieil homme acquiesça d'un geste de la tête et se leva lui aussi.
— Suivez-nous, dit le docteur à Cinquante-Trois, l'heure a sonné.
Tel un homme qui sentirait approcher l'exécution, il se leva d'un air apathique et suivit la femme dans une petite pièce adjacente. Tout ici était différent. Les murs donnaient l'impression d'être faits de lumières tremblantes derrière des verres dépolis. Il y avait partout des boutons et des commutateurs. Pendant un moment, il se crut dans une centrale électrique ; mais en face de lui, il vit une table d'une forme inhabituelle, d'une forme absolument inhabituelle. On aurait dit le contour d'un corps humain : bras, jambes, tête et tout.
— Installez-vous sur cette table, dit alors la femme.
Cinquante-Trois hésita un instant, puis en haussant les épaules il grimpa sur la table, écartant avec brusquerie la main du docteur qui, aimablement, cherchait à l'aider. Étendu sur la table, une étrange sensation s'empara de lui ; la table semblait se mouler à son corps. Sensation exquise de confort qu'il n'avait jamais encore éprouvée. La table était chaude. Levant les yeux, il découvrit que sa vue s'était troublée. Faiblement, indistinctement, il pouvait discerner des formes sur le mur en face de lui. Vaguement et étrangement indifférent, il regarda le mur et pensa pouvoir distinguer une forme humaine, apparemment féminine. Il lui sembla qu'elle était dans un lit ; l'observant avec des yeux mornes, il eut l'impression que quelqu'un rejetait les draps en arrière.
Une voix déformée lui parvint :
— Tout semble aller bien. Il est compatible.
C'était vraiment très, très étrange. Il ressentait comme une impression d'être ‘anesthésié’. Il n'y avait aucune lutte, aucune appréhension, il n'y avait même pas de pensées claires. Au lieu de cela, il reposait sur cette table qui épousait sa forme, il gisait là et regardait sans comprendre les gens qu'il avait si bien connus : le docteur, le chairman, la femme.
Il eut vaguement conscience qu'on parlait : ‘Fréquence de base compatible.’ ‘Inversion de température.’ ‘Une période de synchronisation et de stabilisation.’ Il eut un sourire somnolent ; le monde du purgatoire s'évanouit et il ne sut plus rien de ce monde.
Il y eut un long silence retentissant, un silence qui n'en était pas un, un silence au cours duquel il sentait des vibrations qu'il ne pouvait entendre. Et soudain, ce fut comme s'il était projeté dans une aube dorée — une véritable gloire. Il semblait se tenir à demi conscient dans une campagne radieuse. De grandes flèches et des tours se dressaient au loin et il était entouré de gens. Il eut l'impression qu'une très belle Forme venait à lui en lui disant : "Aie du courage, mon fils, car tu retournes dans un monde de misère. Ne te laisse pas abattre, car nous resterons en contact avec toi. Souviens-toi que tu n'es jamais seul, jamais oublié, et si tu fais ce que te dicte ta conscience intime, il ne t'arrivera aucun mal, mais seulement ce qui a été ordonné — et une fois achevé avec succès ton temps dans le Monde de Misère, tu nous reviendras triomphant. Sois calme, sois en paix."
La Forme s'éloigna et Cinquante-Trois se retourna sur l'élément — table ou lit ? — où il reposait et sombra paisiblement dans le sommeil. Et tout ce qui s'était produit avait disparu de sa conscience.
Chapitre Six
Algernon s'agita violemment dans son sommeil. Algernon ? Cinquante-Trois ? Peu importe que ce fût l'un ou l'autre. Ce n'était pas dans le sommeil qu'il était plongé, mais bien dans le cauchemar le plus affreux qu'il ait jamais vécu. Il songea au tremblement de terre qui s'était produit à Salonique, près de Messine (Sicile, Italie — NdT), où les édifices s'étaient écroulés et où la terre s'était ouverte en engloutissant les gens, puis s'était refermée sur eux.
Ceci était épouvantable — épouvantable. C'était la pire chose qu'il ait jamais connue, la pire chose qu'il ait jamais imaginée. Il se sentait écrasé, écrabouillé. Pendant un moment, dans son état confus de cauchemar, il s'imagina avoir été attaqué au Congo par un boa constricteur qui essayait de le déglutir et de le faire passer au travers de sa gorge.
Le monde entier lui paraissait à l'envers. Tout semblait trembler. Il y avait de la douleur, des convulsions, il se sentait pulvérisé, terrifié.
De loin, un cri étouffé lui parvint, comme un cri entendu à travers de l'eau et un épais emmaillotement. À peine conscient dans sa douleur, il perçut : "Martin, Martin, demande vite un taxi. Le travail a commencé !"
‘Martin ? Martin ?’ Il avait le sentiment vague, très vague, d'avoir déjà entendu ce nom quelque part, mais non, malgré tous ses efforts il ne parvenait pas à se remémorer ce que le nom signifiait ou à qui il appartenait.
Les conditions étaient tout simplement effrayantes. La sensation d'écrasement continuait, en même temps que lui parvenait un horrible gargouillement de liquides. Il crut, pendant quelques instants, être tombé dans un égout. La température s'élevait et l'expérience était vraiment bouleversante.
Soudainement, violemment, il fut renversé et il eut conscience d'une souffrance terrible à la base du cou. Il y eut une sensation particulière de mouvement, quelque chose qu'il n'avait jamais vécu auparavant. Il sentit qu'il suffoquait comme s'il était immergé dans un liquide, mais ce n'est pas possible, pensa-t-il. Un homme ne peut pas vivre dans un fluide, pas depuis que nous avons émergé de la mer.
Secousses et bousculades continuèrent encore pendant un temps ; puis il y eut un dernier à-coup et une voix très assourdie gronda : "Attention, l'ami ! Doucement ! Vous voulez qu'elle l'ait là, dans le taxi ?" Une sorte de grognement répondit, mais tout cela affreusement assourdi. Algernon était convaincu d'avoir perdu l'esprit ; tout lui semblait n'avoir aucun sens, ne sachant où il était, ni ce qui lui arrivait. Il est vrai que, dernièrement, il avait vécu des choses absolument terribles qui ne lui permettaient plus d'agir comme un être rationnel. De vagues souvenirs flottaient dans sa conscience. Quelque chose concernant un couteau, ou était-ce un rasoir ?... Quelque part. Une chose effroyable que cet incident ! Rêvant qu'il s'était tranché la tête, et se regardant ensuite, alors qu'il était suspendu près du plafond, regardant son propre cadavre étendu sur le sol. Ridicule, complètement absurde, bien sûr, mais... et qu'était-ce donc que cet autre cauchemar ? Qu'en était-il de lui maintenant ? Il semblait être quelque chose comme un condamné, accusé d'un certain crime dont il ne comprenait pas du tout de quoi il s'agissait. Le pauvre garçon avait presque perdu l'esprit, de confusion, de détresse, et d'appréhension craintive d'une condamnation imminente.
Le chambardement continuait. "Doucement maintenant, doucement, j'ai dit, aidez-nous, voulez-vous." Tout était si lointain, si irréel, et les voix étaient si rudes, que cela lui rappela un marchand ambulant entendu un jour, dans une des petites rues de Bermondsey à Londres. Mais qu'avait à faire cette rue avec lui, et, de toute façon, où était-il ? Il chercha à se frotter les yeux, mais découvrit, à sa grande horreur, qu'une sorte de câble l'encerclait. De nouveau, il pensa qu'il devait être dans l'astral inférieur, vu l'absence de liberté de ses mouvements — l'idée était vraiment trop terrible à contempler. Il avait l'impression d'être dans une masse d'eau. Auparavant, il lui avait semblé être dans une substance gluante, quand il était dans l'astral inférieur — ou s'agissait-il de l'astral inférieur ? Avec hébétude, il essaya de forcer son esprit à remonter les sentiers de la mémoire. Mais non, rien n'était dans l'ordre, rien ne se présentait clairement.
"Oh Dieu ! pensa-t-il, inquiet, j'ai dû devenir fou et être enfermé dans un asile. Je dois avoir de bien réels cauchemars. Ceci ne peut tout simplement pas arriver à qui que ce soit. Comment un être, membre comme moi d'une vieille famille respectée, a-t-il pu en venir là ? Nous avons toujours été admirés pour notre sang-froid et notre équilibre mental. Oh Dieu ! Que m'est-il donc arrivé ?"
Il y eut une soudaine secousse, quelque chose de totalement inexplicable, une soudaine secousse, et alors les douleurs reprirent. Vaguement, il eut conscience que quelqu'un criait. Normalement, songeait-il, il aurait dû s'agir d'un cri aigu, mais tout était maintenant assourdi, tout était incroyablement étrange, rien ne faisait plus aucun sens. Étendu sur le dos quelques minutes auparavant, il était maintenant sur le visage, et une soudaine convulsion de ‘quelque chose’ le fit tournoyer et se retrouver sur le dos, frémissant de toutes les fibres de son être, tremblant d'épouvante.
"Je tremble ? se demanda-t-il horrifié. Comment moi, un officier et un gentilhomme, puis-je avoir peur au point d'en perdre la raison ? De quelle affliction ai-je été frappé ? Je crains de ne pas y survivre !"
Malgré tous ses efforts pour essayer de comprendre ce qui lui était arrivé, ce qui lui arrivait, il ne parvenait qu'à d'improbables sensations confuses — celles d'être devant un Conseil, quelque chose comme d'avoir à décider ce qu'il allait devenir. Et puis, il y avait eu cette table où on l'avait fait s'étendre... Non, c'était inutile, son esprit se refusait à aller plus loin.
Un autre mouvement violent. À nouveau il eut la conviction qu'il se trouvait dans les replis d'un boa s'apprêtant à le digérer. Il ne pouvait cependant rien y faire. Sa terreur était à son comble. Plus rien n'allait. Tout d'abord, comment avait-il été saisi par ce boa, et que ferait-il en un lieu où existaient de telles créatures ? Tout ceci le dépassait.
Un terrible hurlement mal étouffé par son environnement secoua tout son être. Puis il y eut une violente torsion, un déchirement, et il crut qu'on venait de lui arracher la tête. "Oh, mon Dieu ! pensa-t-il. Ainsi, c'est VRAI. Je me suis coupé la gorge et ma tête vient de tomber. Oh Dieu ! Que vais-je faire ?"
Un jaillissement d'eau d'une soudaineté terrifiante, et il se trouva déposé sur quelque chose de souple. Il suffoquait et se débattait, avec, lui semblait-il, une couverture chaude sur le visage ; puis, horrifié, il sentit des pulsations, des pulsations, des pulsations, d'impérieuses incitations le forçaient à travers quelque étroit canal, collant, moulant, et quelque chose — il lui sembla que c'était un cordon fixé autour de sa taille — essayait de le retenir. Il pouvait sentir qu'il s'enroulait autour d'un de ses pieds ; il se débattit pour se libérer, car il suffoquait dans cette humidité obscure. Il frappa à nouveau avec le pied et un hurlement sauvage, plus sonore, cette fois, éclata de quelque part au-dessus de lui et derrière lui. Une autre terrible convulsion suivit et il fut projeté hors de l'obscurité, dans une lumière si éclatante qu'il se crut aveuglé. Il était incapable de voir, mais de l'environnement chaud dans lequel il avait été, on le précipitait maintenant sur quelque chose de froid et de rugueux. Le froid lui sembla pénétrer ses os et il frissonna. Il découvrit, étonné, qu'il était tout trempé, et ‘quelque chose’ alors le saisit par les chevilles et le souleva, tête en bas.
Deux claques sévères sur son derrière, et il ouvrit la bouche pour protester contre l'indignité, contre l'outrage infligé au corps d'un officier et d'un gentleman. Et avec ce premier cri de rage, tout souvenir du passé le quitta, comme s'évanouit le rêve à l'aube du jour nouveau. Un bébé était né.
Tous les bébés, bien sûr, ne connaissent pas de telles expériences, vu qu'un bébé n'est normalement qu'une masse inconsciente de protoplasme jusqu'à la naissance, et ce n'est qu'après la naissance que la conscience lui vient. Mais, dans le cas d'Algernon, ou de Cinquante-Trois — comme il vous plaira de l'appeler — le problème était assez différent, car il avait été un suicidé et, en vérité, un ‘cas’ très difficile, et à cela s'ajoutait un autre facteur : cette personne — cette entité — devait revenir avec, dans l'esprit, un objectif particulier ; il lui fallait se destiner à une profession spéciale, et la connaissance de ce qu'était cette vocation devait être transmise à partir du monde astral par l'intermédiaire du bébé à naître et de là directement au moule mental du nouveau-né.
Pour un temps, le bébé resta étendu. Le cordon fut coupé, mais il était indifférent à tout ce qui se passait. Algernon s'en était allé. Il y avait là, maintenant, un bébé sans nom. Après quelques jours passés à l'hôpital, des formes vagues allaient et venaient devant la vision indécise du bébé.
— Tiens, dit une voix, assez fruste, petit diable d'avorton, hein ? Comment vas-tu l'appeler, Mary ?
La mère, regardant tendrement son premier bébé, leva les yeux et sourit au visiteur.
— Je pense que nous l'appellerons Alan. Tu te souviens, nous avions décidé que si c'était une fille elle s'appellerait Alice, et si c'était un garçon, ce serait Alan.
Quelques jours plus tard, Martin revenait voir sa femme et tous deux quittaient l'hôpital emportant avec eux le petit paquet qui commençait une nouvelle vie sur Terre — une vie dont ils ignoraient tous deux qu'elle était destinée à se terminer trente ans plus tard. Le bébé fut amené à la maison située dans un quartier assez convenable de la ville, non loin de la Tamise, où les navires, à grand renfort de sirènes, annonçaient leur arrivée ou leur départ pour un voyage qui les emmenait peut-être à l'autre bout du monde. Et dans cette petite maison, non loin de Wapping Steps, un bébé dormait dans une chambre au-dessus de la boutique où il allait, plus tard, laver des pommes de terre, jeter les mauvais fruits et enlever les feuilles pourries des choux. Mais pour le moment, le bébé devait se reposer, grandir un peu et apprendre un mode de vie différent.
Le temps avait passé, comme il se devait — personne ne l'a jamais vu s'arrêter ! — et le petit garçon avait atteint sa quatrième année. En ce dimanche après-midi beau et chaud, il était assis sur les genoux de grand-papa Bond, quand celui-ci se pencha vers lui, en demandant :
— Alors, petit, que vas-tu faire quand tu seras grand ?
Le petit garçon marmonna quelque chose pour lui-même, examina attentivement ses doigts et répondit dans son parler enfantin :
— Docteuh, docteuh.
Puis, glissant des genoux de son grand-père, il se sauva d'un air embarrassé.
— C'est drôle, vous savez, grand-père, dit Mary, cet enfant a l'air de se passionner pour tout ce qui touche la médecine. Et pourtant il n'a que quatre ans. Quand le docteur vient, par exemple, il faut absolument qu'il s'intéresse à ce tube qu'il se met autour du cou.
— Le stéthoscope, dit grand-papa.
— Oui, c'est le nom. Je ne peux vraiment pas comprendre. C'est comme une idée fixe chez cet enfant. Mais penser à devenir docteur, dans notre situation ?
Le temps continuait sa marche en avant, et Alan avait maintenant dix ans. Il travaillait très dur à l'école. Comme l'avait dit un maître à Mrs Bond :
— Cet enfant est extraordinaire ; ce n'est presque pas normal pour un enfant de son âge d'étudier comme il le fait. Il ne veut parler que de médecine et de choses la concernant. C'est presque une tragédie car — ne voyez pas d'offense à ce que je vais dire — comment peut-il espérer être un jour docteur ?
Mary Bond n'avait cessé d'y penser ; elle y songeait dans le long silence des nuits, interrompu seulement par le bruit de la circulation et le mugissement des sirènes sur la Tamise — bruits qu'elle finissait par ne plus entendre. Ne cessant d'y penser, elle en parla avec une voisine. Celle-ci lui répondit :
— Vous savez, Mary, qu'il existe maintenant la possibilité de faire assurer un enfant — à condition que la mère soit assez jeune quand elle le met au monde. Vous payez telle somme par semaine et, à un certain âge, le garçon dispose d'une jolie somme qui lui permettra de payer ses études. Je sais que cet arrangement existe ; je connais un garçon qui, grâce à cela, a pu devenir avocat. Je vais dire à Bob Miller d'aller vous voir ; il est au courant de toutes ces polices d'assurance.
Et la voisine s'en fut, pleine de bonnes intentions concernant l'avenir d'Alan.
Puis ce fut l'entrée à l'école secondaire. Le Directeur le questionna dès le premier jour sur ses projets.
— Alors, mon garçon, que vous proposez-vous de faire quand vous quitterez l'école ?
— Je serai docteur, sir, répondit Alan Bond d'un air assuré en regardant le Directeur droit dans les yeux.
— Eh bien, mon garçon, il n'y a aucun mal à avoir de telles ambitions ; mais ceci demandera de dures et longues études. En outre, il vous faudra obtenir des bourses, car la situation de vos parents ne leur permettra pas de vous mener jusqu'au bout des études médicales et de subvenir, en même temps, à toutes les dépenses qu'elles impliquent. Je vous suggère d'essayer d'avoir une autre corde à votre arc, au cas où...
— Oh, nom d'un chien ! dit Martin Bond, ne peux-tu pas poser ce diable de livre pendant une minute ? Ne t'ai-je pas dit de nettoyer ces pommes de terre ? Nous finirons par perdre la clientèle de Mrs Potter si on lui vend des pommes de terre couvertes de terre. Pose ton livre, j'ai dit, et occupe-toi de ces pommes de terre. Je veux qu'elles soient impeccables, et quand tu auras fini, tu iras les livrer à Mrs Potter. (Le père d'Alan, au comble de l'exaspération, marmonnait : Pourquoi diable, faut-il que les enfants maintenant aient des idées au-dessus de leurs moyens ! Il ne pense qu'à une chose, à être docteur. Où diable croit-il que je vais trouver l'argent pour payer les études ?)
Et pourtant, continua-t-il en pensée, à l'école ils disent que c'est un crack — le premier pour ce qui est de l'intelligence. Oui, c'est un bûcheur... Il essaye d'avoir une bourse. Peut-être que j'ai été un peu dur avec lui. Comment étudier convenablement quand je l'interromps pour lui ordonner de nettoyer les pommes de terre ? Je vais lui donner un coup de main.
Le père Bond trouva son fils assis sur un tabouret devant un grand bassin. Tenant un livre de la main gauche, il tâtait de sa main droite pour prendre une pomme de terre qu'il se contentait de lâcher dans l'eau, en la frottant un peu, pour la jeter ensuite sur un journal.
— Je vais t'aider, mon garçon, comme ça nous irons plus vite, et tu pourras reprendre ton livre après avoir fait la livraison. Ce n'est pas pour être dur avec toi, mais tu sais que je dois gagner ma vie. J'ai des charges — toi, ta mère, et moi aussi. Et quand le loyer est payé, ce sont les impôts... Toujours quelque chose à payer et le gouvernement, lui, il ne s'occupe pas de savoir comment on se débrouille. Allez... laisse-moi t'aider.
Le trimestre scolaire s'achevait. Le Directeur et les maîtres étaient réunis, ainsi que le Conseil de Classe et, dans le Grand Hall, les enfants, vêtus de leurs habits du dimanche, étaient assis, l'air embarrassé. À côté d'eux, rendus nerveux par l'atmosphère qui leur était inhabituelle, se tenaient les parents et les familles. De temps à autre, un homme assoiffé allait à la fenêtre, guignant d'un œil plein d'envie le pub voisin. Mais aujourd'hui était le Jour des Prix, le Jour des Discours, et il se devait de rester. "Bah ! se dit l'un d'eux, après tout, je ne suis tenu de venir ici qu'une fois l'an, mais pour ces moutards, c'est tous les jours !"
Le Directeur se leva et, ayant soigneusement ajusté ses lunettes sur son nez, il s'éclaircit la gorge, puis regarda l'assemblée.
— J'ai le très grand plaisir, dit-il de son ton professionnel, de vous annoncer qu'Alan Bond a fait d'incroyables progrès durant cette dernière année. Il fait honneur à nos méthodes d'enseignement, et c'est pour moi un immense plaisir que de vous apprendre qu'on lui a accordé une bourse d'études à l'école préparatoire de médecine de St Maggots. (Il s'arrêta, attendant la fin des applaudissements, puis reprit :) Cette bourse est la première à avoir été accordée dans ce quartier. Je suis certain que tous, autant que vous êtes, vous lui souhaitez de réussir dans sa carrière, car depuis son entrée ici il n'a cessé d'affirmer qu'il serait Docteur en Médecine. Maintenant, il a sa chance.
Il fouilla dans les papiers posés sur le pupitre devant lui, et tous s'envolèrent en tombant sur le sol. Les maîtres s'empressèrent de les ramasser et de replacer les feuilles sur le pupitre, après les avoir soigneusement remises en ordre.
Puis ayant trouvé ce qu'il cherchait, le Directeur dit alors :
— Alan Bond, voulez-vous venir auprès de moi pour recevoir ce Diplôme et la Bourse dont l'attribution vient juste d'être confirmée.
— Ouais, je sais pas ! dit le père Bond, au moment où Alan lui montra les papiers en question, une fois rentrés à la maison. Il me semble, Alan, mon garçon, que tes idées sont bien au-dessus de notre situation sociale. Nous ne sommes que des marchands de légumes ; il n'y a jamais eu dans notre famille ni avocats ni médecins. Sais pas comment tu as eu cette drôle d'idée !
— Mais, père, s'écria désespérément Alan, je parle d'être médecin depuis que je suis en âge de proférer une parole : j'ai travaillé comme un esclave, passant tout mon temps à étudier, m'interdisant tout plaisir pour obtenir cette bourse. Et maintenant que je l'ai, tu soulèves encore des objections !
Mary Bond, elle, demeurait silencieuse. Seules ses mains nerveuses et tremblantes trahissaient la difficulté dans laquelle elle se trouvait. Le père et la mère ayant échangé un regard, le père dit alors :
— Nous n'avons pas l'intention, Alan, d'essayer de gâcher tes chances ; tu as là un papier ; mais qu'est-ce que ça veut dire, ce papier ? Que tes études seront gratuites... mais et tout le reste ? Livres, instruments, enfin tout le nécessaire ? (D'un air impuissant, il regarda son fils et reprit :) Tu sais, bien sûr, que tu pourras continuer à vivre avec nous sans avoir à nous payer une pension ; tu nous aideras un peu en rentrant de l'école. Mais le problème est que nous sommes incapables de faire face à de grosses dépenses. Tu sais que nous vivons au jour le jour, en joignant tout juste les deux bouts... réfléchis-y, fiston. Je pense, et ta mère aussi, que ce serait merveilleux que tu puisses être docteur ; mais, par contre, ce serait affreux d'être un piètre docteur parce que l'argent te manquait pour te permettre de continuer.
Mary Bond dit à son tour :
— Tu sais, Alan, ce qui arrive aux médecins qui échouent, n'est-ce pas ? Tu sais ce qui arrive aux médecins qui sont radiés ?
La regardant d'un air revêche, il répondit :
— Je ne sais qu'une chose, et c'est tout ce qu'on m'a dit pour chercher à me décourager... par exemple que si un étudiant en médecine échoue ou s'il est radié, la seule solution qui s'offre à lui c'est de devenir représentant pour une firme pharmaceutique miteuse. Mais je n'ai pas encore échoué, je n'ai même pas commencé. Si j'échoue, je devrais encore gagner ma vie, et si je peux le faire en tant que vendeur médical, eh bien, ce sera une perspective diablement plus agréable que celle de mettre des pommes de terre dans un sac, ou de peser des fruits, ou autres choses du même genre !
— Tais-toi, Alan, tais-toi, dit sa mère. Ne te moque pas du métier de ton père ; n'oublie pas que c'est lui qui t'entretient maintenant. Tu n'es pas respectueux et tu te montes la tête. Reviens sur terre, tu ferais bien. (Puis elle reprit, après un long et lourd silence :) Pourquoi ne pas prendre ce job que t'a proposé ton oncle Bert, dans une compagnie d'assurances ? C'est quelque chose de stable et, en travaillant, tu peux espérer monter très haut dans la profession. Penses-y, Alan, veux-tu ?
Sans dire un mot il sortit de la pièce, l'air morose. Ses parents se regardèrent, puis l'entendirent qui descendait l'escalier de bois. La porte de la rue se referma violemment et le bruit de ses pas sur la chaussée parvint jusqu'à eux.
— Sais vraiment pas où il a pris cette idée, dit Martin Bond. Je comprends pas comment on peut mettre au monde un tel gars ! Depuis qu'il est en âge de parler, il répète comme une litanie : ‘Je serai médecin.’ Pourquoi ne peut-il pas, comme les autres garçons, se tourner simplement vers un job convenable ? Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi diable il ne peut pas ?
Sa femme, les larmes aux yeux, s'évertuait à raccommoder des chaussettes qui n'étaient plus que des reprises ; finalement elle leva les yeux en disant :
— Oh, je ne sais pas, Martin, je pense parfois que nous sommes trop durs avec lui. C'est normal, après tout, d'avoir de l'ambition et il n'y a rien de si terrible dans l'idée d'être un docteur, tu ne crois pas ?
Martin répondit en grognant :
— Je sais pas... la bonne terre et ce qu'elle produit, ça me suffit. Jamais beaucoup apprécié l'idée de ces garçons tripotant les intérieurs d'une femme. Ça me semble pas bien ! Bon, je vais à la boutique ! Sur ce, il se leva avec colère et descendit furieusement l'escalier de service.
Mary abandonna son raccommodage et alla s'asseoir près de la fenêtre. Puis, comme si elle avait réfléchi, elle se leva, gagna sa chambre et s'agenouilla près du lit demandant à Dieu de l'aider. Sa prière achevée, elle se leva en reniflant et en se disant : "C'est drôle, tous les prêtres vous conseillent de prier quand on est dans l'ennui ; je le fais, mais jamais de ma vie mes prières n'ont été entendues. Je suppose que tout est superstition." Tout en continuant de renifler, elle quitta la chambre, se frotta les yeux avec son tablier, puis se mit à préparer le dîner.
Alan longeait le trottoir mélancoliquement, et négligemment, il donna un coup de pied dans une cannette qui était là devant lui. Par chance — était-ce bien la chance ? — il donna un coup de pied un peu fort et la cannette s'envola à un angle qui la fit heurter une plaque de métal, en tintant. Il jeta un regard coupable autour de lui et s'apprêtait à se sauver, quand il regarda la plaque en question : Dr R. Thompson, lut-il. Il se rapprocha de la plaque de métal, une plaque de cuivre avec des lettres de cire noire incisées, et demeura là à caresser cette plaque dans le mur, totalement perdu dans ses pensées.
— Que se passe-t-il, mon garçon ? demanda une voix pleine de gentillesse, tandis qu'une main se posait doucement sur son épaule.
Alan sursauta, se tourna et levant les yeux, il vit le visage souriant du docteur.
— Oh, je suis désolé, docteur Thompson. Je ne voulais rien faire de mal, dit Alan d'un air confus.
Le docteur se mit à rire en disant :
— Eh bien, en voilà un visage malheureux. De si gros soucis, vraiment ?
— Je suppose, répondit Alan d'un ton de profond découragement.
Le docteur, ayant jeté un coup d'œil sur sa montre, prit le garçon par les épaules en lui disant :
— Venez jeune homme. Qu'avez-vous fait ? Un enfant à une jeune fille ? Est-ce que son père est après vous ? Entrons, voyons ce que nous pouvons faire.
Il ouvrit la grille pour laisser entrer le jeune homme tout hésitant, et ils pénétrèrent dans le cabinet de consultation. Le docteur, ouvrant la porte, lança :
— Mrs Simmonds, ce serait une bonne idée que de nous préparer un plateau avec quelques-uns de ces excellents biscuits — si votre diable de mari a bien voulu en laisser quelques-uns.
Une voix répondit, venant des profondeurs de la maison. Le docteur s'absenta un instant puis revint en disant :
Tout va bien, mon garçon, soyez calme. Nous allons d'abord prendre un peu de thé, puis nous verrons le problème.
Bien vite, Mrs Simmonds apparaissait avec un plateau sur lequel elle avait posé deux tasses, un pot de lait, le sucre, une très belle théière d'argent et, bien sûr, l'inévitable pot contenant l'eau bouillante. Elle avait hésité, se demandant si elle devait se servir de la belle argenterie ; puis elle avait conclu que le docteur, certainement, recevait quelqu'un d'important. Sinon il n'aurait pas été à la maison à cette heure. Ainsi donc — la porcelaine de Chine et l'argenterie des grands jours, et son plus charmant sourire en entrant dans la pièce ; mais il s'évanouit bien vite. Ce n'était pas le lord ou l'important homme d'affaires de Londres qu'elle avait espéré, mais un pauvre écolier très maigre et paraissant extrêmement malheureux. Se disant que ce n'était pas son affaire, elle posa soigneusement le plateau devant le docteur et, troublée, fit un petit salut. Elle sortit en fermant la porte derrière elle.
— Comment prenez-vous votre thé ? demanda le docteur. Lait, d'abord, ou cela vous est-il, comme à moi, indifférent — dès l'instant qu'il est chaud et sucré ?
Alan se contenta d'incliner la tête. Il ne savait que dire, ou que faire, si absorbé dans son malheur, si écrasé par l'idée d'avoir à nouveau échoué. À nouveau... que voulait-il dire par là ? Il ne savait pas. Quelque chose se pressait à l'arrière de son esprit, quelque chose qu'il devait connaître — ou était-ce quelque chose, que, au contraire, il ne devait pas connaître. Il se frotta le front, au comble de la confusion.
— Qu'y a-t-il, mon garçon ? Vous n'êtes VRAIMENT pas bien, n'est-ce pas ? Prenez votre thé et grignotez quelques-uns de ces bons biscuits, puis dites-moi tout. J'ai le temps ; je suis censé ne pas travailler cet après-midi.
Le pauvre Alan n'était pas habitué à la gentillesse ni à la considération. Chez lui, dans le quartier, il était ‘le gars bizarre’, et, en parlant de lui, on disait ‘ce fils de l'épicier qui a de si grandes idées’. En cet instant, les mots du docteur lui allèrent droit au cœur et il éclata en sanglots. Le docteur le considéra avec un regard plein de tristesse.
— C'est bien, mon garçon, pleurez un bon coup... il n'y a rien de mal à pleurer. Libérez-vous, allez-y, pleurez tout votre saoul, il n'y a rien de mal à cela. Savez-vous que le vieux Churchill lui-même se laissait parfois aller à pleurer ? Alors, s'il le pouvait, vous le pouvez.
Honteux, Alan s'essuya le visage avec son mouchoir. Le docteur en remarqua la netteté ; de même il remarqua que ses mains étaient parfaitement propres et ses ongles soignés. Il monta de plusieurs degrés dans le jugement du docteur.
— Allons, mon garçon, buvez ceci, dit-il en plaçant une tasse de thé devant Alan. Remuez bien, car j'ai mis beaucoup de sucre. Le sucre donne de l'énergie. Allez, avalez-moi ça.
Il but son thé et, nerveusement, grignota un biscuit. Le docteur remplit de nouveau les tasses et en s'assoyant près d'Alan, il lui dit :
— Si vous en avez envie, mon garçon, laissez-vous aller et confiez-vous. Ce doit être quelque chose de terrible ; mais vous savez qu'un fardeau partagé n'est plus qu'un demi-fardeau.
Alan renifla, effaça quelques larmes restées sur son visage, puis tout sortit d'un coup. Le fait que dès le départ il avait toujours eu une impulsion des plus puissantes qu'il se devait d'être médecin, le fait que depuis qu'il avait été à même de composer une phrase, celle-ci avait été : ‘Moi être docteur’. Il confia au docteur Thompson qu'il avait toujours rejeté les choses puériles, passant tout son temps à étudier — et comment au lieu de lire, comme les autres garçons, des romans d'aventures ou de science-fiction, il recherchait toujours les livres techniques, à la grande consternation de la bibliothécaire qui trouvait malsain pour un jeune garçon de vouloir connaître à ce point l'anatomie.
— Mais, docteur, je n'y pouvais rien, je n'y pouvais vraiment rien, dit Alan, l'air désespéré. C'était quelque chose qui me dépassait, comme une force qui me poussait. Je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais c'est que j'ai toujours cette poussée, cette irrésistible poussée, que je dois devenir docteur, coûte que coûte, et ce soir mes parents me sont tombés sur le dos, me reprochant mes idées de grandeur, me reprochant d'être un mauvais fils.
Il retomba dans le silence. Posant la main sur l'épaule du garçon, le docteur dit avec douceur :
— Et qu'est-ce qui a provoqué cet éclat ce soir, dites-moi ?
S'agitant sur son siège, Alan répondit :
— Docteur, vous ne le croirez pas, mais je suis le premier de la classe, premier de l'école secondaire. C'était le dernier trimestre et le Directeur, Mr Hale, a annoncé que j'avais été recommandé pour une bourse spéciale à l'école de médecine de St Maggots, et mes parents...
Là il faillit craquer à nouveau et tortilla son mouchoir entre ses doigts.
— Ceci n'est pas nouveau, mon garçon. Les parents estiment toujours qu'ils ont le droit de contrôler l'avenir de ceux à qui ils ont donné le jour, parfois sans le souhaiter. Mais voyons tout de même... vous avez dit que vous étiez à l'école secondaire ? Et que le Directeur était Mr Hale ? Je connais très bien Mr Hale, c'est un de mes patients. Voyons ce qu'il peut nous dire.
Ayant trouvé le numéro de téléphone, il appela le Directeur.
— Bonsoir, Hale, ici Thompson. J'ai là devant moi un jeune garçon qui m'a l'air très brillant et qui m'a confié que vous l'aviez recommandé pour une bourse d'études spéciale... Oh ! Dieu, Hale, j'ai oublié de lui demander son nom !
— Je sais de qui vous parlez, répondit le Directeur, c'est Alan Bond, un garçon très brillant, exceptionnellement brillant. Il a travaillé comme un esclave au cours des quatre années passées ici, et j'ai d'abord cru qu'il ne serait pas à la hauteur : je ne me suis jamais autant trompé. Oui, c'est parfaitement vrai, il est le meilleur de l'école, il a les notes les plus élevées que nous ayons jamais eues et les progrès les plus importants que cette école ait jamais vus, mais... (la voix du Directeur s'évanouit sur la ligne, puis revint :) je suis navré pour ce garçon... ses parents... tout le problème, c'est eux. Ils ont une petite boutique de fruits et légumes et joignent les deux bouts avec difficulté, ce qui fait que je ne vois pas comment il va se débrouiller. Je voudrais pouvoir faire quelque chose pour l'aider. J'ai réussi à lui obtenir une bourse, mais il a besoin de plus que cela.
— Je vous remercie beaucoup, Hale, de vos informations. (Le docteur se tourna vers Alan.) Vous savez, mon petit, j'ai eu à peu près les mêmes difficultés, et j'ai dû livrer une lutte acharnée, me battre bec et ongles pour arriver. Bien, je vais vous dire ce que nous allons faire : nous allons dès maintenant voir vos parents. Je vous ai dit que c'est ma demi-journée de congé et quelle meilleure façon de la terminer que d'aider un pauvre diable qui a aussi des difficultés. Allez mon garçon, secouez-vous ! (Le docteur se leva et Alan fit de même. Après avoir sonné deux fois, il dit alors :) Oh, Mrs Simmonds, je m'absente pendant un moment. Soyez assez aimable de prendre les messages. Merci.
Ils descendirent la rue — la grande et massive silhouette du docteur et le garçon sous-alimenté qui faisait une approche tardive à l'âge adulte. En arrivant à la boutique, ils virent que la lumière était allumée. On voyait, à travers la fenêtre, le père Bond qui pesait des marchandises. Le docteur frappa à la porte d'un coup sec, et regarda à l'intérieur en mettant la main devant ses yeux afin d'éviter les reflets.
L'air revêche, le père Bond secoua la tête d'un geste négatif : ‘C'est fermé’. C'est alors qu'il vit son fils. "Dieu ! Qu'a-t-il bien pu faire ? Quelle bêtise ?" Inquiet, soudain, il courut ouvrir la porte. Le docteur et Alan entrèrent, et le père Bond se hâta de refermer la porte.
— Bonsoir, dit le docteur. Ainsi vous êtes Martin Bond. Je suis le Dr Thompson et mon cabinet est au bas de la rue. Vous me connaissez ? Je me suis entretenu avec votre fils, et je peux vous dire que c'est un garçon plein d'espoir, brillant. Je pense qu'il mérite qu'on lui donne sa chance.
— C'est facile pour vous, docteur, de parler ainsi, dit Martin Bond avec rudesse. Vous ne vous battez pas comme nous le faisons ici pour ramasser de quoi vivre. Vos honoraires et les Mutuelles vous permettent d'avoir une vie à l'abri des soucis. Mais là n'est pas le problème, qu'est-ce que ce garçon a encore fait ? demanda-t-il.
Le docteur, sans répondre, se tourna vers Alan :
— Vous m'avez dit avoir un diplôme spécial, de même qu'une lettre de Mr Hale... Voulez-vous me les montrer ?
Alan partit comme une flèche, grimpant les escaliers quatre à quatre.
— Bond, vous avez là un garçon brillant, qui est peut-être même un génie. J'ai parlé avec le Directeur de son école.
Furieux, Martin Bond se tourna vers lui avec fureur :
— Et qu'est-ce que ça a à voir avec vous ? De quoi VOUS mêlez-vous ? Vous tentez d'attirer des ennuis au garçon, ou quoi ? dit-il.
La colère apparut sur le visage du docteur, mais il parvint à se contrôler.
— Il arrive, Bond, que quelqu'un vienne sur cette Terre, apportant avec lui quelque chose d'une vie antérieure — je ne saurais dire ce que c'est — mais ces êtres ont des impulsions et des impressions très fortes, et ce n'est pas pour rien qu'ils les ont. Votre fils semble être de ceux-là. Son Directeur, qui le considère comme extrêmement brillant, a la conviction qu'il est né pour être médecin. Avant de penser que je l'induis en erreur, réfléchissez-y. Mon seul objectif est d'essayer de l'aider.
Alan reparut, essoufflé d'avoir couru. Avec humilité, il tendit au docteur le diplôme et la copie de la lettre du Directeur avec l'acceptation de sa recommandation par le Doyen de l'école médicale de St Maggots. Sans un mot, le docteur prit les papiers et les lut du début à la fin. Rien ne troublait le silence, à part le bruissement des feuilles au fur et à mesure qu'il passait d'une page à une autre. Puis, ayant terminé, il dit :
— Ceci, dit-il, achève de me convaincre. Vous devez avoir votre chance, Alan. Nous allons voir ce que nous pouvons faire.
Puis, comme s'il venait de prendre une décision, il dit à Martin :
— Pourrions-nous vous, votre femme et moi-même, avoir un entretien à ce sujet ? Le garçon est brillant, il est décidément porteur d'une mission. Pouvons-nous discuter quelque part ?
Martin se tourna vers Alan et dit d'un ton aigre :
— Eh bien, puisque tu as commencé tout ça, puisque tu es venu avec toutes ces complications, continues à ma place de peser toutes les choses pendant que ta mère et moi allons parler avec le docteur.
Cela dit, il sortit de la boutique, guidant le docteur vers l'escalier, tout en prenant soin de refermer la porte derrière lui. Il cria :
— Mère, je monte avec le Dr Thompson ; il veut parler d'Alan avec nous !
Mary Bond se précipita en haut de l'escalier, murmurant :
— Oh, ciel, oh mon Dieu ! qu'a donc fait ce garçon ?
Chapitre Sept
Mary Bond se sentait chavirée intérieurement. Elle promena un regard d'appréhension sur son mari, puis sur le docteur, et enfin sur Alan qui avait grimpé l'escalier derrière eux. D'un air pitoyable, elle fit entrer le docteur au salon — ce qui représentait un véritable privilège.
— Alan, dit le père, va dans ta chambre.
— Oh, mais non, monsieur Bond, interrompit le docteur. Alan est la personne la plus concernée dans cet arrangement. Il n'est plus un enfant ; il est à l'âge où d'autres sont au collège, ce qui sera bientôt son cas, nous l'espérons ! J'estime qu'il doit participer à cette discussion.
En rechignant, Martin fit signe qu'il était d'accord, et les quatre prirent place, la mère gardant les mains sur ses genoux, d'un air grave.
— Le Dr Thompson pense que notre garçon a un cerveau pas habituel, dit Bond, et il tient à nous parler de lui. Il estime qu'il devrait être médecin. Je ne sais que dire de ça, pour ce qui est de moi.
La mère demeura silencieuse ; le docteur s'adressa à elle :
— Vous savez, Mrs Bond, qu'il existe des choses très étranges dans la vie, et également des gens ayant l'impression qu'ils doivent accomplir une certaine chose — et cela sans savoir pourquoi. C'est ainsi qu'Alan a une très, très forte impression de devoir devenir docteur. Ce sentiment, chez ces êtres, est d'une telle force qu'il en devient une obsession ; et quand nous nous trouvons en présence d'un enfant — garçon ou fille — qui, dès qu'il est en mesure de s'exprimer, insiste pour une carrière particulière, alors nous devons être convaincus que Dieu lui a adressé un message ou qu'il essaye d'accomplir, à travers cet enfant, quelque miracle. Je ne prétends pas comprendre ; mais je peux vous dire ceci (il les regarda pour s'assurer qu'ils le suivaient et reprit) : j'ai été élevé à l'orphelinat, où j'ai eu une vie très dure — pour ne pas dire plus — simplement parce qu'on me trouvait différent des autres et parce que je voulais, moi aussi, me destiner à la médecine ; en somme, parce que j'avais une idée bien arrêtée quant à ma carrière. J'ai fini par faire ma médecine, et je crois avoir réussi dans ma profession.
Les parents gardaient le silence, repassant dans leur esprit ce qu'ils venaient d'entendre.
Ce fut Martin qui, finalement, se décida à parler :
— Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, docteur. C'est vrai que le garçon devrait avoir sa chance ; mais je n'ai pas eu la mienne et je me bats pour payer les factures. (Il regarda le docteur avec dureté et continua :) Nous sommes des gens pauvres ; nous avons de la peine à boucler nos fins de mois, et si nous ne payons pas nos factures, nous ne sommes plus approvisionnés et... c'est la fin du boulot. Alors, maintenant, voulez-vous me dire comment nous allons pourvoir aux besoins d'Alan ? Nous ne le pouvons pas, c'est tout simple.
Sur ce, il se frappa vigoureusement le genou pour bien faire comprendre que c'en était ‘fini’, que ‘tout était dit’.
Alan écoutait, l'air de plus en plus sombre. "Si je vivais aux U.S.A., pensait-il, je pourrais trouver un travail à mi-temps, ce qui me permettrait de continuer à étudier et de gagner ma vie, mais ici, il ne semble pas y avoir beaucoup d'espoir pour les pauvres types comme moi."
Le Dr Thompson réfléchissait. Il mit les mains dans les poches de son pantalon et s'étira les jambes avant de dire :
— Eh bien, comme je vous l'ai dit déjà, ma vie a été très dure, et j'ai fait ce que je croyais devoir faire. Il se peut que je doive maintenant aider Alan ; aussi voilà l'offre que je vous fais.
Il regarda les visages autour de lui et vit qu'Alan l'écoutait, tendu ; quant au père Bond, il semblait moins buté et Mrs Bond avait cessé de se tortiller les doigts. Satisfait du changement survenu dans l'atmosphère, le docteur exprima son idée :
— Je suis célibataire, n'ayant jamais eu de temps à consacrer aux femmes — trop occupé que j'étais par les études et la recherche — et en restant célibataire, j'ai économisé pas mal d'argent. Je suis prêt à dépenser une certaine somme pour Alan, mais je ne m'engagerai que s'il peut me convaincre qu'il fera vraiment un bon docteur.
— Quelle merveilleuse chose ce serait, s'empressa de dire Mary Bond. Nous avons bien essayé de prendre une police d'assurance qui payerait les frais d'Alan, mais la chose n'était pas possible pour des gens qui, comme nous, n'ont pas de moyens.
Le docteur hocha la tête et répondit :
— Il n'aura pas de problèmes pour ce qui est des études, car le Directeur m'a parlé de lui en des termes particulièrement élogieux, et il a une bourse pour entrer à St Maggots... tout comme j'en ai eu une. Mais cela ne paie pas ses dépenses d'entretien, et il aurait avantage à vivre au collège. Aussi voilà ce que je ferai. (Semblant maintenant tout à fait déterminé, il dit à Alan :) Je vais vous emmener au Hunterian Museum — au Royal College of Surgeons (Collège Royal des Chirurgiens — NdT), où nous passerons la journée à parcourir le Musée, et si vous supportez cette visite sans vous évanouir, alors nous serons certains que vous avez ce qu'il faut pour réussir dans la profession. (Réfléchissant pendant quelques instants, il ajouta :) Je peux même vous emmener dans la salle de dissection où des cadavres sont exposés et étudiés. Si vous supportez leur vue sans sourciller, eh bien, vous êtes vraiment fait pour la médecine. Et alors, nous conclurons un accord : vous avez votre bourse et moi je paie toutes vos dépenses. Et quand vous serez devenu médecin, eh bien, vous vous acquitterez de votre dette en aidant à votre tour un être conscient d'être porteur d'une mission que le manque d'argent l'empêche d'accomplir.
Alan crut s'évanouir de bonheur.
— Mais, docteur, dit lentement le père Bond, vous savez que c'est Alan qui assure nos livraisons. Il est juste qu'il nous aide un peu. Or, vous venez de suggérer qu'il vive au collège dans le luxe. Et ses pauvres parents, alors ! Pensez-vous que je vais faire les livraisons après ma journée de travail ?
— Mais, Martin ! interrompit Mrs Bond, choquée. Nous nous sommes bien débrouillés avant d'avoir Alan !
— Oui, je sais, répondit Martin, irrité. Je ne l'oublie pas, pas plus que je n'oublie l'argent que ce garçon nous a coûté depuis qu'il est né ; et maintenant il nous remercie en décidant qu'il veut être docteur, ce qui, je suppose, signifie qu'il en a fini avec nous et qu'on ne le verra plus.
Martin Bond avait parlé en serrant ses deux mains avec force, comme s'il mourait d'envie d'étrangler quelqu'un, puis, n'y tenant plus, il explosa :
— Et qu'est-ce que vous retirez de ça, vous, docteur Thompson ? Pourquoi vous intéresser soudain à ce garçon ? C'est ce que j'aimerais savoir ? Les gens ne font jamais rien gratuitement ; ils ont toujours un motif caché. Quel est le vôtre ?
Le docteur éclata de rire, puis répondit à Martin :
— Bon sang, Mr Bond, vous finissez de me persuader que votre fils est tout à fait exceptionnel. Vous ne pensez qu'à ce que vous pouvez retirer des choses, alors que votre fils, lui, ne songe qu'à aider les autres en devenant médecin. Vous tenez à savoir ce qui me motive ? Eh bien, je vais vous le dire. Tout comme votre fils, j'ai des impressions, moi aussi, entre autres, cette très forte impression que je dois l'aider. Ne me demandez pas pourquoi, car je ne le sais pas. Et si vous croyez que je peux être guidé par quelque intérêt sexuel, alors là, vous êtes plus sot encore que je ne pensais, Mr Bond. Les garçons et les filles ne manquent pas — si j'en ai envie. Je veux aider Alan, car j'ai comme un pressentiment de devoir le faire ; et cela pour une raison que je n'arrive pas encore à préciser. Mais si vous êtes hostile à cette idée, nous attendrons qu'il ait vingt et un ans — bien que ce soit peut-être un peu tard. Je ne suis pas venu ici pour me quereller avec vous. Si ma proposition vous déplaît, dites-le et je me retirerai.
Sur ces mots, le docteur se leva, le visage rouge de colère.
Tortillant d'un air gauche le bas de son veston, Martin reprit d'une voix embarrassée.
— Disons que je me suis peut-être laissé aller à juger un peu vite ; mais je me tourmente pour cette histoire de livraisons à faire le soir et pour un tas d'autres petites besognes. Il nous faut vivre, nous aussi, tout comme le garçon.
— Ça suffit, Martin, interrompit brusquement Mrs Bond. Nous pouvons trouver un écolier pour nous décharger de ces travaux. Et ceci nous coûtera moins cher que d'avoir Alan à notre charge.
Martin Bond hocha la tête et répondit comme à contrecœur.
— C'est bon. Tu peux t'en aller. Tu n'es pas encore majeur, et tu dépends encore de mon autorité. Tâche de réussir dans ces études, sinon tu entendras parler de moi.
Sur quoi, Martin sortit brusquement et dévala l'escalier menant à la boutique. Mary Bond regarda le docteur et dit d'un air navré :
— Je m'excuse pour mon mari, docteur ; il est parfois un peu violent, comme les gens de son signe — le Bélier.
La question était réglée. Le docteur emmènerait donc Alan au Hunterian Museum durant la semaine à venir. Le docteur se retira et Alan regagna sa chambre pour étudier.
— Hello, Alan, comment va ? dit le Dr Thompson, quand Alan se présenta à son cabinet la semaine suivante. Entrez, nous allons d'abord prendre une tasse de thé puis nous partirons pour Lincoln's Inn Fields.
Leur thé pris, le docteur montra les toilettes à Alan en lui disant :
— Vous feriez bien, mon garçon, d'y faire une petite visite, vu les émotions qui vous attendent. Je n'aimerais pas que vous ayez des ennuis dans la voiture !
Tout rougissant, Alan se précipita vers le lieu, où, dit-on, même un roi doit se rendre à pied !
La voiture, une vieille Morris Oxford, était garée derrière la maison.
— Montez, dit le docteur en ouvrant la portière pour Alan.
Plus habitué aux autobus bruyants qu'aux voitures particulières, il observa d'un œil avide les manœuvres du docteur — la mise en marche, puis les quelques secondes passées à laisser le moteur se réchauffer, le contrôle du niveau d'huile, etc.
— Vous savez, Alan, quelle est la meilleure façon de se rendre où nous allons ? demanda le docteur comme s'il espérait intriguer son passager.
— Oui, docteur, répliqua-t-il, j'ai consulté la carte, et j'ai cru comprendre qu'il fallait suivre East India Dock Road, puis traverser London Bridge... et, ajouta-t-il timidement, traverser aussi Waterloo Bridge.
— Non, mon garçon. Cette fois, je vous ai eu. Nous ne prenons aucun pont. Et vous faites très attention à la route que je vais prendre — car si mes plans réussissent, vous ferez ce voyage pas mal de fois.
Alan était passionné par tout ce qu'il voyait, lui qui ne sortait pas souvent de Tower Hamlets... et pourtant... il éprouvait comme un sentiment curieux d'avoir déjà connu, en un temps plus ou moins lointain, les endroits qu'ils traversaient. Ils arrivèrent enfin à Sardina Street, la rue qui conduisait à Lincoln's Inn Fields. Le docteur, soudain, franchit une grille ouverte et gara la voiture ; retirant les clefs, il dit à Alan :
— Nous y voilà, venez.
Ils se dirigèrent vers le bâtiment du Royal College of Surgeons, le docteur adressant un petit salut familier à l'un des hommes en uniforme qui se tenait à l'entrée.
— Tout va bien, Bob ? demanda-t-il à l'un d'eux. (D'un pas rapide, il se dirigea vers un vestibule obscur.) Venez, dit-il... Oh, attendez une minute, j'ai oublié de vous montrer quelque chose.
Prenant Alan par le bras :
— Regardez, lui dit-il, voilà quelques-uns des premiers instruments dentaires... vous voyez... Que diriez-vous d'avoir vos molaires extraites avec une chose comme celle-ci ? (Puis avec une gentille tape sur l'épaule d'Alan :) Venez, maintenant, mon garçon, entrons ici.
‘Ici’ était un espace immense empli d'armoires et de rayons sur lesquels étaient posés une multitude de bocaux. Très impressionné, Alan regarda les bocaux dans lesquels flottaient des foetus et certains organes destinés à être examinés et à servir à l'enseignement des étudiants.
Puis, poursuivant leur visite, ils s'arrêtèrent devant un meuble de noyer poli. Le docteur ouvrit un tiroir et Alan aperçut deux plaques de verre entre lesquelles était placé ‘quelque chose’. Voyant son expression, le docteur sourit et dit :
— Cette vitrine représente un cerveau qui a été découpé — ce qui fait qu'il vous suffit d'ouvrir un tiroir pour voir une partie quelconque du cerveau. Regardez ! (Il tira la poignée d'un autre tiroir et apparut une nouvelle plaque de verre.) Voilà, poursuivit-il, qui est censé être le lieu des impressions psychiques. Je me demande ce qui se passe dans le vôtre ? Et dans le mien, également ?
Après avoir passé toute la matinée au Hunterian Museum, le docteur annonça qu'il était temps de prendre un peu de nourriture.
— Avez-vous envie de manger ? demanda le docteur.
Alan avoua avoir très faim. Quittant le Museum, ils se rendirent en voiture jusqu'au club du docteur. Le lunch y était excellent.
— Après cela, je vous conduirai à l'hôpital dans la chambre de dissection, et je verrai ce que je peux vous montrer.
— Oh ! mais on peut entrer comme cela dans la chambre de dissection ? demanda Alan avec étonnement.
— Oh, mon Dieu, non, répondit le Dr Thompson ; mais je suis connu comme spécialiste. J'ai eu un cabinet dans Harley Street ; mais j'étais las des salamalecs et des courbettes, las aussi de toutes ces vieilles peaux qui estiment que vous devez les guérir immédiatement parce qu'elles vous payent de gros honoraires. Et de toute façon elles n'ont jamais la moindre considération pour leur médecin.
Le repas terminé, ils partirent pour l'hôpital. Le docteur rangea sa voiture à l'emplacement réservé aux médecins. Puis se dirigeant vers la réception, il demanda à parler au Pr Dromdary-Dumbkoff. L'employé s'éloigna un instant et revint en disant :
— Le professeur me prie de vous conduire auprès de lui. Voulez-vous me suivre ?
Après avoir parcouru d'interminables corridors, ils arrivèrent enfin devant la porte sur laquelle était inscrit le nom du professeur. L'employé frappa, puis ouvrit la porte. La première chose qu'ils virent fut la moitié d'un humain sur une table et deux personnes en blouse blanche qui s'occupaient à le découper.
Alan se sentait bien un peu chaviré, mais il se contrôla en se souvenant que pour être médecin il devait s'habituer à ce genre de spectacle. Le docteur le lui avait dit, sans mâcher ses mots. Aussi, il avala sa salive, ferma et ouvrit les yeux, deux ou trois fois, et son malaise se dissipa.
Voilà le garçon dont je vous ai parlé, Professeur. C'est un bon sujet, dit le docteur en présentant Alan.
Le professeur le regarda longuement :
— Ah, nous verrons cela, hein ? dit-il avec un ricanement de vieille fille qui plongea Alan dans l'embarras.
Ils restèrent là un bon moment à bavarder, tandis que le professeur surveillait le travail des deux étudiants ; puis Alan fut conduit dans la salle de dissection — une pièce immense où régnaient un froid intense ainsi qu'une odeur pestilentielle. Il eut peur, un moment, de se couvrir de honte en vomissant ou en s'évanouissant ; mais cette fois encore il eut raison de sa nausée, il réussit à se dominer. Le professeur passait d'un corps à un autre — ce n'était pas l'heure des cours et il n'y avait donc là aucun étudiant — leur désignant certaines choses intéressantes, et le Dr Thompson surveillait les réactions d'Alan.
— Ach ! le fou ! s'exclama le professeur d'un air furieux en se baissant pour ramasser un bras tombé à terre. Les étudiants d'aujourd'hui... ils ne sont pas comme ils étaient en Allemagne. Ils sont si insouciants. (En maugréant, il s'avança vers un autre cadavre, et prenant Alan par le bras, il lui dit soudain :) Prenez ce scalpel et incisez d'ici à là ; vous saurez ce que c'est que couper dans la chair.
D'une main maladroite, Alan saisit le scalpel qu'on lui tendait et avec un tremblement intérieur qui, il espérait, échapperait au regard du professeur, il pressa la pointe de l'instrument contre la chair et suivit le trajet indiqué.
— Bien, bien, vous avez la main, dit le professeur d'un air excité. Oui, vous ferez un bon étudiant en médecine.
Un peu plus tard, tandis qu'ils prenaient le thé tous les deux, le docteur dit à Alan :
— Je vois avec plaisir que vous êtes capable de manger après ce que vous venez de voir. Je m'attendais presque à vous voir verdir et rouler sous la table. Que ferez-vous la prochaine fois qu'on vous servira des rognons ? Allez-vous vomir ?
Alan, en confiance maintenant, éclata de rire en disant :
— Non, je me sens à l'aise à présent, docteur.
Ils rentrèrent lentement au milieu d'une circulation intense ; le docteur se livrait, parlait de son âge, de sa fatigue, et expliquait à Alan qu'il allait lui ouvrir un compte bancaire afin qu'il soit complètement indépendant de ses parents.
— Je n'ai pas connu mes parents, dit-il à Alan, mais je pense que s'ils avaient été comme les vôtres... je me serais sauvé !
Chez les Bond, on parla beaucoup ce soir-là. Martin essayait bien de dissimuler sa curiosité, mais il écoutait d'une oreille avide tout ce qui se disait ; puis quand le silence se fit :
— C'est bon, dit-il, tu peux t'en aller quand tu le voudras ; nous avons trouvé un jeune garçon pour te remplacer.
Et ainsi tout fut arrangé très rapidement. Alan allait entrer à l'école préparatoire de St Maggots Hospital, et ensuite — s'il réussissait à ses examens — il deviendrait étudiant en médecine à St Maggots. C'est ainsi que, parmi les trois premiers à l'école préparatoire, il réussit et fut en vérité très apprécié par ses professeurs. Puis vint le moment pour lui de quitter la pré-médecine et d'entrer à l'hôpital en tant que véritable étudiant en médecine. Il n'envisageait pas vraiment avec plaisir ce qui devait avoir lieu le lendemain, car tout changement est difficile et il y en avait déjà tellement eu dans la vie d'Alan.
St Maggots était un vieil hôpital bâti en forme de ‘U’. L'une des branches de ce U était réservée à la médecine générale ; et ce qu'on pourrait appeler le bas de ce U était destiné à la psychiatrie et à la pédiatrie ; l'autre branche, elle, était réservée à la chirurgie. Alan connaissait, bien sûr, l'intérieur de l'hôpital pour y être allé à plusieurs reprises durant ses études préparatoires, mais ce n'est pas sans un certain émoi qu'il s'y rendit ce lundi matin, officiellement. Se présentant à l'entrée principale, il déclina son identité, et l'employé derrière le guichet remarqua d'un ton grincheux :
— Alors, vous en êtes, hein ?
Puis mouillant son pouce tout taché de nicotine, et laissant une grosse marque jaune sur chaque page, il farfouilla longuement à travers une masse de papiers. Ayant trouvé ce qu'il cherchait, il se redressa :
— Oh oui, je suis au courant en ce qui vous concerne. Prenez l'escalier, puis tournez à droite, ensuite à gauche et c'est la seconde porte à droite. Vous devez voir le Dr Eric Tetley. Je vous préviens qu'il est de méchante humeur ce matin, alors, faites attention.
Et avec un haussement d'épaules, il se détourna. Étonné, Alan pensa qu'il aurait pu y avoir un peu plus de respect pour un homme qui allait servir à l'hôpital pendant trois ou quatre ans comme étudiant médical. Mais, haussant les épaules à son tour, il prit ses valises et grimpa l'escalier.
Au sommet de l'escalier, dans un petit vestibule sur la droite, un homme était assis à une table.
— Qui êtes-vous ? demanda-t-il.
Alan donna son nom ; l'employé ayant parcouru son livre, écrivit quelque chose sur une carte et dit à Alan :
— Vous pouvez laisser vos bagages ici ; présentez-vous avec cette carte au bureau du Dr Eric Tetley ; frappez une fois — pas trop fort, attention, et entrez. Ce qui se passera ensuite dépend de vous.
Alan se dit que cette façon d'accueillir les nouveaux était assez particulière, mais il prit la carte et suivit les instructions données par l'homme. Il frappa à la porte, attendit les quelques secondes réglementaires, puis entra. Devant lui, un bureau couvert de papiers, d'instruments chirurgicaux, et de photographies de femmes. Sur un coin, une plaque en lettres blanches portait le nom du docteur — lequel était assis, les bras étendus, ses grosses mains étalées sur le bord du bureau.
Alan s'avança assez décontenancé par le regard fixé sur lui, puis dit enfin :
— Sir, je dois vous remettre cette carte ; je viens d'entrer à St Maggots.
Comme le docteur ne faisait aucun geste pour prendre la carte, Alan la déposa sur le bureau et recula un peu, toujours aussi décontenancé par ce regard qui continuait à le fixer.
— Hum ! grommela le docteur. Le vieux Thompson avait raison. Je pense que vous avez ce qu'il faut pour être un homme bien. Mais vous avez besoin d'être un peu dégourdi, hein ? (Puis changeant de ton, il hurla :) Paul ! Bond est ici. Voulez-vous venir ?
C'est alors qu'Alan vit que le docteur avait le doigt sur un bouton et se servait d'un interphone. Presque immédiatement surgissait dans la pièce, tel un bolide, un docteur de petite taille, à l'allure négligée, avec une chevelure en désordre et vêtu d'une blouse blanche trop longue qui balayait le sol. Une piètre allure, en vérité, pensa Alan.
— Oh, ainsi c'est Bond, eh ? Qu'est-ce que je suis censé faire avec lui ? L'embrasser ?
En reniflant, le docteur répondit :
— Vous l'essayez d'abord pour voir ce qu'on peut en tirer. Il faut que vous en fassiez quelqu'un de bien.
Grognant une réponse, le Dr Paul parcourut les papiers d'Alan et s'exclama :
— St Maggots est tombé bien bas, à ce que je vois ? Le fils d'un marchand de pommes de terre qui va devenir médecin ou chirurgien. Que pensez-vous de ça ? Finies, ici, les cravates des grandes écoles ! Des marchands de légumes, maintenant. Bah !
Alan se sentit profondément humilié par ce qu'avait osé dire de lui cet être peu soigné et assez repoussant ; mais il était ici pour apprendre, et, s'en souvenant, il garda le silence. Se tournant alors pour regarder le Dr Paul, il vit que ses yeux gris pétillaient.
— Mais, mon garçon, reprit-il, ne disent-ils pas que Jésus était le fils d'un charpentier ? Pour ce qui est de moi, je n'ai pas beaucoup de foi en ce qu'ils disent ; je suis de la secte de Moïse.
Et éclatant de rire, il tendit la main à Alan.
On le conduisit ensuite jusqu'à sa chambre située dans la tour centrale du bâtiment, juste au-dessus de l'entrée principale. Il lui fallait partager la pièce avec deux autres étudiants, et les conditions étaient exiguës à l'extrême. Il leur fallait dormir sur des lits de camp.
Le préposé qui l'avait conduit à la chambre et lui avait fait déposer ses valises sur un lit, lui dit :
— Venez, docteur, je vais maintenant vous emmener à la Salle Maristow dans l'aile médicale, une salle de trente-cinq lits, avec à côté une petite chambre privée qui contient deux lits. C'est l'infirmière Swaine qui en a la responsabilité et, dieu du ciel, quelle emmerdeuse ! N'oubliez pas vos bonnes manières !
Sœur Swaine en charge de la Salle Maristow se présentait, en fait, comme un véritable dragon : six pieds de haut (1 m 83), pesant environ deux cents livres (90 kg), avec un air toujours renfrogné, et sombre de peau au point de paraître une métisse. Elle venait cependant d'une très vieille famille anglaise et Alan eut la surprise de découvrir, en l'entendant parler, qu'elle avait la voix d'une personne très cultivée.
Dès qu'on la connaissait, on s'apercevait qu'elle n'avait rien d'un dragon, et que, tout au contraire, elle était prête à rendre service à tout étudiant en qui elle voyait un bûcheur. Mais pour les paresseux, il en était tout autrement et elle les signalait sans tarder à la surveillante.
Dans un hôpital, la vie d'un étudiant est assez monotone. Alan était un grand travailleur et l'impression qu'on avait de lui était excellente. Il achevait sa troisième année quand le Dr Eric Tetley l'appela dans son bureau.
— Les choses marchent très bien pour vous, mon garçon, mieux que je n'aurais cru. Quand je vous ai vu pour la première fois, j'ai pensé qu'en dépit de ce que m'avait dit le vieux Thompson, vous retourneriez quelque jour nettoyer les pommes de terre. Vos notes, depuis le début, ont été excellentes ; aussi ai-je décidé que l'an prochain vous serez mon assistant. Acceptez-vous ? (Il regarda Alan et dit sans attendre sa réponse :) Prenez l'après-midi et allez dire de ma part au vieux Thompson qu'il avait raison en ce qui vous concerne.
Comme Alan s'apprêtait à sortir, il le rappela :
— Vous avez une voiture ?
— Non, sir, répondit Alan. Je ne suis qu'un ex-marchand de légumes devenu étudiant en médecine. Je n'ai pas les moyens d'avoir une voiture.
— Hum ! grogna le docteur, mais je suppose que vous savez conduire ?
— Oh oui, sir, le Dr Thompson m'a appris et j'ai mon permis.
— Parfait, alors, dit le docteur tout en fourrageant dans le tiroir de son bureau, et en grognant à la recherche de ses clefs de voiture. (Il finit par mettre la main dessus et les tendit à Alan.) Voilà les clefs. Je vous demanderai de déposer un paquet chez une dame... voici l'adresse... pouvez-vous me lire ?... Très bien ! Alors déposez le paquet simplement et ne vous attardez pas à bavarder avec elle ; rendez-vous tout droit chez le vieux Thompson. Compris ? Et soyez de retour ici pour 9 heures, ce soir. Ma voiture est dans le box 23 ; c'est juste en dessous du bureau du surveillant. Oh !... il est préférable que je vous donne un mot vous autorisant à prendre la voiture ; vous pourriez tomber sur un idiot de flic qui vous soupçonnerait de l'avoir volée. C'est déjà arrivé. (Il gribouilla quelque chose sur un morceau de papier, posa son cachet dessus et le lança à Alan en disant :) Maintenant sauvez-vous et ne revenez pas avant 9 heures !
Les années passaient — des années de grande réussite pour Alan, mais aussi des années pleines de problèmes. Son père était mort, soudainement, d'une attaque de colère, un jour où un client se plaignait du prix des asperges. Ainsi, Alan devait subvenir aux besoins de sa mère car il ne restait rien qui valait la peine d'être vendu dans le magasin et, bien sûr, la propriété avait été louée. Il l'installa donc dans un petit appartement de deux pièces et veilla à ce qu'elle eût le nécessaire. Mais elle se prit soudain à le détester, lui reprochant d'avoir tué son père en quittant la maison et en voulant vivre au-dessus de sa classe. Et tout en assurant sa subsistance, il cessa de la voir.
Puis ce furent les premières rumeurs de la guerre. Les Allemands — ces affreux Allemands, comme on a coutume de dire — jouaient à nouveau du sabre, se vantant avec outrecuidance de ce qu'ils allaient infliger au reste du monde. Puis ce fut l'invasion d'un pays et d'un autre ensuite, et Alan, maintenant docteur diplômé, essaya d'entrer dans l'armée. Ce qui lui fut refusé ; on avait besoin de ses services dans la localité, de même que dans les compagnies de navigation proches du Bassin de Londres.
Un jour le Dr Thompson téléphona à Alan à l'hôpital où il était maintenant médecin-résident :
— Alan, pouvez-vous venir dès que possible. Il est urgent que je vous voie.
Le Dr Thompson était resté très cher à Alan. Il obtint du Dr Tetley, lequel maintenant avançait en âge, la permission de s'absenter. Il avait à présent sa propre voiture, et il se hâta de se rendre chez le Dr Thompson.
— Alan, lui dit celui-ci, je me fais bien vieux, mon garçon. Je crois n'avoir plus très longtemps à vivre. Voulez-vous m'examiner ?
Alan restait immobile de stupéfaction. Le docteur, s'en rendant compte, demanda :
— Qu'y a-t-il qui ne va pas, mon garçon ? On a oublié qu'on est médecin ? Faites votre métier, voulez-vous ?
Le docteur se déshabilla et Alan qui ne se déplaçait jamais sans sa trousse commença à l'ausculter et prit sa tension artérielle. L'examen révélait une sérieuse hypertension et une sténose mitrale aiguë.
— Vous devriez prendre davantage soin de vous, dit Alan, vous êtes en moins bonne forme que je ne pensais. Pourquoi ne pas venir à St Maggots pour qu'on s'occupe de vous ?
— Non, répondit-il, je n'irai pas dans ce dépotoir à mouches. Voici ce que je vais faire. J'ai ici un cabinet qui marche très bien, très intéressant du point de vue revenus. Le Dr Tetley pense le plus grand bien de vous depuis cinq ans que vous exercez. Aussi ai-je décidé que vous alliez reprendre ma clientèle pendant que je suis encore en mesure de vous mettre au courant. Vous êtes resté trop longtemps à travailler à St Maggots ; vous devenez tout voûté et presque myope. Laissez tomber le poste et venez vivre auprès de moi. Il est bien entendu que je vous laisserai la clientèle et que, jusqu'au jour où je casserai ma pipe, nous travaillerons ensemble en association. Ça vous va ?
Alan se sentait tout troublé. Il s'était depuis quelque temps figé dans une sorte d'obsession — celle d'avoir à sauver des vies, sauver des vies à tout prix, quel que soit l'état du patient. La chirurgie ne l'intéressait pas ; mais il excellait en médecine générale et s'apprêtait à devenir quelqu'un dans cette branche. Et voilà que son ami et son bienfaiteur, le Dr Reginald Thompson, voulait qu'il devienne son associé. Voyant qu'il semblait plongé dans ses réflexions, le Dr Thompson lui dit alors :
— Rentrez à St Maggots et parlez-en avec Eric Tetley ; demandez également l'avis de votre ami, le Dr Wardley. Vous savez qu'ils vous conseilleront sagement. Et maintenant, ne revenez me voir que quand vous aurez pris une décision.
À cet instant, Mrs Simmonds, maintenant assez âgée, apparaissait poussant la table roulante sur laquelle le thé était servi.
— Ah, docteur Thompson, j'ai vu que le Dr Bond était ici, alors j'ai préparé le thé pour vous éviter de m'appeler.
Tout en parlant elle adressa un large sourire à Alan qui était devenu son favori, appréciant ce qu'il avait réussi à faire de sa vie.
De retour à St Maggots, Alan eut tout loisir de discuter avec les deux médecins.
— Je ne devrais pas vous le dire, Alan, mais Reginald Thompson a été mon patient pendant des années, dit le Dr Wardley ; il a eu toute une série de cardiogrammes et il peut s'éteindre brusquement. Vous lui devez tout — vous ne l'ignorez pas — et vous devriez vous demander s'il n'est pas de votre devoir d'aller vivre auprès de lui.
Le Dr Tetley acquiesça d'un hochement de tête, puis dit à son tour :
— Vous avez fait un excellent travail à St Maggots, mais vous y êtes trop limité, trop prisonnier du système hospitalier. En outre, la guerre est inévitable et il faudra des médecins partout ; nous pourrons toujours faire appel à vous, en cas d'urgence. Je vous libère du contrat que vous avez avec nous.
Et c'est ainsi qu'un mois plus tard, le Dr Alan Bond devenait l'associé du Dr Reginald Thompson — et que tous deux connaissaient une vraie réussite. Mais journaux et radios ne parlaient que de bombardements, de pays tombant l'un après l'autre sous la botte allemande, et des atrocités dont étaient victimes les populations. Puis ce fut Neville Chamberlain de retour d'Allemagne avec un tas de propos ineptes sur la paix, tandis que parvenaient d'Allemagne des échos du gros rire sonore qu'avait soulevé l'Anglais dégingandé venu avec son parapluie pour assumer la paix du monde. On ne tarda pas à entendre à la radio les déclarations tonitruantes d'Hitler, ses rugissements de conquérant ; puis un ou deux jours plus tard, l'Angleterre déclarait la guerre.
Un an se passa. C'était la drôle de guerre. Un jour, Alan apprit par un agent de police qui avait pris grand soin de s'assurer qu'il était bien le Dr Alan Bond — que sa mère, Mary Bond, s'était suicidée et que le corps se trouvait à la morgue de Paddington.
Ce fut, pour Alan, un terrible choc. Il ne parvenait pas à comprendre pourquoi le mot de suicide lui semblait le plus terrible qu'il ait jamais entendu. Suicide ! Pendant des années il avait prêché contre le suicide, et sa mère venait de commettre cet acte insensé.
Puis la guerre augmenta de violence, et Londres connut ses premiers bombardements. L'Allemagne ne connaissait que des succès, et, en Asie, les Japonais balayaient tout sur leur passage. Ils avaient pris Shanghaï et Singapour. De nouveau, Alan essaya de s'engager, et de nouveau, il fut rejeté sous le prétexte qu'il était plus utile là où il était.
Les raids s'intensifièrent. Nuit après nuit, les bombardiers allemands lâchaient leurs bombes sur la côte et sur Londres. Nuit après nuit, les docks et l'East End de Londres étaient en flammes. Alan travaillait très étroitement avec les gens de l'A.R.P. (Air Raid Precautions — organisation vouée à la protection des civils contre les raids aériens — NdT) et avait en fait un poste dans le sous-sol de la maison. Les toits des immeubles recevaient chaque nuit une pluie de bombes, lesquelles traversaient parfois le toit et incendiaient toute la maison.
Puis vint le raid le plus spectaculaire où Londres ne semblait plus qu'un immense brasier sous le bruit incessant des sirènes. Les lances à incendie serpentaient tout au long des rues ne permettant pas aux docteurs d'utiliser leur voiture.
La lune brillait cette nuit-là, mais voilée par les fumées rouges qui s'élevaient des incendies ; des pluies d'étincelles jaillissaient de partout et ce n'était que ce bruit infernal des bombes et des sirènes. Alan avait l'impression d'être partout à la fois, aidant à dégager les corps des abris bombardés, rampant à travers les brèches faites dans le sous-sol de certaines maisons, afin d'essayer d'adoucir la souffrance des blessés.
Cette nuit-là, Alan se réconfortait un instant avec une tasse de thé à l'une des cantines d'urgence.
— Fichtre ! s'exclama le secouriste de l'A.R.P. à ses côtés, celle-là n'est pas passée loin !
Alan regarda et vit que toute la ligne d'horizon était en flammes, avec, au-dessus, le grondement des moteurs de l'aviation allemande. Par moments, parvenait le crépitement des avions de chasse anglais actionnant leur mitrailleuse contre les avions ennemis.
Soudain, ce fut comme si le monde chavirait. Un immeuble entier se désintégra et s'écroula. Alan eut la sensation de vivre une agonie. Le secouriste qui était indemne regarda autour de lui et s'écria :
— Oh, Dieu, le docteur est touché !
Les hommes de l'A.R.P. et la brigade des sauveteurs se précipitèrent, essayant avec frénésie de dégager Alan dont les jambes et le bas-ventre étaient coincés sous des blocs de maçonnerie. Il lui semblait être dans une mer de feu qui le consumait lentement. Ouvrant les yeux il dit d'une voix faible :
— Inutile de vous donner tant de peine, les gars, j'ai mon compte. Laissez-moi et occupez-vous de ceux qu'on peut sauver.
Puis il referma les yeux. Ce qu'il éprouvait était étrange. C'était comme un état d'extase, d'où toute souffrance était absente. Il pensa être victime d'hallucinations, car il flottait au-dessus de lui-même. Il voyait un cordon bleuâtre reliant son corps flottant dans l'air au corps gisant sur le sol — et ce corps sur le sol était complètement écrasé de la taille jusqu'aux pieds. Soudain, il eut une lueur. C'était aujourd'hui son trentième anniversaire. Le cordon sembla s'amenuiser, puis disparut, et Alan se trouva flottant tout comme l'un de ces ballons de barrage installés au-dessus de Londres. Il était à même de voir Londres s'éloigner et disparaître. Soudain il eut l'impression de buter contre un nuage noir et pour un temps ce fut le néant.
"Cinquante-Trois ! Cinquante-Trois !", appela une voix dans sa tête. Ouvrant les yeux, il regarda autour de lui, mais tout était comme un brouillard noir. "Je ne comprends pas et pourtant tout me semble familier ! Je me demande où je peux bien être ?" pensa-t-il en lui-même. "Je dois être anesthésié ou je ne sais quoi." Avec cette pensée, le nuage passa du noir au gris, il put voir des formes, des silhouettes qui se déplaçaient, et alors tout lui revint. Il était dans l'astral. Il sourit, et avec ce sourire les nuages et le brouillard s'évanouirent et la gloire du plan astral lui apparut. Ses amis étaient là, car seuls des amis pouvaient être sur un tel plan. Il regarda sa personne et pendant un moment se sentit gêné ; bien vite, il pensa au premier vêtement susceptible de lui venir à l'esprit : la blouse blanche qu'il avait l'habitude de porter à St Maggots. Comme par enchantement, il s'en trouva immédiatement revêtu ; mais les éclats de rire qui l'accueillirent le décontenancèrent ; se regardant, il se souvint que sa blouse d'hôpital — celle des spécialistes — s'arrêtait à la taille.
L'astral était extrêmement plaisant. Ses amis, tous joyeux, le conduisirent à la Maison de Repos. On lui attribua une chambre très agréable qui avait vue sur un parc planté d'arbres tels qu'il n'en avait encore jamais vu. Des oiseaux et des animaux y circulaient en pleine liberté et en toute sécurité.
Alan ne fut pas long à se remettre du traumatisme de sa mort sur Terre et de sa renaissance dans l'astral ; une semaine plus tard, comme c'était toujours le cas, il dut se rendre au Hall des Souvenirs où, seul, il regarda défiler les événements de sa dernière existence. Puis une fois revu ce passé sans durée mesurable, une voix gentille venant de ‘quelque part’ lui dit :
— Vous avez fait du bon travail, vous avez été très bien, vous avez expié. Vous pouvez maintenant vous reposer durant quelques siècles avant de faire de nouveaux plans. Vous être libre de vous livrer à des recherches, ou à toute autre chose qu'il vous plaira de choisir. Vous vous êtes bien comporté.
Il quitta le Hall des Souvenirs pour être accueilli à nouveau par ses amis, et ils s'éloignèrent ensemble afin qu'Alan ait un chez-soi où il puisse trouver la joie et réfléchir à loisir.
Je crois que tous les êtres, quels qu'ils soient, devraient être instruits du fait que la mort n'existe pas, qu'il n'y a seulement qu'une transition. Et quand vient le temps de la transition, une Nature bienfaisante aplanit la route, soulage la douleur, et crée les conditions d'une parfaite tranquillité pour ceux qui CROIENT.
Chapitre Huit
La vieille maison était calme et silencieuse, aussi silencieuse que peut jamais l'être une vieille maison. Parfois, au cours de la nuit, s'élevait le murmure d'une lame de plancher frottant contre sa voisine et s'excusant de cette indiscrétion. La maison se reposait après une journée qui avait été très éprouvante. Il ne lui était plus possible de s'assoupir gentiment au bon soleil, assaillie qu'elle était par les impôts, les demandes et les dépenses de restauration. Elle souffrait de subir le flot de visiteurs surgissant dans ses couloirs, et se précipitant en groupes dans les chambres, comme un troupeau de moutons déments. Elle sentait son plancher fléchir sous le poids inhabituel qu'on lui imposait après tant d'années de quiétude, et elle geignait doucement. Mais, pour La Famille, il s'agissait de tenir et de trouver un moyen de faire de l'argent ; et c'est ainsi qu'après mûres réflexions et nombre de discussions tournant parfois à la dispute, la décision avait été prise d'ouvrir la maison aux visiteurs.
Construit depuis plusieurs siècles, ce manoir l'avait été pour un gentilhomme de haute naissance, un aristocrate que le roi avait récompensé de son dévouement en l'élevant à la pairie. Cette maison avait été bâtie avec amour par de solides artisans vivant de bière, de fromage et de pain, et fiers d'un travail bien fait. Elle avait donc survécu au temps, résisté aux chaleurs des étés et aux rigueurs des hivers. Les jardins en étaient encore bien tenus et l'ensemble de la maison résistait — à part quelques planches qui commençaient à craquer et quelques voûtes qui s'affaissaient ; et, à cette heure, épuisée par le piétinement des visiteurs et souillée par les papiers gras, la vieille maison était retournée à la quiétude.
Elle était silencieuse, aussi silencieuse que peut jamais l'être une vieille maison. Des souris jouaient en poussant des cris aigus derrière les lambris. Un hibou, parfois, hululait à la lune. À l'extérieur, le vent froid de la nuit bruissait et balançait une branche d'arbre qui venait taper contre la vitre de la fenêtre. Mais cette aile n'était pas habitée. ‘La Famille’ vivait dans une plus petite maison qui, aux temps prospères, était le domaine du maître d'hôtel et de sa femme.
Le parquet poli brillait sous la lumière de la lune, envoyant d'étranges reflets contre les murs lambrissés sur lesquels des aïeux à l'air sinistre vous regardaient de leurs yeux éteints, comme ils le faisaient depuis des siècles.
À l'extrémité du Grand Hall, l'imposant grand-père horloge sonna le quart d'heure avant minuit et, sur une desserte, des verres de cristal taillé tintèrent comme s'ils se répondaient. Puis d'une autre pièce parvinrent les hautes notes d'une petite-fille horloge répétant le quart avant l'heure.
Tout demeura silencieux pendant un moment, puis le grand-père demanda :
— Es-tu là, petite-fille horloge ? M'entends-tu ?
Il y eut le déclic d'un petit rouage, puis la voix perchée de la petite-fille horloge répondit :
— Mais oui, grand-père, je vous entends. Vous avez quelque chose à me dire cette nuit ?
Grand-père horloge continua son tic-tac, puis il parla.
— Petite-fille, je suis née à la fin du dix-septième siècle, et mon habit de bois fut poli pour la première fois en 1675 ; depuis que mon balancier s'est mis en mouvement, j'ai médité sur le mystère de la vie. Longue est mon existence, et longue ma méditation. Si courte est la durée de vie des humains qu'elle ne leur laisse vraiment que peu de temps pour penser à tout ce qu'il y a à savoir sur la vie. Est-ce que cela t'intéresse, toi, petite-fille ?
Dans la pièce où on l'avait placée — le salon des dames — la petite-fille eut un sursaut en entendant passer une grosse locomotive traînant d'innombrables wagons. Puis, d'une voix gentille, elle répondit :
— Bien sûr, grand-père ; je serais heureuse d'entendre ce à quoi vous avez pensé tout au long de ces siècles. Je vous écoute et ne vous interromprai que pour accomplir les devoirs de ma charge et justifier ma présence, c'est-à-dire pour sonner les heures. Parlez, grand-père, je vous écoute.
Grand-père horloge marmonna dans sa gorge ; magnifique dans son habit de bois, plus de sept pieds de haut (2 m), il s'élevait dans une demi-obscurité au-dessus du sol luisant. Pas une marque de doigt sur son bois poli, car un valet de pied avait pour tâche d'entretenir ses pièces anciennes. Le visage de grand-père horloge était exposé de façon à recevoir la lumière de la lune, et pouvait voir par la fenêtre les vastes parcs plantés d'arbres centenaires, alignés tels des soldats pour la parade. Autour d'eux, d'impeccables pelouses s'étendaient et, de-ci de-là, poussaient des buissons de rhododendrons et autres espèces de pays lointains.
Au-delà des buissons — bien que le regard du grand-père n'eût jamais porté aussi loin — s'étendaient de belles prairies où paissaient les chevaux et les vaches du domaine.
Plus près, mais dérobé à la vue de grand-père, s'étendait apparemment un très joli étang d'une trentaine de pieds (90 m) de largeur. C'était une horloge de voyage qui le lui avait appris. Elle lui avait dit, également, que la surface de l'étang était recouverte de lis sur lesquels, à un certain moment de l'année, de grosses grenouilles coassaient ; grand-père avait, en fait, entendu ces coassements et s'était dit que leur mécanisme avait sans doute besoin d'être un peu huilé ; mais l'horloge voyageuse lui avait expliqué ce qu'il en était, lui avait aussi parlé des poissons de l'étang et révélé que, tout au fond du domaine, on avait installé une immense volière de quelque trente pieds (9 m) de long et dix pieds (3 m) de haut, emplie d'oiseaux multicolores.
Grand-père horloge réfléchissait à tout cela. Il remonta le cours des siècles, voyant lords et ladies venant vers lui dans leurs somptueux vêtements, si différents de ces vulgaires choses en coton décoloré dont les humains semblaient maintenant être uniformément recouverts. Il fut arraché à sa rêverie par une petite voix frêle qui demandait :
— Que se passe-t-il, grand-père ? J'attends que vous poursuiviez votre histoire... vous alliez me parler du passé, du présent et du futur, et aussi de la vie et de son sens.
Grand-père horloge s'éclaircit la gorge et son pendule fit tic-tac, tic-tac, tic-tac, puis il parla :
— Petite-fille, dit-il, les humains ne se rendent pas compte que le pendule qui se balance est la réponse à l'énigme de l'Univers. Je suis une vieille horloge et je me tiens debout ici depuis tant d'années que le bas de mon habit de bois s'affaisse et que mes joints craquent aux changements de température ; mais je tiens à te dire ceci : nous, horloges de l'ancienne Angleterre, connaissons l'énigme de l'Univers, le Secret de la Vie, et les Secrets Au-delà.
Le conte qu'il confia à la petite-fille horloge était nouveau ; c'était un conte en développement depuis des siècles, et qui remontait bien au-delà de toute mémoire humaine. Il dit qu'il lui fallait mêler technologie moderne et science ancienne, car la première est, en fait, une science ancienne.
— Les arbres m'ont confié, dit-il, qu'il existait, il y a de cela des milliers d'années, une autre science, une autre civilisation, et que tout ce que nous considérons comme inventions et développements modernes étaient, en ce temps-là, déjà dépassés. (Il s'arrêta.) Oh, j'allais laisser passer l'heure. Il faut que je sonne.
Se tenant bien droit dans le Grand Hall, il lâcha d'abord le déclic, puis le carillon, et sonna les douze coups de minuit — moment où un jour meurt et où un autre naît, moment où commence un nouveau cycle. Puis le dernier coup sonné, les vibrations ayant pris fin, il attendit patiemment que sa petite-fille répète son message à ceux qui écoutaient dans le silence de la nuit.
La petite-fille, grande et élancée, n'avait guère plus de cent ans. Elle était douée d'une voix plaisante et un carillon particulièrement clair, sans aucune vibration ni bruit parasite. Mais c'était, bien sûr, naturel chez une jeune personne qui n'était que centenaire. À cette heure, des rais de lune filtrant à travers les branches et les hautes fenêtres jouaient sur son habit de bois, embellissaient ses décorations et caressaient, par moments, ses aiguilles tendues comme les doigts d'une personne en prière. Elle toussota, puis ses roues commencèrent à tourner. Elle martela les notes de son chant. Elle trembla faiblement au douzième coup, comme épuisée par l'effort qu'elle venait de produire et, au bout de leurs chaînes, les poids firent du bruit en cherchant à se remettre en position.
— Désolée, grand-père, de vous avoir fait attendre. Je suis en retard d'une minute, je le sais ; mais ceci sera très bientôt arrangé. Voulez-vous continuer ?
Grand-père sourit intérieurement. "Il était juste, pensa-t-il, que les jeunes personnes aient de la déférence pour les anciens." Oui, petite-fille, je vais continuer, répondit-il.
— Tout au long des âges, les humains ont cherché la religion pour les consoler des duretés de leur vie anormale. Ils ont toujours cherché un Dieu qui serait un Père personnel s'occupant d'eux, veillant sur eux, ne se souciant que d'eux et leur accordant un traitement préférentiel sur tous les autres humains. Il faut toujours qu'il y ait un Dieu, poursuivit-il, quelqu'un d'omnipotent, quelqu'un qu'on peut prier et de qui on espère obtenir une réponse favorable aux prières qu'on lui adresse.
La petite-fille horloge fit signe qu'elle était d'accord, et, quelque part, une souris maladroite heurta un ornement. Avec un cri de terreur, la souris bondit à terre en courant vers le trou le plus proche et y disparut.
Grand-père reprit son histoire :
— Nous devons aussi prendre en considération la technologie moderne qui, bien sûr, n'est qu'une recrudescence de la vieille technologie. Tout ce qui existe, tout ce qui EST, n'est qu'une série de vibrations. Une vibration est une vague qui d'abord s'élève, puis descend, s'élève de nouveau et descend de nouveau tout au long de l'éternité, tout comme nos pendules continuent à osciller d'abord d'un côté, où ils s'arrêtent pour une fraction de fraction de seconde, puis descendent de l'autre côté.
Grand-père horloge se tut pendant un moment, puis rit sous cape, tandis que la chaîne avançait d'un cran sur la roue de cuivre à l'intérieur, et que le poids faisait un petit saut de joie à se trouver un cran plus bas vers le sol.
— Je sais, dit-il, que toutes les choses qui existent ont leur phase négative et leur phase positive, d'abord d'un côté et ensuite de l'autre. Je sais, dit-il avec une solennité croissante, qu'à une certaine période du temps, quand le Pendule de Vie est d'un côté de son balancement, le Dieu en charge est le Dieu du Bien. Mais dans une telle position, le Dieu du Bien a tendance à s'assoupir dans le contentement de soi et s'intéresse insuffisamment à ce qui se passe autour de lui, et le Pendule de Vie, qui s'était immobilisé pour son changement d'oscillation, recommence son mouvement et va vers le bas. Le Dieu du Bien s'endort dans l'idée que tout est bien ; mais le Pendule descend et recommence son mouvement de l'autre côté, et là, le Dieu du Mal que les hommes appellent Satan, et dont c'est le tour, maintenant, attend avec avidité. Le Mal est une force tellement puissante, dit grand-père, c'est une force terriblement puissante. Le Bien ne croit pas au maléfice du mal, et c'est pourquoi il ne le combat pas suffisamment. Et nous avons donc cette force du mal que nous appelons Satan profitant au maximum de son opportunité. Le Pendule de Vie va vers le haut, et à la fin de son oscillation, comme il en est de la fin de toutes les oscillations de tous les pendules, il s'arrête pour une fraction de fraction de seconde, avant de redescendre à nouveau, et c'est durant ce temps que le Dieu du Mal accomplit ses pires actions. Et puis, quand le Pendule redescend à nouveau, il perd graduellement du pouvoir, et c'est lorsqu'il remonte vers le Bien que le Bien trône à nouveau.
— Ah, grand-père ! dit une voix frêle sortant de l'obscurité. (Telle une ombre, une chatte noire et blanche, au poil soyeux, apparut et vint s'asseoir dans un rayon de lune en levant les yeux vers la vieille, vieille horloge. Puis s'avançant, elle alla se frotter contre le bas de l'horloge.)
— Je pourrais très bien grimper pour aller m'asseoir sur votre tête, dit la chatte, mais je vous aime trop pour vous manquer de respect. Racontez encore.
Elle recula et retourna s'asseoir dans le rayon de lune, face à l'horloge et, sans perdre de temps, fit la toilette de son museau et de ses oreilles. De temps à autre elle levait les yeux vers la vieille horloge qui la regardait avec affection et qui lui dit :
— Attends un peu, petite chatte ; je suis une horloge et mon temps est limité de façon précise. J'attends le moment de sonner le quart, car je dois apprendre à tous les humains qui sont conscients que le jour nouveau-né a maintenant quinze minutes. Petite chatte, écoute-moi, et une minute après, écoute ma petite-fille. Nous dirons le temps, puis reprendrons notre conversation.
Et dans l'air silencieux, le carillon des quinze minutes passées l'heure résonna. À cet instant un homme qui se glissait furtivement pour venir chaparder des œufs dans le poulailler voisin s'immobilisa sur place, puis sourit en avançant vers la fenêtre où la petite-fille horloge était prête à se faire entendre. Voyant l'ombre du maraudeur passer devant la fenêtre, elle sonna de toutes ses forces. De nouveau, l'homme s'arrêta et, se cachant le visage avec ses mains, il risqua un œil dans la pièce.
— Eh, jolie jeune fille, dit-il, tu suffirais à couper tous les moyens de n'importe quel bon maraudeur !
Cela dit, il se glissa dans l'ombre et, quelques minutes plus tard, s'élevaient le murmure, puis les protestations des poules arrachées à leur sommeil.
La maison était toujours silencieuse, aussi silencieuse que pouvait l'être une aussi vieille demeure. Les planches craquaient et les escaliers se plaignaient, las de rester si longtemps dans la même position. À travers la maison, on percevait le bruit de petits pas précipités, et, bien sûr, l'omniprésent tic, tic, tic, et tac, tac, tac. Ou le plus gros tic-tac, tic-tac de grand-père horloge. Tout cela constituait les sons normaux d'une maison vivante.
La nuit s'avançait. La lune suivait sa course, laissant autour de la maison de grandes ombres sombres. Les créatures de la nuit sortirent pour aller à leurs affaires. De jeunes renards se risquèrent hors de leur tanière pour venir jeter un regard sur ce qu'était la vie nocturne sur la terre.
La nuit s'avançait, la vie qui était la leur. Les chats traquaient leur proie, la manquaient parfois et pestaient dans leur langage félin, furieux de leur mésaventure.
À l'est, enfin, le ciel s'éclaircit faiblement ; quelques lueurs rouges apparurent, éclairant des collines au loin, rendant ainsi plus épaisse l'obscurité qui baignait encore les vallées. Non loin, un coq lança son cocorico annonçant l'approche d'un jour nouveau. Un instant, la nature demeura immobile, puis soudain tout ce qui vit la nuit s'agita, averti que l'aube allait poindre et qu'il était temps de regagner son gîte dans les fourrés ou les arbres. Les oiseaux de nuit s'en allèrent vers leur perchoir dans quelque coin sombre ; les chauves-souris retrouvèrent leur clocher — et ce fut l'heure pour les créatures diurnes de se préparer au réveil.
Dans le Grand Hall, grand-père horloge faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il avait cessé de parler. Cette heure-là n'était pas propice aux conversations ; des humains pouvaient surgir, et ce n'est certes pas à ces êtres distraits et incroyants que les horloges révélaient leurs secrets.
Grand-père, dans le passé, avait bien souvent commenté l'attitude des humains, disant :
— Ils veulent toujours des preuves de tout, ils veulent même la preuve qu'ils sont des humains ; mais comment allez-vous prouver quelque chose ? Si une chose est vraie, elle n'a pas besoin de preuve parce qu'il est évident qu'elle est là, mais si une chose n'est pas vraie et si elle n'est pas là, aucun amas de ‘preuves’ ne prouvera qu'elle est là ; c'est pourquoi il est donc inutile d'essayer de prouver quoi que ce soit.
La lumière devint plus brillante ; le jour avançait. L'activité gagnait la maison ; le personnel s'affairait, faisant résonner la vieille demeure du bruit barbare d'appareils de nettoyage. Du sous-sol réservé aux serviteurs parvenaient des bruits de voix et de vaisselle. Puis ce fut, au long du hall, des pas familiers : ceux du valet de pied s'arrêtant et disant :
— Bonjour, grand-père. Je vais faire votre toilette, donner un bon coup de chiffon à votre bois et vous essuyer le visage.
S'avançant, il nettoya la vitre et vérifia l'heure ; puis, ouvrant l'horloge, il remonta les poids avec soin et tira les chaînes, afin d'éviter des efforts inutiles à ses rouages si anciens. Ce rituel accompli et la porte refermée, il donna une caresse à la vieille horloge avant que de polir sa surface déjà luisante comme un miroir.
— Voilà, grand-père, dit-il, une fois sa tâche achevée, vous êtes superbe pour accueillir le troupeau d'idiots qui viendront vous contempler.
Donnant encore un dernier coup de chiffon, il s'en alla ensuite fixer, de chaque côté du mur, la grosse corde rouge qui représentait la barrière interdisant aux visiteurs d'approcher de grand-père horloge.
Le jour continuait d'avancer, et l'on ne tarda pas à entendre le ronflement des moteurs et les cris d'enfants indisciplinés dominés par ceux des mères giflant et fessant pour essayer de maintenir l'ordre.
Les portes principales furent ouvertes. Les valets reculèrent un peu pour laisser s'engouffrer une humanité malodorante, dont le relent faisait songer à celui d'une troupe d'éléphants en rut. La vague humaine fit irruption dans le Grand Hall et se précipita dans les différentes pièces.
— Maman, maman, veux m'en aller ! cria un petit enfant en pleurnichant.
— Chut ! Tais-toi ! réprimanda la mère.
Mais elle ne parvint qu'à déchaîner le gosse qui reprit avec une vigueur nouvelle :
— Maman... veux m'en aller !
Se penchant un peu, elle lui lança une claque sonore. Il se tut pendant un moment, et un étrange bruit de liquide qui coule ne tarda pas à rompre le silence. Honteux, le petit garçon se tenait au milieu d'une mare, son pantalon dégouttant d'urine. Avec un soupir de résignation, un valet, qui veillait non loin de là, s'avança avec une éponge et un seau, comme si ce genre d'incident était quotidien.
Sous un canapé au luxueux rembourrage, deux yeux verts observaient la scène avec intérêt. C'était l'endroit que préférait la chatte noire et blanche et, de son poste d'observation, elle surveillait chaque jour les enfants mal élevés et les groupes de matrones qui envahissaient sa vieille demeure en faisant des commentaires et en semant leurs papiers gras ou leurs gobelets de carton sur les meubles ou le sol, sans s'inquiéter du travail que cela causait à d'autres.
De l'extrémité du Grand Hall, grand-père regardait, impassible. Il fut cependant assez décontenancé quand un petit garçon se précipita en courant à travers le hall, s'apprêtant à passer sous le grand cordon rouge. Un employé était là qui, heureusement, l'attrapa par le col de son vêtement.
— Sors d'ici, gronda l'homme en lui donnant une tape dans le dos pour le faire avancer.
La foule allait en s'épaississant — mentalement aussi, regardant bouche grande ouverte les tableaux fixés aux murs et mastiquant des morceaux de gomme qu'ils s'amusaient à projeter hors de leur bouche. Tout ici leur semblait étrange, et ils avaient peine à comprendre le privilège qu'était pour eux le fait d'avoir un aperçu du passé. Tout ce qui les intéressait, c'était de voir leur chèque de paie de la semaine suivante !
Toutes choses doivent avoir une fin, même les mauvaises, bien que ces dernières semblent durer beaucoup, beaucoup plus longtemps que les bonnes. On a une expérience agréable et elle semble se terminer avant même qu'on ne s'aperçoive qu'elle ait commencé, mais une mauvaise expérience — ah ! c'est tout autre chose. Elle semble se prolonger, elle donne l'impression de ne devoir jamais finir. Mais, bien sûr, on finit par en voir la fin. Il en était ainsi de cette journée. Quand l'obscurité commença à descendre, la foule s'amenuisa ; on entendit le ronflement des grands autobus de tourisme ramenant leurs passagers au bercail. Puis, un à un, les derniers visiteurs disparurent à leur tour. Tout de suite, le personnel de nettoyage envahit la maison telle une nuée de sauterelles, ramassant papiers, cartons, et autres déchets.
À l'extérieur, de nombreuses bouteilles jonchaient le sol et, sous certains buissons qui avaient eu la préférence de ces dames, on allait jusqu'à trouver des pièces de lingerie. Les animaux qui étaient là, en spectateurs, se demandaient souvent comment une personne pouvait retirer un vêtement de dessous et être négligente au point de ne pas le remettre. Mais, en même temps, ils s'interrogeaient sur la nécessité de porter de telles choses. Les humains n'étaient-ils pas nés nus ? Et cette remarque ne faisait que renforcer leur idée que le comportement de ceux-ci était franchement déroutant.
La nuit était enfin tombée, et ‘La Famille’ se rassembla autour des lampes allumées pour faire le compte de l'argent des entrées, en faisant la part des profits et des pertes subies — plantes écrasées, vitres brisées, car il ne passait pas de jour sans que quelque morveux ne s'amuse à lancer une pierre contre les vitres de la serre. La maison fut enfin remise en état et les comptes achevés. Le veilleur de service entreprit sa ronde, promenant sa lampe-torche sur divers points du bâtiment. Sa ronde finie, il éteignit les lumières et rejoignit le centre de sécurité.
Par une fenêtre demeurée entrouverte, la chatte noire et blanche se glissa jusqu'au Grand Hall et se dirigea d'un pas posé vers grand-père horloge.
— Je viens juste de dîner, dit-elle. Je me demande comment vous arrivez à tenir sans aucune nourriture. Vous devez être affamé ! Pourquoi ne pas venir avec moi. Je vous attraperai un oiseau ou une souris.
Grand-père ne répondit pas et gloussa dans sa barbe. Mais l'heure n'était pas venue pour lui de répondre, car chacun sait qu'aucun grand-père horloge ne parle avant minuit moins un quart, car ce quart d'heure-là mène à l'heure magique, l'heure où tout semble différent, l'heure où ceux qui sont normalement muets trouvent le moyen d'exprimer leurs pensées. Grand-père, pour l'instant, ne pouvait que penser et dire, comme à l'habitude, tic-tac, tic-tac.
Non loin de là, dans ce qui, en un temps, avait été le très important salon des dames, la petite-fille horloge laissait son esprit vagabonder sur les événements de la journée. En y pensant, elle s'estimait très privilégiée de ne pas avoir été jetée à terre quand deux sauvages avaient enjambé la barrière de corde et roulé à ses pieds. Deux préposés à la surveillance s'étaient précipités sur eux et les avaient expulsés. La petite-fille horloge revit la scène avec un frisson d'horreur qui déclencha en elle un bruit métallique. Elle pensa ensuite à des choses plus agréables, à la visite que lui avait faite, très tôt le matin, le jeune valet de pied. Il s'était occupé de l'épousseter puis l'avait nourrie en remontant ses poids, remise à l'heure avec soin afin qu'elle puisse sonner et carillonner en même temps que grand-père.
Tout dans la maison était calme, calme comme peuvent l'être les choses dans une vieille maison. Les horloges rythmaient le temps de leur tic-tac monotone, et l'horloge voyageuse attendait avec impatience que sonne le quart d'avant minuit, pour pouvoir raconter quelques-unes de ses aventures. Regardant les aiguilles de la grande horloge, la chatte eut un soupir de résignation, sachant qu'il lui fallait attendre le quart d'avant minuit. Elle traversa le Hall et, avec souplesse, bondit sur un vieux coffre de chêne. Là, elle s'étira, puis s'endormit, mais pour peu de temps. Elle fut réveillée par un incident et laissa échapper quelques miaulements pour chasser des oiseaux voletant devant la fenêtre.
— Si je pouvais seulement ouvrir cette fenêtre ! s'exclama la chatte exaspérée, je leur donnerais une bonne leçon à ces oiseaux, encore qu'ils ne vivraient pas assez longtemps pour en profiter.
Apercevant le chat à l'intérieur de la pièce, les oiseaux s'envolèrent en poussant de petits cris.
Grand-père horloge sonna enfin, et par deux fois, la demie de 11 heures. Ce que fit également la petite-fille. L'horloge voyageuse semblait plus rapide dans son tic-tac, et la chatte noire et blanche, ouvrant l'œil droit, regarda si les aiguilles marquaient bien 11 heures et demie.
Les trois horloges battaient à l'unisson ; puis il y eut finalement dans la caisse de grand-père horloge le bruit métallique familier produit par le mouvement de la chaîne, et le poids descendit. C'était minuit moins un quart. Avec entrain, grand-père déclencha son carillon. Minuit moins le quart — presque le moment de la mort d'un jour et de la naissance d'un autre, presque le moment où un cycle change pour faire place à son inverse. "Et maintenant, pensa grand-père, c'est l'heure de la CONVERSATION !"
— Grand-père ! Grand-père horloge ! Je demande à parler en premier, dit la chatte noire et blanche qui avait bondi à terre pour courir prendre place devant la longue caisse polie.
La lune était plus brillante que la veille : elle était presque à son plein et par ailleurs le ciel était pur et le temps absolument calme, sans le moindre vent dans les branches des grands arbres. Tout donc était immobile à l'intérieur de la maison éclairée par la lueur de la lune.
— Alors, jeune chatte, dit grand-père. Tu as demandé à parler en premier. Eh bien, il me semble que tu as déjà commencé à parler en premier. Alors, de quoi donc veux-tu parler ?
La chatte noire et blanche, interrompant sa toilette, s'assit bien droite et dit :
— Grand-père, j'ai beaucoup songé à ce que vous avez dit hier soir. J'ai beaucoup songé à ce que vous avez dit au sujet du Pendule. Or, grand-père horloge, si le bien et le mal alternent avec chaque balancement du Pendule, ils n'ont pas beaucoup de chances de faire le bien et le mal, n'est-ce pas, vu qu'ils n'ont environ qu'une seconde pour chaque balancement — d'après ce que j'ai cru comprendre. Comment expliquez-vous cela, grand-père ?
La chatte noire et blanche se rassit, la queue étirée toute droite derrière elle. Elle était assise résolument, comme si elle redoutait qu'une explosion de colère de grand-père horloge ne lui fasse perdre l'équilibre. Mais non, grand-père avait la sagesse et la tolérance que donne le grand âge. Avec un petit bruit métallique, il s'éclaircit à nouveau la gorge et dit :
— Mais, ma chère petite chatte, tu ne penses pas, j'espère, que le Pendule de l'Univers bat à une seconde d'intervalle ? Il bat sur une période de milliers et de milliers d'années. Le temps, tu sais, petite chatte, est entièrement relatif. Ici, en Angleterre, il est actuellement minuit moins quatorze minutes, mais d'autres pays ont une heure différente, et même si tu étais transporté instantanément à Glasgow, tu découvrirais qu'il n'est pas minuit moins quatorze minutes, mais qu'il est peut-être minuit moins quinze minutes. Tout cela est très mystérieux, en vérité, et mon propre calcul est, bien sûr, limité à mon propre rythme de battements. (Grand-père fit une pause pour prendre une respiration sous la forme d'un autre maillon de la chaîne passant sur la roue dentée, et le poids ayant stoppé sa descente, il reprit :) Tu dois te souvenir, petite chatte, que notre unité — c'est-à-dire notre unité à nous, les horloges — est de vingt-quatre heures. Maintenant, il y a soixante minutes dans chaque heure, soixante secondes dans chaque minute, ce qui représente trois mille six cents secondes dans une heure. Ainsi en vingt-quatre heures un pendule qui bat la seconde se sera mû quatre-vingt-six mille quatre cents fois.
— Oh ! s'exclama la chatte. C'est VRAIMENT beaucoup de fois, n'est-ce pas ? Bonté divine, je n'aurais jamais pu percer quelque chose comme cela !
Et c'est avec une admiration accrue que la chatte noire et blanche regarda grand-père horloge.
— Oui, dit grand-père qui s'enthousiasmait sur son sujet, son pendule battant plus fort encore, mais le Pendule de l'Univers a un système complètement différent car nous nous occupons de périodes de vingt-quatre heures dans notre évaluation, mais il ne faut pas oublier que dans le temps réel au-delà de cette Terre, le monde traverse une période d'un million sept cent vingt-huit mille années au cours de chaque cycle, et que tous les cycles vont par groupes de quatre, tout comme ma frappe de l'heure, du quart, de la demie, et des trois quarts de l'heure. Tu vois donc que nous suivons une bonne tradition. L'Univers va au rythme des quarts et il en va de même pour nous, les pendules.
La chatte noire et blanche acquiesçait gravement comme si elle comprenait tout ce qui venait d'être dit, comme si tout ce profond savoir était bien à sa portée, puis elle dit :
— Mais, grand-père, c'est au sujet du Pendule, à la fin de sa course. Vous avez dit qu'il se stoppait pour une fraction de fraction de seconde. Qu'en est-il dans ce que vous appelez ‘le temps réel’ ?
Grand-père rit sous cape et répondit :
— Ah ! Oui, bien sûr, mais quand nous avons à jouer sur un million sept cent vingt-huit mille années, nous pouvons alors permettre que le Pendule s'arrête pendant beaucoup d'années à la fin de chaque battement. Tu ne crois pas ? Seulement, tout ceci est si profond que peu d'humains peuvent le comprendre, et pas beaucoup d'horloges non plus. Mais nous ne voulons pas te fatiguer le cerveau, petite chatte, avec tout ce savoir ; peut-être devrions-nous changer de sujet.
— Mais il y a une chose que je tiens tout spécialement à demander, dit la petite chatte noire et blanche. Si Dieu est d'un côté du balancement, et Satan de l'autre, comment alors trouvent-ils le temps de faire du bien ou du mal ?
La vitre placée devant le visage de grand-père brillait étonnamment sous le clair de lune, et il répondit quelques instants plus tard :
— Quand nous avons toutes ces années pour un balancement, nous pouvons alors nous permettre d'avoir environ deux mille ans à la fin de chaque balancement, ce qui fait que durant un premier intervalle de deux mille ans nous avons le bien, durant l'intervalle suivant de deux mille ans nous avons le mal, et puis le balancement suivant ramènera le bien, et le balancement d'après apportera le mal. Mais, dit hâtivement grand-père, je dois m'arrêter, le temps est venu pour la petite-fille et moi de sonner ensemble les douze coups de minuit, moment où la Nature tout entière est libre d'opérer un changement, moment où meurt un jour et où un autre naît, et quand le Pendule se balance, il va d'abord vers le bien, puis vers le mal, et du mal vers le bien. Excuse-moi !
Grand-père horloge arrêta net son discours tandis que ses roues, dans ses entrailles, tournèrent et que son poids descendit en grondant, et qu'en même temps retentit de la grande caisse polie le carillon et le timbre profond des douze coups de minuit. Et tout près de là, la petite-fille, tel un écho, répéta fidèlement le carillon et les douze coups.
Sur la petite table où elle se trouvait, l'horloge de voyage grommela, mécontente :
— Quelles bavardes ces deux-là ! Elles accaparent tout le temps réservé à la conversation !
Chapitre Neuf
Un virus est trop petit pour être vu à travers un microscope, et il y a beaucoup plus d'organismes vivants, virus, bactéries etc., installés sur la peau des êtres humains, qu'il n'y a d'humains sur la Terre. On estime qu'ils sont environ quatre mille par centimètre carré sur les bras et, sur la tête, aux aisselles et à l'aine, le nombre peut excéder deux millions.
Vera Virus, assise dans sa Vallée du Pore, réfléchissait à tous les problèmes qui assaillent les gens du monde appelé humain. Près d'elle se tenait Brunhilde, sa plus intime amie virus. Elles tremblotaient agréablement comme seuls des virus gélatineux en sont capables. Puis Vera dit soudain :
— Oh, je suis dans un tel état de confusion. On m'a demandé mes statistiques vitales, mais comment faire comprendre que je suis un magnifique 25 nm (nanomètres — NdT) ? Oh, pourquoi n'adoptons-nous pas le système métrique pour en finir ; ce serait tellement plus simple.
Brunhilde eut un violent vacillement, et cela était censé être un rire.
— Eh bien, il te suffit de donner aux gens les statistiques vitales du nm. Dis-leur simplement que le nm est le milliardième du mètre, et s'ils sont stupides au point de ne pas savoir ce qu'est le mètre — tout le monde sait que c'est ce que lit l'électricien — alors dis-leur que c'est égal à un millimicron. Franchement, Vera, je trouve que tu fais une montagne de ce qui est à peine une taupinière.
— Comment peux-tu être aussi stupide, Brunhilde ? rétorqua Vera d'un ton acerbe. Tu sais bien qu'il n'y a pas de taupinières ici ; et pour ce qui est des taupes, on ne les a pas encore inventées.
Elle renifla — s'il est possible qu'un virus renifle — et retomba dans son silence gélatineux.
Le monde dit humain était un lieu bien singulier. Tous ses habitants vivaient dans les vallées des pores parce que, pour quelque raison extraordinaire que personne ne pourrait jamais comprendre, le monde, à l'exception de certains endroits, était couvert d'une étrange couverture, ou d'une sorte de nuage, ou quelque chose comme ça. Il semblait qu'il y eût d'immenses piliers entrecroisés avec, entre eux, un espace permettant à n'importe quel virus agile, compte tenu qu'il ait quelques années, de grimper droit à travers cette barrière et de regarder l'espace depuis la surface de cet étrange matériau. Mais c'était véritablement remarquable, vu que de temps à autre le monde entier subissait un Déluge. Des millions de virus étaient instantanément noyés, et seuls survivaient des virus tels que Brunhilde, Vera et certains autres, témoins de la sagesse de la vie dans les vallées des pores.
Quel spectacle n'était-ce pas que de voir, en levant son antenne au-dessus de la vallée, tous ces corps jonchant l'espace entre les vallées adjacentes. Mais personne, jamais, ne pouvait expliquer ce que c'était. Ils savaient qu'à certains intervalles, la grande barrière couvrant la majeure partie du monde serait retirée et qu'alors viendrait le Déluge ; puis qu'une autre barrière viendrait, laquelle serait agitée violemment. Une autre barrière encore et, pour un temps, ce serait la paix.
Vera Virus et ses amis étaient assis dans leur Vallée du Pore, en un site qui n'était jamais couvert par cette barrière, où ils étaient à même de regarder le ciel et Vera, levant les yeux en cette occasion, dit :
— Je me demande souvent, Brunhilde, s'il y a d'autres mondes, à part le nôtre ?
Une voix nouvelle se fit entendre, celle d'un gentleman virus nommé Bunyanwera, né d'une culture ougandaise, du moins de mémoire de ses ancêtres ; maintenant, il n'était plus qu'un simple habitant du monde dit humain.
— Quelle sottise, Vera ! dit-il. Vous savez parfaitement qu'il existe des milliers, des millions de mondes comme le nôtre. Ne leur avez-vous jamais jeté un coup d'œil de temps à autre ? Mais ce que nous ne savons pas, c'est s'il y a une vie sur ces mondes !
Une quatrième voix intervint pour dire :
— Ma foi, je pense que ce monde a été fait spécialement pour nous. Aucun autre monde ne porte une vie semblable à celle que le nôtre porte. Je pense que le monde entier a été fait par Dieu, juste à notre intention, pour nous les virus. Regardez tous les avantages dont nous jouissons ; aucune forme d'intelligence ne peut être comparée à la nôtre, nous avons des vallées spéciales et si elles n'ont pas été faites pour nous, pourquoi seraient-elles là ?
Catu Guama, qui venait de parler, était une manière d'érudit ; il avait voyagé, était même allé aussi loin que la Vallée du Pore voisine, ce qui fait qu'il était écouté avec respect. Mais alors Bunyanwera explosa soudainement :
— Quelle sottise ! Sottises que tout ça ! Une chose telle qu'un Dieu n'existe pas ; bien sûr qu'il n'y a pas de Dieu. J'ai bien souvent prié pour demander certaines petites choses, et s'il y avait un Dieu pensez-vous qu'il laisserait souffrir un de ses enfants ? Regardez-moi : j'ai eu une partie de ma gelée écrasée en m'approchant trop près du sommet de la Vallée, et une section de la barrière m'a griffé le dos. J'ai supplié qu'on fasse quelque chose pour moi. Eh bien, s'il y avait un Dieu, il m'aurait guéri.
Un silence embarrassant fut interrompu par Vera.
— Eh bien, je ne sais pas, car moi aussi j'ai prié, dit-elle, mais mes prières n'ont jamais été entendues, et je n'ai pas davantage vu d'anges virus flotter dans l'air. En avez-vous vu, vous ?
Les autres restaient silencieux, quand se produisit une catastrophe terrible ; un grand ‘quelque chose’ s'abattit brusquement de l'espace en frottant les grands piliers qui leur offraient leur ombre.
— Oh Dieu du ciel ! dit Brunhilde en voyant le grand ‘quelque chose’. Il n'est pas passé loin, hein ? On a bien failli disparaître, cette fois !
Mais, ayant à peine échappé à ce danger de l'espace — ils pensèrent que cela avait pu être un OVNI — un autre incident se produisit. Un flot de liquide piquant ruissela sur eux, en même temps qu'ils étaient assaillis par une horrible odeur, et d'un coup, Vera, Brunhilde, Bunyanwera et Catu Guama cessèrent d'exister, quand le monde appelé humain s'arrosa le visage avec un astringent.
Miss Fourmi était tranquillement assise sur une large pierre, frottant avec soin son antenne et s'assurant que ses pattes étaient propres. Elle tenait à être aussi parfaite que possible, car elle devait sortir avec un soldat fourmi qui venait d'avoir une permission inattendue. Elle se tourna vers sa compagne, Bertha Blackbeetle, qui sommeillait au chaud soleil de midi.
— Bertha, toi, ma grande lourdaude ! dit-elle, regarde si rien ne cloche. Tu es sûre que je suis bien ?
Se soulevant un peu et ouvrant un œil, Bertha regarda attentivement Miss Fourmi.
— Oh la la, je te trouve très chic, et je suis sûre que ton soldat en aura les pattes coupées en te voyant. Mais tu es en avance, assieds-toi et profite un peu du soleil.
Côte à côte toutes deux, elles regardèrent le monde lugubre qui s'étendait devant elles. C'étaient de gros cailloux vingt fois plus grands au moins que Miss Fourmi et, entre eux, la terre était sèche, sans le moindre brin d'herbe, sans le moindre élément vivant. Ce n'était qu'un sol désolé sur lequel se lisaient des marques particulières.
Levant les yeux vers le ciel, Miss Fourmi dit à Bertha :
— Toute ma vie, j'ai souhaité avoir un petit ami qui serait soldat. J'ai prié qu'une telle chose m'arrive. Crois-tu que mes prières ont été entendues ?
Remuant une de ses antennes, Bertha répondit lentement et en pesant ses mots :
— Ça... je ne sais pas ; moi-même je ne crois pas qu'il existe un Dieu. Et s'il y en a un, il n'a jamais exaucé mes prières. Quand j'étais beaucoup plus jeune — en fait au stade de la larve — j'avais l'habitude de prier un Dieu dont on m'avait parlé ; mais n'étant jamais entendue, j'en ai conclu que je perdais mon temps. Comment croire en un Dieu qui ne donne jamais aucune preuve de son existence ? Voilà ce que j'ai à dire.
Oisivement elle décrivit un cercle complet et se rassit, tandis que Miss Fourmi croisait ses pattes de devant et reprenait :
— Tu sais, Bertha, c'est un problème, c'est vraiment un problème. Je me demande si tous ces points lumineux que nous voyons la nuit sont d'autres mondes, et si ce sont d'autres mondes, est-ce que tu penses que quelqu'un peut y vivre ? C'est drôle de penser que notre monde est le seul, et que nous sommes seules à l'habiter. Qu'en penses-tu, toi ?
Bertha laissa échapper un soupir d'exaspération, puis répondit :
— Eh bien, je ne sais pas s'il existe d'autres mondes ou non. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait différent. Il y a quelques mois j'ai rencontré un insecte qui m'a dit — c'était un insecte ailé — qu'il avait parcouru une longue distance en volant, et qu'il atterrit sur un immense pilier, si vaste que j'ai eu de la peine à croire ce qu'il me disait. Il ajouta que le sommet de ce pilier devenait brillant chaque nuit. Je me refuse à croire qu'il pourrait exister un monde qui ne deviendrait brillant qu'au moment où le nôtre s'assombrît. As-tu une idée ?
L'esprit de Miss Fourmi devenait de plus en plus confus :
— Eh bien, on m'a toujours enseigné que ce monde a été conçu pour nous, les insectes. On m'a toujours enseigné qu'il n'y a pas de forme de vie supérieure à nous, les insectes. C'est-à-dire toi et moi, Bertha. Si c'est exact, si nos prêtres ont raison, alors rien ne peut être plus intelligent que nous, et il leur faudrait l'être beaucoup plus que nous pour donner vie à ce monde simplement quand il devient obscur. Je ne sais que croire, mais j'imagine qu'il y a quelque grand Dessein derrière tout cela ; et comme toi, je suis lasse de prier un Dieu qui ne prend même pas la peine de répondre.
Le temps avançait et les ombres s'allongeaient. Non loin, une voix de fourmi appela :
— Eh, Miss Fourmi, Miss Fourmi, où êtes-vous ? J'ai un message pour vous.
Miss Fourmi se redressa et s'avança jusqu'au bord de la grosse pierre.
— Oui, je suis là, qu'y a-t-il ? cria-t-elle en regardant vers une autre fourmi, non loin de là.
Agitant ses antennes, celle-ci annonça :
— Votre petit ami, le soldat, est parti, disant qu'après réflexion vous n'étiez pas la fourmi qui lui convenait. Alors il est parti avec la petite effrontée qui est si rapide, celle qui vit là-haut ; vous savez de qui je veux parler ?
Tout s'écroulait autour d'elle, et Miss Fourmi se laissa tomber lourdement. Elle qui avait tant prié pour qu'un soldat fourmi lui fasse l'amour et construise un nid avec elle. Qu'est-ce que la vie lui réservait à présent ?
Soudain, un bruit effroyable fit tressaillir Miss Fourmi et Bertha ; on eût dit l'approche d'un tremblement de terre. Elles se dressèrent pour voir ce qui se passait, mais avant qu'elles n'aient pu se déplacer des formes sombres surgirent, et Miss Fourmi, son amie, ainsi que la messagère furent réduites en bouillie par des écoliers qui, sortant de l'école, traversaient leur terrain de jeux en regagnant leurs foyers.
Au loin, dans la campagne, l'herbe se dressait immobile. C'était une herbe superbe, saine, aussi verte qu'il était possible de l'être pour une herbe ; les soleils l'avaient chauffée, les pluies l'avaient nourrie, et le champ qu'elle composait était digne d'admiration.
Tout au fond des profondeurs d'un champ qui, pour ses habitants, semblait une véritable forêt, deux petites souris des champs jouaient parmi les brins d'herbe en courant de l'une à l'autre ; l'une qui s'essayait à bondir vint bouler aux pieds d'une vieille souris — ce qui déchaîna des cris de joie.
— Fais attention, petite, dit l'ancêtre, tu es trop gaie. Or, ce monde est sans gaieté. Un grand Mystère ne va pas tarder à arriver ; toutes nos forêts s'écrouleront sous l'assaut d'une Machine si énorme qu'aucun de nous ne peut même supposer ce qu'elle est. À voir l'état de cette herbe, j'ai idée que nous n'en avons plus pour très longtemps, et que mieux vaudrait regagner nos terriers.
La vieille souris, pleine de sagesse, s'en alla en trottinant. Les deux jeunes souris se regardèrent, puis portèrent leurs regards vers l'ancêtre qui s'éloignait. L'une dit :
— Oh, ce qu'elle est mauvaise joueuse, cette pauvre vieille !
Ce à quoi l'autre répliqua :
— Je suppose qu'elle n'aime pas les enfants et qu'elle veut nous tenir la bride : sommes juste bonnes à rapporter des noix ou autres bricoles — et tout cela pour ses beaux yeux.
Les jeux continuèrent parmi les jeunes souris jusqu'au moment où le vent fraîchissant leur rappela que le soir venait et, jetant un coup d'œil vers le ciel qui s'obscurcissait, elles se hâtèrent vers leur abri.
Rendues chez elles, elles s'assirent à l'entrée de leur maison, conversant tout en mordillant un brin d'herbe et en s'assurant de temps à autre qu'aucun hibou ne les guettait. Puis le disque de la lune argentée commença de glisser à travers le ciel obscur. L'une des deux souris dit alors :
— Je me demande comment ça peut bien être là-haut ? Je me demande s'il y a des souris des champs sur cette grosse chose que nous voyons si souvent ?
— Oh, ne sois pas stupide, répondit l'autre. Bien sûr qu'il n'y a rien à part ce monde-ci. (Puis se reprenant, elle ajouta avec dans la voix une note d'incertitude :) Au fait, il m'arrive souvent d'avoir la même pensée et de me dire qu'il doit exister des mondes, autres que le nôtre, dans lesquels il y a des souris des champs. Je sais que nos prêtres nous disent que ce monde a été spécialement fait pour nous, souris des champs, et qu'il n'est pas de forme de vie plus élevée que la nôtre.
— Ah oui, dit l'autre, mais les prêtres nous disent que nous devons prier. Dieu sait que je l'ai fait ; j'ai prié pour du fromage frais et d'autres nourritures. Mais jamais, jamais je n'ai été entendue. S'il existait un Dieu, ce serait vraiment bien peu de chose pour lui que de déposer de temps à autre un peu de fromage pour une jeune souris des champs. Tu ne penses pas ?
Elle se tourna dans l'expectative vers sa compagne, mais celle-ci répondit :
— Je ne sais pas, bien franchement. J'ai prié moi aussi, mais je n'ai jamais eu la preuve de l'existence d'un Dieu souris et je n'ai pas davantage vu voler des anges souris.
— Non, dit l'autre, seulement des hiboux ou autres créatures de nuit.
Sur cette réflexion solennelle, elles se turent et plongèrent dans leurs trous.
La nuit avança et toutes les bêtes nocturnes sortirent pour aller chasser. C'était l'heure, pour elles, de chercher leur nourriture ; mais les petites souris étaient en sécurité, bien à l'abri dans leur trou. Le jour se leva, radieux, et une douce chaleur emplit l'air. Les deux petites souris attaquèrent leur tâche quotidienne. Quittant leur abri, elles s'en allèrent vers la grande forêt d'herbe verte, en quête de quelque nourriture pour la journée.
Soudain, glacées jusqu'au sang, elles se plaquèrent contre le sol. Un grondement diabolique — un bruit monstrueux encore jamais entendu — venait vers elles. La terreur les paralysait. L'une murmura à l'autre :
— Vite, vite, prions pour être protégées, prions pour notre salut.
Mais le fermier et sa moissonneuse écrasèrent leurs pauvres corps qui furent projetés dans l'herbe coupée, et ces mots de prière furent les derniers de la petite souris des champs.
De la grande pyramide au toit plat orné de tourelles parvint l'accent des trompettes, leur voix d'airain se répercutant à travers la vallée située au pied de la pyramide qui, en fait, était un temple sacré.
Les gens se regardèrent, effrayés. Étaient-ils en retard ? Que se passait-il ? Ces clairons ne se faisaient entendre qu'en temps de crise, ou quand les gros prêtres à l'aspect négligé avaient une annonce spéciale à faire au peuple. Tous en même temps abandonnèrent leur occupation et se hâtèrent vers la pyramide, empruntant le sentier qui y conduisait. De larges, très larges escaliers menaient à un tiers de la hauteur de la pyramide et tout autour il y avait des protubérances, des extensions, presque comme des balcons, ou un meilleur terme serait peut-être des promenades murées, au long desquelles les prêtres avaient l'habitude de passer du temps. Ils allaient, deux par deux, les mains derrière le dos ou cachées dans leurs vastes manches. Deux par deux ils allaient, méditant sur les paroles de Dieu, et réfléchissant aux mystères de l'Univers. Ici, dans l'atmosphère si pure des Andes, il était si facile de voir les étoiles la nuit, si facile de croire à l'existence d'autres mondes — mais la population de la vallée maintenant se pressait en foule le long des grands escaliers et faisait irruption dans le corps principal du Temple.
Dans l'intérieur faiblement éclairé et tout chargé de fumée d'encens, les gens toussotaient et, de-ci de-là, un paysan, habitué à l'air pur, frottait ses yeux irrités par la fumée âcre de l'encens.
Les lumières étaient ternes, mais à une extrémité du Temple se dressait une immense idole en bronze poli, une silhouette humaine en position assise ; et cependant elle n'était pas absolument humaine ; elle était ‘différente’ par des détails subtils. Elle était surhumaine, mais elle se dressait, imposante, haute de plusieurs étages, et les gens qui marchaient à sa base n'arrivaient qu'à mi-hauteur de ses genoux.
La congrégation entra et le prêtre en charge s'étant rendu compte que le grand Hall était presque plein, un gong résonna. Ceux dont les yeux n'étaient pas affectés par la fumée de l'encens pouvaient voir le grand gong vibrer à droite de la forme divine.
La sonorité continuait de retentir, mais personne ne frappait le gong, personne ne faisait quoi que ce soit dans un rayon de plusieurs mètres, mais la sonorité continuait. Puis, sans aucune intervention humaine, les grandes portes du Temple se refermèrent. Le silence régna pendant un moment et, sur les genoux du Dieu, apparut le Grand Prêtre dans sa robe flottante. Les bras levés au-dessus de la tête, il regarda la foule en disant :
— Dieu nous a parlé ; il est mécontent du peu d'aide que vous apportez au Temple. Nombreux, parmi vous, sont ceux qui lui ont retiré leur obole. Dieu vous parlera.
Ayant terminé, il se tourna et s'agenouilla, faisant face au torse de la gigantesque statue. La bouche de celle-ci s'ouvrit et il en sortit un bruit tonitruant. Les gens tombèrent à genoux, fermèrent les yeux en joignant les mains, puis le bruit fit place à une voix puissante :
— Je suis votre Dieu, dit la statue. Je suis mécontent du manque croissant de respect dont vous faites preuve à l'égard de mes serviteurs, vos prêtres. Si vous ne montrez pas davantage d'obéissance et de générosité, de nombreux fléaux vous frapperont — tels que peste et autres épidémies, et vos récoltes disparaîtront sous vos yeux. Obéissez à vos prêtres. Ils sont mes serviteurs. Ils sont mes enfants. Obéissez, obéissez, obéissez.
La voix s'évanouit et la bouche se referma. Se levant, le Grand Prêtre se tourna pour regarder les fidèles. Il renouvela alors ses demandes — davantage de nourriture, d'argent, de services, et aussi de jeunes femmes pour le Temple des Vierges. Puis, il disparut. Ce n'est pas qu'il se tourna et s'éloigna ; il disparut, et les portes du Grand Temple se rouvrirent. Plusieurs rangées de prêtres se tenaient à l'extérieur, leur bol à aumônes à la main.
Le Temple s'était vidé. L'idole était silencieuse. Mais non, en fait pas tellement silencieuse, car un prêtre de passage visitait le Temple sous la conduite d'un ami intime. Des murmures et des bruissements s'échappaient de l'idole et le visiteur s'en étonna :
— Oh, oui, dit l'ami, ils contrôlent simplement l'acoustique. Tu n'as pas vu l'intérieur de notre idole, n'est-ce pas ? Viens, je vais te montrer.
Les deux prêtres se dirigèrent ensemble à l'arrière de l'idole et le prêtre résident appuya ses mains sur un certain motif d'une ornementation. Une porte secrète s'ouvrit et les deux prêtres entrèrent. L'idole n'était pas massive, mais composée d'une série de chambres. Ils y pénétrèrent et montèrent de nombreux escaliers jusqu'à ce qu'ils se trouvent au niveau de la poitrine. Il y avait là une bien étrange pièce : on y voyait un banc avec un siège par-devant, et en face du siège il y avait un porte-voix qui conduisait à une série de tubes finement enroulés qui remontaient jusqu'à la gorge. Sur un côté, il y a deux sièges et une série de leviers. Le prêtre résident commenta :
— Ces deux leviers sont opérés par deux prêtres ; ils actionnent les mâchoires, et nous avons tellement pratiqué que nous pouvons les activer pour que le mouvement coïncide exactement avec les paroles.
Il s'avança et dit :
— Regarde ici. L'orateur peut en tout temps voir l'assemblée qui, elle, ne peut le voir.
S'approchant, le visiteur regarda à travers d'étroites fentes aménagées dans les yeux. Il vit ainsi tout le Temple et les hommes occupés à en nettoyer le sol. Puis il se tourna pour voir ce que faisait son ami. Il était assis près d'un porte-voix et dit :
— Nous avons un prêtre doué d'une voix pleine d'autorité ; il lui est défendu de fréquenter qui que ce soit, vu qu'il est la voix de notre Dieu. Quand il a un message à délivrer, il s'assied ici et parle à travers ce porte-voix après en avoir retiré la glissière, car aussi longtemps qu'elle est en place, rien de ce qui se dit ici ne peut être entendu à l'extérieur.
Sans cesser de converser, ils descendirent dans la partie principale du Temple.
— Nous sommes obligés de faire ceci, tu sais, dit le résident. Je ne sais pas si Dieu existe ou non, chose que je me demande d'ailleurs fréquemment, mais je suis tout à fait sûr que Dieu ne répond pas à nos prières. Quarante ans, maintenant, que je suis ici et je n'ai jamais entendu dire qu'une prière fut exaucée. Toutefois, il importe que nous gardions notre autorité.
— Oui, répondit le visiteur. Je m'interroge bien souvent quand je me tiens, la nuit, sur notre pic en regardant tous les petits points lumineux. Je me demande s'il s'agit de trous dans le plancher du ciel ou si tout cela est imagination. Y a-t-il un paradis ? Ou bien ces petits points de lumière sont-ils d'autres mondes ? Et s'ils sont des mondes, alors, comment vont les choses là-haut ?
Le résident répliqua :
— Oui, j'ai pas mal de doutes, quant à moi ; il doit y avoir quelque entité qui contrôle, mais, par ma propre expérience, il me semble qu'elle ne répond jamais aux prières. C'est pourquoi on a construit cette statue de métal il y a un millier d'années, afin que nous, prêtres, puissions maintenir notre pouvoir et notre emprise sur les gens et les aider, peut-être, quand Dieu les ignore.
*
JE CROIS que toute vie est faite de vibrations, et une vibration n'est rien d'autre qu'un cycle. Nous disons qu'une chose tremble. Eh bien, ce que nous voulons dire c'est qu'elle monte et descend, monte et descend. Si vous tracez une ligne sur un papier, vous pouvez ensuite tirer une autre ligne s'incurvant sur la première, d'abord vers le haut, puis la faisant redescendre en s'incurvant à la même distance vers le bas, pour ensuite remonter. Nous avons là un cycle, une vibration, le diagramme illustré d'une vibration semblable à celle utilisée en biorythme ou en symboles pour le courant électrique alternatif. Mais toute vie est ainsi. C'est comme le balancement d'un pendule. Il va d'un côté d'un point neutre, repasse le point neutre, et remonte à égale distance, de l'autre côté. Et le processus se répète indéfiniment.
JE CROIS que toute la Nature procède par cycles. Je crois que tout ce qui existe est une vibration, alternant de haut en bas, de positif à négatif, de bien à mal, et, à bien y penser, si le mal n'existait pas il n'y aurait pas de bien, parce que le bien est l'opposé du mal comme le mal est l'opposé du bien.
Je crois en un Dieu. Je crois très fermement en un Dieu. Mais je crois également que Dieu peut être trop surchargé pour avoir le temps de s'occuper de nous, individuellement. Je crois que si nous prions, c'est à notre Sur-Moi que nous nous adressons, à notre âme supérieure, si vous préférez, mais il ne s'agit pas de Dieu.
Je crois en l'existence de deux Dieux : le Dieu du Bien, positif, et le Dieu du Mal, négatif. Ce dernier, nous l'appelons Satan. Je crois qu'à des intervalles bien définis — aux balancements opposés du pendule — le Dieu du Bien gouverne la Terre et tout ce qui y vit, et nous avons alors un Âge d'Or. Mais le pendule se balance, le cycle avance et le pouvoir du Dieu du bien — le côté positif — décroît, et après avoir passé un point neutre où les pouvoirs du bien et du mal sont égaux, il remonte pour favoriser l'autre côté du balancement, le mal, Satan. Et nous connaissons alors ce qui est si souvent appelé l'Âge de Kali, l'âge de la perturbation, l'âge où tout va mal, et si vous considérez la Terre de nos jours, avec tous ces vandales, ces politiciens et ces guerres, pouvez-vous nier que nous sommes en plein âge de Kali ? Nous y sommes. Nous approchons du sommet du balancement, et les conditions n'iront qu'en s'aggravant jusqu'au point extrême de sa course vers le mal. Guerres, grèves, tremblements de terre — les puissances du mal lâchées sans contrôle. Et ensuite, comme toujours, le pendule changera de direction, descendra, et les puissances du mal s'affaibliront et la Terre verra renaître des sentiments meilleurs.
De nouveau, le point neutre où le bien et le mal sont à égalité sera atteint et dépassé, et le pendule remontera vers le bien et, au fur et à mesure de sa montée, les choses iront de mieux en mieux. Peut-être qu'alors, quand nous aurons un Âge d'Or, le Dieu de cet Univers sera capable d'écouter nos prières et nous donnera peut-être une preuve qu'Il se soucie de ceux qui vivent ici sur ce monde.
Je crois que pour l'instant, la presse, la télévision et tous les autres médias contribuent très largement à l'accroissement du mal, car même dans les journaux nous lisons qu'on apprend à des enfants de sept ans à commettre des meurtres, et ici, à Vancouver — nous apprend-on — des enfants de dix ans se sont organisés en gangs de criminels. J'ai la conviction que la presse devrait être supprimée, et que films, télévisions et radios devraient être soumis à la censure.
Mais parlons des Dieux. Oui, je crois qu'il existe un Dieu, et en fait je crois qu'il y a différents échelons de Dieux. Nous les appelons Manus, et les gens qui ont une difficulté à comprendre le concept des Dieux devraient regarder ce qui se passe dans un magasin à grande surface. Peu importe le nom du magasin, disons une grande chaîne de supermarchés. Au sommet, vous avez Dieu, le Président ou Directeur Général — selon le pays où vous vivez et la terminologie qui y est en usage. Mais cet homme à la tête est le tout-puissant ; c'est lui qui dicte ce qui doit être fait. Cet homme, toutefois, ce Chairman du Conseil d'Administration, ce Président, ce Directeur Général, de par son immense puissance, est tellement occupé qu'il ne peut accorder la moindre minute à un employé de bureau ou au jeune garçon qui manipule les produits d'alimentation. Cet homme particulier, le Dieu du supermarché, représente Dieu Lui-même, le Chef Manu de notre Univers, celui qui a le contrôle de plusieurs mondes différents. Il est si important, si puissant, si affairé, qu'il n'a pas le temps de s'occuper des mondes individuels, qu'il n'a pas le temps de s'occuper des pays individuels, et est certainement incapable de s'occuper des individus — individus humains, individus animaux, car les animaux ont autant de droits que les humains dans le plan céleste des choses.
Le Président ou Directeur du supermarché n'ayant pas la possibilité de tout voir par lui-même, il nomme des sous-directeurs, des superviseurs et des contremaîtres, et cela correspond aux Manus, dans le système spatial. Il y a Dieu le Tout-Puissant, et dans notre propre système il y a le Manu de la Terre, le Directeur qui est responsable de la gestion globale de cette Terre. Sous lui, il y a des Manus subordonnés, des superviseurs si vous préférez, de chaque continent de la Terre. Des superviseurs ou Manus de chaque pays de la Terre. Ils guident le destin des pays, ils influencent ce que font les politicards, bien que ces derniers arrivent à créer assez de pagaille sans que les Manus y soient pour quelque chose !
Il existe une créature connue comme ‘l'œil de Dieu’. Et c'est le chat. Il peut aller n'importe où, faire n'importe quoi, tout voir, car qui donc remarque un chat qui se promène ? Les gens disent : "Oh, ce n'est rien, ce n'est qu'un chat." Et le chat continue à observer et à informer sur le bien et le mal. Les forces du mal ne peuvent contrôler les chats. Ceux-ci ont une barrière divine qui fait obstacle aux mauvaises pensées ; c'est pourquoi, à une époque donnée, ils ont été vénérés comme des Divinités et, à une autre époque, ils ont été condamnés comme disciples du diable, parce que les personnes diaboliques veulent se débarrasser des chats qui rapportent les mauvaises actions, et les diables n'y peuvent rien.
Actuellement, le Manu qui contrôle la Terre, c'est Satan. Actuellement Satan maîtrise très bien la Terre, et c'est pourquoi il ne faut pas espérer beaucoup de bonnes choses à l'heure actuelle. Prenez ce groupe maléfique, suppôt de Satan : les Communistes. Regardez tous les cultes d'une ‘religion’ qui égare les gens et, de plus, essayent de dominer ceux qui sont assez sots pour se laisser guider par eux. Mais Satan sera finalement contraint d'abandonner la Terre, forcé de retirer ses favoris, tout comme un homme d'affaires qui fait faillite est contraint de mettre la clef sous la porte. Bientôt viendra le temps où le pendule renversera sa marche et avec ce changement de direction, le mal perdra de sa force, le bien se renforcera, mais ce temps n'est pas encore venu. Nous allons faire face à des temps de plus en plus difficiles jusqu'à ce que le pendule oscille réellement.
Pensez à ceci : vous regardez le pendule et vous pensez qu'il est toujours en mouvement, mais il ne l'est pas toujours, vous savez, il ne bouge même pas à la même vitesse, parce que le pendule est au plus fort de sa montée, disons, du côté droit, et ensuite il tombe avec une vitesse croissante, jusqu'à ce qu'il soit à son point le plus bas. Là, il a sa vitesse maximale. Mais ensuite le poids montant de l'autre côté ralentit le bras du pendule qui, à la fin du coup, s'arrête, et s'arrête assurément pour un temps appréciable, avant que de tomber à nouveau et de grimper de l'autre côté.
Selon le temps auquel nous faisons référence, nous sommes à même de dire qu'avec une horloge courante l'arrêt n'est que d'une fraction de seconde. Mais si nous prenons un temps différent dans lequel les secondes sont des années, ou peut-être même des milliers d'années, le temps durant lequel le pendule est arrêté peut alors être de deux mille ans. Et s'il est arrêté du côté du mal, beaucoup de choses mauvaises peuvent être faites avant que le pendule et son cycle descendent, encore, et encore, pour remonter à nouveau de l'autre côté, donnant alors au bien les mêmes possibilités.
Aucun de nous qui vivons actuellement ne connaîtra cet Âge d'Or. Les conditions empireront assurément et ne cesseront d'empirer au cours des années qu'ont encore à vivre les gens d'un âge déjà avancé. Mais nos enfants ou petits-enfants vivront pour voir le début de l'Âge d'Or et bénéficieront de beaucoup des avantages qui en découleront. Mais l'une des grandes choses qu'il est nécessaire de faire est de réviser le système religieux. Aujourd'hui les Chrétiens se battent contre d'autres Chrétiens et le Christianisme, depuis l'An 60 où il a été si déformé, a été la plus belliqueuse de toutes les religions. En Irlande du Nord, Catholiques et Protestants s'entre-tuent. Même situation entre Juifs et Musulmans. Et qu'importe la ‘religion’ que l'on choisit de suivre, tous les chemins mèneront au même Lieu — en dépit de quelques divergences doctrinaires. Qu'importe qu'une personne soit Chrétienne et qu'une autre soit Juive. Qu'importe que la religion Chrétienne, telle qu'elle était au temps du Christ, ait été formée d'une combinaison de religions d'Extrême-Orient. Une religion devrait être faite sur mesure pour répondre au besoin exact des gens auxquels elle va être prêchée.
La religion, ou plutôt son enseignement, devrait être confiée à des hommes qui ont choisi de s'y consacrer, et non pas à ceux qui cherchent à en vivre confortablement et à en tirer un revenu, ce qui semble être le cas présentement. Il ne devrait y avoir aucune discrimination et certainement pas de missionnaires. Je sais, pour en avoir fait l'expérience — une expérience amère — que les missionnaires sont les ennemis des vrais croyants. Je sais qu'en Chine, en Inde et dans bien d'autres endroits — particulièrement en Afrique — les gens acceptent, sans y croire, de se laisser convertir au Christianisme, alléchés par ce qu'ils retirent des missionnaires sous forme d'aumônes diverses. Nous devons nous souvenir également de la pudibonderie de ces missionnaires contraignant les indigènes à porter des vêtements qui ne leur conviennent pas, et que ce sont ces mêmes missionnaires qui ont apporté la tuberculose et d'autres maladies redoutables à des gens qui, auparavant dans leur propre état naturel, étaient tout à fait à l'abri de telles maladies.
Et peut-être convient-il de se rappeler, également, l'Inquisition espagnole où des gens de différentes religions ont été torturés, brûlés vifs, pour avoir refusé de croire aux choses imaginaires en lesquelles croyaient les Catholiques — ou affectaient de croire, pensant que c'était de bonne politique.
L'Âge d'Or viendra. Mais nous ne le verrons pas, nous. C'est pour plus tard. Peut-être quand le Dieu de notre monde aura plus de loisirs, au cours de ce cycle du bien, consentira-t-il à consacrer un peu plus de temps à l'étude des humains et des animaux. Nul doute que les Jardiniers de la Terre soient bien intentionnés, mais chacun conviendra qu'il est nécessaire par moments que le propriétaire d'un domaine s'occupe de ce que font ses jardiniers et ordonne quelques transformations.
Je crois en Dieu. Mais je crois aussi qu'il est inutile de prier, prier, et prier Dieu pour nos petits désirs dérisoires. Il est trop occupé et, de toute façon, à ce stade du temps notre cycle, ou rythme, ou pendule, est dans son aspect négatif, et au cours de l'aspect négatif le démoniaque, le négativisme, le mal sont en vigueur. Et ainsi — si vous désirez quelque chose, priez plutôt votre Sur-Moi. Et s'il considère que ce que vous lui demandez est bon pour vous — et bon pour lui ! — il se peut que vous l'obteniez. À ce moment-là, vous n'en aurez probablement plus envie.
Chapitre Dix
Prudemment, Margaret Thugglewunk se risqua à ouvrir un œil, redoutant la clarté du jour qui était à son plein.
— Oh, Dieu ! grommela-t-elle, ce qu'il faut qu'une fille fasse pour gagner sa vie !
Lentement elle acheva d'ouvrir les yeux et affronta la lumière. Le choc fut si violent qu'elle crut que sa tête allait éclater. Se prenant le bas du dos à deux mains et souffrant terriblement, elle chercha à se souvenir de ce qui s'était passé la nuit précédente. "Oh, oui, je sais... j'ai dû accepter de passer la nuit avec cet affreux bonhomme... condition qu'il avait mise à la signature du contrat dont je rêvais. Mais que m'est-il arrivé ? Le sexe normal, ça, je veux bien ; mais j'ai l'impression d'avoir couché avec un éléphant enragé."
Elle gémit longuement, puis finit par gagner la salle de bains avec peine. Après plusieurs crises de vomissements, elle plongea son visage dans une serviette humide, indifférente au résultat que l'opération aurait sur sa coiffure. Se sentant mieux, elle regarda autour d'elle. La fureur alors lui monta au visage :
— Ce propre à rien de mari ! s'écria-t-elle. Je lui avais pourtant bien dit de mettre un peu d'ordre avant de partir ce matin.
À l'idée de son mari, la rage la reprit et, d'un pas mal assuré, elle alla à la cuisine.
Le cerveau encore trouble, elle promena son regard autour d'elle ; elle aperçut un mot posé contre une bouteille de lait. "Je suis las de vivre avec une femme émancipée ; on veut aller trop loin avec cette histoire d'égalité des sexes et de chances égales. J'en ai assez de te voir chaque nuit coucher avec d'autres. Tu ne me reverras plus."
Prenant le billet, elle le regarda avec attention, le retourna dans tous les sens, comme si ces gestes pouvaient l'amener à quelque découverte. Mais elle n'éprouva rien — ni joie ni peine. Elle n'était qu'une autre de ces créatures qui s'appellent elles-mêmes des femmes libérées — la pire malédiction de notre civilisation.
Personne ne peut mépriser plus que moi ce type de femelles. Ce ne sont pas des épouses, mais de simples tonneaux vides qui mènent la race à la déchéance.
Autour de 1914, l'Angleterre connut une terrible tragédie. Bien sûr, la Grande Guerre, la Guerre Mondiale, mais une autre également : la soi-disant bataille des sexes. Les femmes ont été conçues pour porter les enfants qui perpétuent la race de l'Homme, mais en 1914, elles partirent travailler dans les usines et enfilèrent des vêtements d'hommes. Elles ne tardèrent pas à découvrir la boisson, la cigarette et aussi un langage ordurier que tout homme, même dépravé, n'oserait jamais employer. Bien vite, elles commencèrent à ronchonner et à se plaindre qu'elles étaient traitées injustement, mais aucune femme n'a jamais dit ce qu'elle désirait. Il semble qu'elle veuille être une pure sauvage et n'accorder aucune attention à la continuation de la race.
Puis il y a celles qui mettent ‘Ms’ devant leur nom, ce qui dans le monde de la science ne signifie absolument rien, mais si l'on y voit un avertissement occulte, cela voudrait dire que les femmes deviennent masculines et deviendront bientôt stériles.
On ne trouve pas de mots pour exprimer ce qu'on ressent devant le spectacle de toutes ces jeunes femmes couchant avec le premier venu. C'est parfois, chez elles, presque le viol de l'homme en question. Et dès qu'un enfant naît, du mariage ou hors du mariage, la mère reprend son travail à l'usine, au magasin, ou en quelque autre endroit presque avant même la naissance de l'enfant, et elle charge alors de l'élever quelque nourrice, ou bien le laisse à la merci d'une baby-sitter. Puis, dès que l'enfant grandit — garçon ou fille — c'est la rue, où là, il subit la domination d'enfants plus forts ou plus âgés que lui. Rapidement les gangs s'organisent — voyez ce que l'on pouvait lire dans le journal The Albertan en date du 15 juillet 1976, et qui n'est qu'un extrait, bien sûr : "Hit-Boys à louer". Après le bla-bla habituel, l'article continuait ainsi : "Quelque part dans le secteur de Vancouver, un garçon de dix ans a proposé ses services au ‘milieu’ pour des meurtres par contrat."
Il semblerait que ce petit gars de 10 ans soit à la tête d'un gang d'une centaine de garçons qui tueront sur commande moyennant paiement.
Il y a de cela quelques semaines, le journal faisait état d'un crime commis par un enfant plus jeune encore — et du cas d'un autre garçon qui avait tué un de ses ‘amis’.
Dans le passé, la mère restait au foyer et élevait ses enfants pour qu'ils soient des citoyens convenables, pour qu'ils soient des enfants obéissants, et quelle tâche plus noble que celle d'une mère qui reste à la maison, éduque bien ses enfants et s'occupe du bien-être de sa famille. Il est clair que beaucoup de ces femmes qui ne restent pas chez elles sont tout simplement influencées par les forces du mal.
Lors de la Première Guerre Mondiale, les femmes allèrent travailler dans les usines, les bureaux, et sont même entrées dans les Forces Armées, pour le plus grand plaisir des publicitaires qui y virent une double source de revenus pour ceux que visaient leurs publicités. Bientôt l'économie prit un cours qui obligea les femmes à travailler — ou du moins c'était le cas en apparence. Toutes les firmes publicitaires firent valoir que les femmes pourraient faire tant et plus en achetant ceci, cela, et autre chose, et, bien sûr, elles tombèrent dans le panneau.
Pour les gouvernements également, les femmes au travail représentaient des salaires élevés, et partant de plus gros impôts sur le revenu, plus d'argent tiré de la taxe d'achat, et tout le reste. Et les femmes continuent dans cette voie stupide qui les fait échouer complètement dans ce qui est leur vocation naturelle — et s'en vont travailler, simplement pour s'endetter en achetant des masses de choses qui ne leur sont d'aucune utilité.
De nos jours, les femmes — spécialement celles du M.L.F. — n'ont pas le moindre goût dans la façon de se vêtir, et considèrent comme le sommet de l'élégance de sortir chaque jour en blouse et en jupe faites de tissus généralement de mauvaise qualité et aux dessins voyants.
Avez-vous regardé les jeunes femmes, récemment ? Avez-vous vu leur pauvre poitrine triste et plate et leurs hanches étroites ? Comment pourront-elles donner le jour à des enfants ? À l'aide de forceps, sans aucun doute, ce qui causera un dommage au cerveau du nouveau-né.
Et le mariage, de nos jours ? Peu nombreux sont ceux qui restent solides. Les femmes, tout particulièrement, n'ont qu'envie de s'agiter sur l'oreiller avec un homme qui leur donnera tout ce qu'elles veulent sur le plan sexuel ; et s'il les contrarie, elles ramassent leurs frusques et s'en vont vers le premier venu qui veut bien d'elles.
Il existe, dans le monde ésotérique, le principe mâle et le principe femelle — deux pôles opposés. Et pour que le monde reste un lieu habité, il est nécessaire que les hommes et les femmes soient différents les uns des autres ; autrement les femmes deviendront stériles et malgré tous les efforts qu'elles pourront y apporter, il n'y aura toujours pas de progéniture.
Peut-être devrait-on descendre dans la rue et molester tous ces gens de la publicité qui attirent les femmes sur les chemins qui mènent à la destruction de la race. Oh oui, cela pourrait être le cas. Le Registre Akashique des Probabilités montre clairement que ce genre de chose peut se produire. C'est ce qui s'est produit il y a des millions d'années.
Au-delà, bien au-delà même d'une mémoire raciale, il existait une civilisation d'un niveau très élevé. Les gens avaient la peau pourpre et n'étaient pas absolument humains, pas exactement humains, en fait, vu que les femmes avaient six seins, et non pas deux comme maintenant, et qu'il y avait d'autres différences subtiles.
Il y avait un très haut standard de civilisation et la vie familiale y était pleine de chaleur. Mais soudain les femmes décidèrent de ne plus rester à la maison, de ne plus élever de famille, de ne plus se compliquer la vie avec un mari et des enfants, cela sous le prétexte qu'elles étaient persécutées. Sans jamais d'ailleurs expliquer de quelle façon elles l'étaient et sans jamais dire ce qu'elles voulaient. Il est évident que quelque chose, dans leur esprit, s'était détraqué. Et ainsi, elles se détachèrent du mariage ; aussitôt le bébé né, on le reléguait dans une maison prête à accueillir les enfants non souhaités. La race ne tarda pas à se détériorer, à dégénérer, et à devenir débile.
Finalement, les femmes étant devenues complètement stériles — la race devait s'éteindre.
Connaissez-vous un peu le jardinage ? Avez-vous jamais vu un pommier de très grande qualité, qui a été négligé ? En un premier temps, il produit des fruits superbes, appréciés pour leur fermeté, leur douceur et aussi leur couleur. Mais négligez ce pommier pendant un certain temps, et les fruits que vous obtenez sont comme des pommes sauvages, de pauvres fruits ratatinés.
Et vous est-il arrivé de voir un pur-sang dont on a cessé de s'occuper et auquel on a permis de s'accoupler avec une sauvage ? Eh bien, je vais vous dire ce qui se passe : après quelques générations, le produit en est le plus bas qui se puisse voir ; et cela parce que tout ce qui, dans le pur-sang, faisait de lui ce qu'il était, s'est petit à petit atrophié.
Il en est de même avec les humains. Négligez les enfants, ne leur imposez aucune discipline, et vous avez des gangs armés, des vandales diaboliques qui frappent et mutilent les vieilles gens. Tout récemment, il y a eu le cas franchement abominable de deux femmes qui, pour lui voler les quelques centimes qu'il avait dans ses poches, ont frappé un pauvre infirme jusqu'à briser les jambes artificielles qui lui permettaient de se déplacer — l'abandonnant à demi nu dans une rue déserte.
Il n'y a pas longtemps encore, on a fait état d'un autre cas impliquant des femmes. Une pauvre vieille dame à la retraite dont on avait forcé la porte n'a dû de survivre, après avoir été frappée, qu'en faisant croire qu'elle était morte. Les femmes — si on peut les appeler ainsi — dévalisèrent la maison et prirent toutes les économies de la vieille dame, la laissant totalement démunie. Les retraités n'ont déjà pas de quoi vivre largement !
Savez-vous ce que sont destinés à devenir les enfants indisciplinés ? Savez-vous ce qui arrive lorsque les enfants sont autorisés à atteindre l'adolescence sans discipline, sans leur inculquer l'idée du travail ?
Willy le Loup traînait dans la rue. Il était près de minuit. La lumière crue des néons vacillait dans le vent du soir. C'était le jour de la paie et, même à cette heure tardive, les passants étaient encore nombreux. Les boutiques restaient toujours ouvertes très tard ce soir-là, car l'argent coulait plus facilement qu'à l'habitude.
Willy le Loup était d'un caractère ombrageux ; c'était un de ces êtres qu'on voyait apparaître le dimanche matin, la démarche lourde, titubant comme un idiot alcoolique, le long des avenues. Ses parents eux-mêmes s'étaient lassés de lui et l'avaient finalement chassé du toit paternel.
Le père travaillait, la mère aussi, et Willy restait à la maison, chipant tout ce qui lui tombait sous la main, ainsi par exemple le portefeuille de son père que celui-ci laissait tomber parfois en rentrant, lui-même plein d'alcool. De même, il fouillait dans le sac de sa mère, volant l'argent qu'il y trouvait et quand on le suspectait, il accusait son père du larcin.
Il s'était fait une solide réputation dans le quartier. On le voyait toujours rôder dans les rues obscures, vérifiant si les portes des voitures étaient bien fermées, et celles qui ne l'étaient pas — eh bien Willy cherchait ce qui pouvait être volé dans la boîte à gants et allait même jusqu'à s'emparer des enjoliveurs de roues.
Ses parents, un jour, en avaient eu assez de lui. Las de voir qu'il se refusait à les écouter, se rendant compte qu'il ne faisait pas le moindre effort pour trouver un emploi après son renvoi de l'école, ils lui avaient fermé leur porte, en avaient changé la serrure et s'étaient assurés que les fenêtres étaient bien fermées, elles aussi. Willy s'en était allé par les rues. À l'agence pour l'emploi, il avait réussi, en mentant, à donner des raisons pour ne pas prendre un travail ; sous un autre nom, grâce à des papiers dérobés, il s'était fait donner des secours par le bureau d'entraide. Mais — Willy le Loup déambulait le long des rues avec des yeux de prédateur, guettant la proie possible, tournant la tête d'un côté et de l'autre. Il regardait devant, puis derrière. Regardant de nouveau devant lui, il se raidit soudain et pressa le pas. Au tournant de la rue, une jeune femme marchait portant un gros sac, une employée tardive de l'un des nombreux bureaux très affairés.
D'un pas de promeneur, Willy avança. Il vit qu'elle s'apprêtait à traverser, mais le feu passa au rouge. Willy arriva à sa hauteur. Avançant la jambe devant elle, il la fit trébucher, la poussant en même temps à la nuque. Elle tomba lourdement, face contre terre, se heurtant le front contre la bordure du trottoir. Arrachant la sacoche de la main inerte, Willy repartit du même pas traînant. Il tourna dans une ruelle obscure qui longeait un bloc d'appartements, et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule afin de voir si personne n'était à sa poursuite. Il vit la jeune femme étendue sur le sol dans une flaque de sang rouge, un rouge qui semblait noir sous les néons verdâtres. En ricanant, il glissa le sac sous son blouson de cuir, en remonta la fermeture éclair, et partit de l'air le plus innocent du monde.
Puis il arriva dans une partie de la ruelle plus sombre encore. Il y avait là un garage désaffecté depuis quelque temps et fermé soigneusement en attendant d'être vendu, les propriétaires ayant fait faillite. Le garage était verrouillé, mais plusieurs semaines avant sa fermeture Willy avait volé le double de la clef ; il était entré dans le garage pour demander à se servir des toilettes, et tandis que l'employé avait le dos tourné pour lui en fournir la clef, Willy avait saisi celle de la porte qui se trouvait à côté de la caisse enregistreuse.
Il entra donc dans le garage et s'accroupit à l'intérieur de la porte d'entrée. L'éclairage de la rue était juste à hauteur de la fenêtre du garage. Il vida sur le sol le contenu du sac, mettant soigneusement de côté l'argent qui s'y trouvait. Puis, toujours en ricanant, il fouilla son contenu, amusé par tout ce que les femmes peuvent garder dans leur sac, lisant même avec grande difficulté une liasse de lettres qui y était glissée. Ayant terminé son exploration et décidant que rien ne méritait d'être gardé, il jeta les objets sur un tas d'ordures.
Sur le pavé, la jeune femme gisait, assommée et perdant son sang. Près d'elle, c'était le trafic nocturne, gens sortant des cinémas ou des boîtes de nuit, travailleurs rentrant chez eux, ou allant prendre leur service. Dans les voitures qui passaient, le conducteur jetait un coup d'œil, puis accélérait, refusant d'être mêlé à l'incident. Les quelques passants hésitaient, s'arrêtaient un instant et s'éloignaient. Un homme, qui se tenait sur le seuil d'une boutique, avait assisté à toute la scène et aurait fort bien pu poursuivre Willy ; mais là encore, il avait préféré ne pas intervenir. Pourquoi aiderait-il la police avec laquelle il avait déjà eu des ennuis ? Et, pensa-t-il, pourquoi aiderait-il cette jeune femme ? Il ne la connaissait pas. Ayant décidé que l'incident ne l'intéressait pas, il s'avança, s'arrêta près de la victime, la regarda de plus près en essayant de lui donner un âge et se demandant qui elle pouvait bien être. Il se baissa pour la fouiller, mais ne trouva rien dans ses poches ; s'apercevant soudain qu'elle portait une alliance et une autre bague, il les lui arracha brutalement et les mit dans sa poche. Puis, se redressant, il la poussa avec le pied pour se rendre compte si elle vivait encore et s'éloigna.
Dans les taudis de Calgary, la populace poursuivait un semblant de vie, le taux de criminalité ne cessant de s'élever, tandis que les journaux, dans de grandes manchettes, clamaient qu'il importait de faire quelque chose. Il y avait des articles sur les viols croissants, les agressions croissantes, mais le grand public ne se sentait pas concerné ; il ne l'était que si LUI-MÊME s'y trouvait mêlé. La vie nocturne de Calgary continuait comme avant, troublée, troublée, avec des crimes bouillonnants sous la surface prêts à émerger à tout moment. On parlait de fermer les parcs la nuit, d'augmenter les patrouilles... on parlait... mais c'était tout. La vie continuait, inchangée, jour après jour, et nuit après nuit.
Minuit, au loin une horloge sonna. Tout près et déchirant l'air, on entendit un coup de klaxon prolongé. Des malfaiteurs qui s'étaient introduits dans une aire de stationnement avaient déclenché le klaxon d'une voiture qui continuait son appel strident, sans d'ailleurs soulever le moindre intérêt chez quiconque. L'essentiel étant de n'avoir pas d'histoires.
Willy le Loup, comme chaque soir, traînait le long des rues. Son chandail à col roulé, blanc dans le passé, n'était plus maintenant qu'une chose malpropre couverte de taches. Et comme chaque jour, il guettait tout en marchant de son même pas nonchalant.
Apercevant ce qu'il cherchait, il pressa l'allure. À quelque distance devant lui une petite femme âgée, qui de toute évidence était handicapée, arthritique peut-être, cheminait dans la nuit, portant un sac. Il semblait lourd pour elle, car elle avait visiblement beaucoup de peine à marcher et à arriver au bout de son chemin.
— Ma vieille, tu n'y arriveras pas ! gloussa Willy.
D'un pas rapide, il la rejoignit. Avec la technique que ses nombreuses rencontres lui avaient permis de mettre au point, il tendit la jambe devant la pauvre vieille, puis chercha à la pousser en avant pour la piétiner et lui voler son sac. Mais — oh, surprise ! — la vieille dame s'esquiva et balança son sac lourdement chargé de briques à la tête de Willy.
Comme un éclair, il vit venir le formidable coup qu'il encaissa sur le côté de la tête et qui lui fit voir trente-six chandelles. La douleur insupportable le fit hurler avant que le monde entier ne devienne tout noir et, comme ses victimes l'avaient fait avant lui, il s'écroula sur le sol et mordit la poussière.
Les passants endurcis et indifférents s'arrêtèrent cependant pour regarder avec étonnement la vieille dame qui, un pied posé sur le dos de Willy, claironnait sa satisfaction, tel un coq à l'aube sur son tas de fumier ; puis satisfaite, elle repartit revigorée.
La nuit avançait. Une minute, une heure ? Willy n'en avait pas conscience. Finalement, un car de police qui patrouillait s'arrêta devant le corps étendu. La porte s'ouvrit et un policier en sortit, la main posée sur son arme. Du pied, il poussa le corps qu'il retourna sur le dos. Il le regarda — et le reconnut. Appelant son compagnon resté dans la voiture.
— C'est Willy, lui cria-t-il. Il a eu son compte, finalement.
Regagnant la voiture, il prit le microphone et appela l'ambulance, demandant qu'on vienne ramasser une personne grièvement blessée.
Dans l'obscurité d'un appartement tout proche, faisant face à la scène, la vieille dame était assise à sa fenêtre et épiait à travers les rideaux ; en voyant jeter Willy dans l'ambulance sans le moindre ménagement — il n'était pas un inconnu pour les infirmiers — elle se mit à rire, à rire et à rire, avant de se déshabiller et de se mettre au lit.
Le Registre Akashique, que certaines personnes sont à même de voir quand elles vont sur le plan astral, est le rapport de tout ce qui s'est produit sur le monde auquel il s'applique. Il en montre les origines, depuis la première bulle gazeuse jusqu'à l'état de demi-fusion. Il montre exactement tout ce qui s'y est passé. C'est comme si le monde était une personne et que cette personne ait des parents possédant une caméra qu'ils actionneraient depuis l'instant de sa naissance, puis tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Ce qui fait qu'une personne ayant les connaissances nécessaires peut dérouler la bande de film et découvrir ce qui s'est produit, quand, où, et comment. Il en est ainsi pour tous les mondes.
Il existe en outre un Registre des Probabilités montrant ce qu'on ESPÈRE devoir se produire, mais le comportement des pays individuels peut modifier ce qui se produira. Par exemple, un grand tremblement de terre a eu lieu en Extrême-Orient, et en Chine la terre s'est fissurée. Eh bien, je crois personnellement que la cause en est due pour une large part aux tests atomiques souterrains en Amérique et en Sibérie. Quand on frappe une structure importante, il se peut fort bien qu'aucun dommage extérieur n'apparaisse, mais dans quelque partie cachée de cette structure, des fissures et des fractures existent bel et bien. Les ingénieurs d'aéronautique savent qu'un atterrissage en catastrophe peut causer des dommages qui ne se révéleront que quand des fissures apparaîtront dans la queue de l'appareil !
Il y a plusieurs années de cela, j'étais invité par un cultiste à participer à un plan qu'il avait élaboré. Il s'apprêtait à vendre aux gens l'idée qu'il irait dans l'astral pour une consultation — avec sa mallette, sans doute — et en reviendrait avec l'information qu'il vendrait alors au consultant, moyennant une très grosse somme. Il m'avait écrit, essayant de m'intéresser à son plan et m'assurant que nous serions millionnaires en un rien de temps. J'ai refusé, bien sûr, et c'est sans doute pourquoi je suis toujours pauvre !
Le Registre Akashique concernant les femmes démontre que cette histoire du M.L.F. n'aurait pas dû se produire. Les femmes n'auraient jamais dû montrer une telle haine et une telle amertume. La plupart des femmes sont des personnes décentes — j'en ai pleinement conscience — et si elles adhèrent à ce mouvement de libération, ce n'est que pour s'amuser : elles ne prennent pas la chose au sérieux. Mais il existe un certain nombre de folles, des femmes qui fourrent devant leur nom ‘Ms’, ce qui signifie, je suppose, ‘Mostly Stupid’, et c'est vraiment ce qu'elles sont : mostly stupid (essentiellement idiotes — NdT). Mais en mettant devant leur nom ce ‘Ms’, au lieu de ‘Mlle’ ou ‘Mme’, ou en ne mettant rien devant leur nom, elles invoquent de fausses vibrations, et les vibrations sont l'essence de toute l'existence. Elles invoquent de mauvaises vibrations POUR ELLES-MÊMES.
Si les choses continuent ainsi, comme ces femmes semblent le vouloir, d'autres forces feront bientôt de nouveaux arrangements ; elles penseront à donner aux habitants de la Terre un vrai goût de leur propre sottise ; on connaîtra alors un retour à ce qu'a connu une très ancienne civilisation — si ancienne en fait qu'il n'en existe aucune trace, si ce n'est dans le Registre Akashique.
Dans cette civilisation où tous les êtres étaient d'un teint pourpré, au lieu d'être noir, jaune, brun, ou blanc, les femmes avaient trahi l'humanité en faveur d'une certaine secte de Jardiniers de la Terre, ces sur-êtres qui prennent soin du monde, ou sont censés le faire. Il semble que, récemment, ils aient sérieusement manqué à leur mission. Mais, de toute façon, ces femmes avaient séduit certains de ces Jardiniers mâles, créant ainsi beaucoup de discorde avec les femmes de ceux-ci. Néanmoins, une nouvelle race s'était formée de leur union sur la Terre et cette race était dominée par les femmes. Elles occupèrent tous les emplois, de sorte qu'il en restait peu pour les hommes, sauf les métiers serviles domestiques — presque d'esclaves — pour les hommes impuissants. Mais dans certaines maisons spécialement luxueuses, on trouvait des ‘étalons’ pleins de virilité. Leur seule raison d'être était de faire les bébés nécessaires.
Oh oui, tout ceci est parfaitement vrai, c'est tellement vrai que je vous dis avec la plus grande sincérité que si vous lisez tous mes livres — dix-sept au total — et que vous pratiquez les choses qui y sont indiquées, avec des intentions pures, alors vous pourrez aller dans l'astral et voir là le Registre Akashique de ce monde. Celui des individus ne vous sera pas accessible ; s'il l'était, il vous avantagerait sérieusement dans ‘la compétition’. Vous auriez besoin d'une dispense spéciale — comme on dit, je crois, dans l'Église Catholique Romaine — pour être autorisé à voir le Registre Akashique personnel de n'importe quel individu et datant au moins d'un millier d'années. Mais, en cet Âge si lointain quand existait le système de matriarcat, les femmes travaillaient comme les esclaves communistes doivent travailler, et celles au plus beau corps, les plus en santé, ou celles qui avaient du succès auprès des dirigeants, pouvaient se rendre à la maison de ‘l'étalon’ pour leur plaisir ou dans le but de procréer.
Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait, de nos jours, si une telle chose se produisait sur la Terre ? Vous rendez-vous compte de ce qu'inventerait la publicité pour les femmes qui s'en laissent conter ? "La Maison de Plaisirs de Polly — les Hommes les Plus Puissants à votre Disposition ; faites votre choix, la couleur que vous aimez, les dimensions répondant à votre goût. Prix raisonnables, conditions spéciales pour admission comme membre du club."
Mais, comme c'est toujours le cas, une société anormale finit par disparaître. C'est ce qui s'est passé pour le matriarcat. Le système était si peu équilibré qu'il a fini par s'effondrer et la civilisation s'est éteinte complètement.
Savez-vous pourquoi il était si déséquilibré ? Pensez à la batterie de votre voiture ou de votre radio ou de n'importe quel autre objet ayant un positif et un négatif. Supposez que vous soyez en mesure de rendre le négatif plus puissant que le positif, l'objet sera alors déséquilibré, n'est-ce pas, et au bout d'un certain temps cessera de fonctionner. C'est ce qu'a connu cette race pourpre particulière. La vie exige qu'il y ait égalité entre le positif et le négatif, qu'il y ait égalité entre le bien et le mal pour s'équilibrer. Il doit y avoir égalité entre le masculin et le féminin, sinon il ne peut y avoir de vie équilibrée et cohérente, et les femmes du M.L.F. sont en train d'essayer de perturber l'équilibre de la Nature, de ruiner l'écologie humaine — et leurs efforts ne font que créer une masse de mauvais Karma pour les instigatrices de ce mouvement, à cause des peines et des chagrins qu'elles causent ; elles sont avides, âpres au gain, et l'avidité est l'une des plus grandes malédictions de ce monde. La Règle d'Or enjoint de faire aux autres ce que nous voudrions que les autres nous fassent. Il est meilleur aussi de donner que de recevoir. Si vous donnez, vous ajoutez à votre bon Karma, mais si, comme ces femmes du M.L.F., vous essayez de détruire l'harmonie et de déchaîner des conflits, alors ceci fait vraiment un très mauvais Karma.
J'ai toujours eu le don de voir l'Aura humaine ; quand je regarde une femme du M.L.F., je suis à même de voir qu'elle a une Aura très sombre et n'a absolument rien de féminin. Pensez aux femmes du M.L.F. que vous connaissez. Est-ce qu'elles ne vous mettent pas les nerfs en boule ? Ne vous donnent-elles pas la chair de poule ? Rien de féminin en elles, pas le moindre brin d'élégance ou de gentillesse. Et leur voix ! Stridente, pire que celle d'un matou en chaleur qui appelle dans la nuit. Non, les femmes du M.L.F. n'ont pas le moindre charme ; elles veulent et veulent et veulent... et l'avidité les mènera à leur propre perte.
Elles m'amusent beaucoup les femmes qui, se mariant, refusent de prendre le nom de leur époux — et par là de composer une unité équilibrée. Nous avons ici, au Canada, un aspirant à la fonction sacrée de Premier Ministre du Canada, et cet homme-là a une épouse qui refuse de prendre son nom et qui se dit ‘Ms’. Je crois que c'est MacTear, ou quelque chose comme cela, et il y a vraiment de quoi en faire verser une larme (Tear signifie larme — NdT). Mais comment avoir une famille équilibrée à la tête du pays, quand ses deux membres ne forment pas une unité ? C'est impossible.
Pourquoi les femmes qui ne veulent pas être des épouses se marient-elles ? Si ce n'est que dans le désir d'avoir des enfants, eh bien, pourquoi ne pas instituer des centres d'élevage comme il en existe pour le bétail ? Car de telles femmes ne sont que du bétail. Il me semble que dans le fait d'avoir des enfants, il y a plus que les quelques minutes de plaisir, souvent douteux. Je crois que les femmes sont destinées par la Nature à être mères, sont faites pour élever des enfants ; et si elles les abandonnent à la rue dès qu'ils sont en âge de parler, alors elles créent une race de créatures sans amour — celle que nous avons présentement. Des enfants prêts à tuer, pillant les parcs dont ils déracinent les arbres, les plantes, et faisant tout ce qu'ils peuvent pour réveiller l'enfer. Dans le passé, les épouses étaient de vraies épouses qui aidaient leurs maris. L'homme allait gagner la vie de la famille, et la femme restait à la maison pour élever ses enfants et former les nouveaux membres de la race humaine.
Les capitalistes, bien sûr, sont en grande partie responsables parce que ces affamés d'argent pensent que si les femmes travaillent, il y aura deux fois plus d'argent. C'est agréable, bien sûr, l'argent. Je n'en ai jamais eu beaucoup, mais je préfère être honnête plutôt que ressembler à ces capitalistes qui ruinent la civilisation pour se saisir de quelques dollars. Les publicitaires font des offres si alléchantes pour leurs cartes de crédit, leurs systèmes de versements et tout et tout, que c'est une terrible tentation pour les gens de faible volonté et, séduits, ils succombent et se jettent tête baissée dans les dettes — dettes auxquelles ils ne peuvent faire face qu'en ajoutant un, deux, ou même trois emplois.
J'ai connu quand j'habitais Windsor un homme qui assurait quatre emplois ; il a fini par en mourir. Sa femme, pour sa part, en assurait deux ; ce qui fait qu'ils avaient six emplois à eux deux ; mais ils étaient tellement criblés de dettes qu'à la mort du mari les créanciers ont tout saisi. On se demande pourquoi les gens ne peuvent vivre plus raisonnablement, plus économiquement, au lieu de s'emparer de tout ce qu'ils voient comme un enfant gâté qui s'empare et hurle de fureur si quoi que ce soit lui est refusé.
Je suis définitivement hostile au Mouvement de Libération des Femmes, comme j'espère m'être clairement fait comprendre, parce que j'ai vu le résultat de ce terrible culte, ou peu importe comment on l'appelle. Je l'ai vu dans le Registre Akashique, et j'ai reçu des milliers de lettres relatant le mal qu'ont causé nombre de ces femmes.
Nous sommes maintenant arrivés à un tournant dans la destinée de l'humanité, et la société ne sera stable que si les gens prennent la bonne décision. Il doit y avoir un retour à la religion, quelle qu'elle soit, et je ne pense pas au Christianisme, au Judaïsme, à l'Islamisme, à l'Hindouisme, ou à une autre en particulier — peu importe laquelle. Nous avons besoin d'une religion neuve, car les anciennes ont échoué misérablement. Qu'est-ce par exemple que le Christianisme ? Y a-t-il une foi catholique ? Une foi protestante ? Et laquelle EST le Christianisme ? Si les deux sont chrétiennes, pourquoi alors se battent-elles en Irlande du Nord ? À Beyrouth, Chrétiens et Musulmans s'entre-tuent ; puis il y a les Russes sans Dieu, le Communisme étant leur seule forme de dieu ; et le vieux Mao, qui doit être en mauvais état, car on ne le voit plus. Mais d'après ce qu'on nous dit des conditions de vie en Chine, je n'aimerais pas beaucoup aller m'en rendre compte. Il faudra qu'il y ait une meilleure religion, il faudra qu'il y ait des prêtres qui SOIENT des prêtres, au lieu d'être des gens qui ne cherchent qu'une vie agréable où l'argent coule assez aisément, comme c'est le cas actuellement, pour beaucoup d'entre eux.
Oh, je dois vous dire ceci : il y a de cela pas mal d'années, je me suis trouvé gravement malade en un pays dont je tairai le nom. Thrombose coronaire, et le seul médecin disponible était un fervent Catholique. Il entra dans ma chambre, m'examina et me déclara après des mots pieux : "Je ne peux rien faire pour vous. Me permettez-vous de prier ?" Sans attendre ma réponse, il gagna le milieu de la pièce, se laissa tomber sur les genoux en joignant les mains et balbutia tout un charabia incompréhensible. Ce fut la dernière fois que je le vis !
Nous sommes, comme je l'ai déjà dit, à un carrefour. Il nous faut choisir et savoir si nous désirons avoir une société équilibrée, une société dans laquelle hommes et femmes travaillent ensemble en partenaires de façon égale et dans laquelle les femmes s'occupent de leurs enfants, au lieu de les livrer aux mains d'enfants plus âgés et, vraisemblablement, dépravés. C'est comme cela qu'une société est détruite. En Russie, il existait le système consistant à confier à des Centres d'État, pour y être élevés, tous les enfants dont les parents travaillaient à l'usine ou dans des fermes collectives. Le système ne s'est pas révélé excellent, et les mères russes, maintenant, veulent rester à la maison auprès de leurs enfants, et elles se battent pour essayer de triompher. Nul ne sait quel en sera le résultat.
Le vieil Hitler, avec ses idées de cinglé, avait, lui aussi, des centres spéciaux. Vous savez certainement tout sur le sujet ; mais pour ceux qui ne seraient pas très renseignés, voici un aperçu de ce que c'était :
Les leaders guettaient ceux des membres du Parti à la loyauté et à la santé parfaites, susceptibles de faire de bons parents. Et quand on avait repéré un jeune homme loyal et sain et une jeune femme répondant aux mêmes critères, on les envoyait dans de grandes résidences de campagne. Là on les nourrissait parfaitement, on veillait sur eux et, une fois en pleine forme — car à l'époque les rations en Allemagne étaient plutôt maigres — les jeunes hommes et les jeunes femmes étaient alors autorisés à se rencontrer et à choisir leur partenaire. Une fois leur choix fait, et ayant subi un nouvel examen médical, ils pouvaient demeurer une semaine ensemble. Ce qui se passait alors entre deux jeunes gens livrés à eux-mêmes et encouragés dans leurs actes par le Gouvernement, vous le devinez. Sitôt l'enfant né de cette union, il était enlevé à sa mère, placé dans un centre spécial et élevé avec la science et le savoir-faire nazis. Ces enfants étaient censés former le noyau d'une race supérieure.
Vingt-cinq ans après, certains investigateurs ont soulevé la question de ce qui s'était passé ; on a retrouvé la trace de ces fameux enfants, devenus adultes, bien sûr, et on a découvert que presque sans exception ils se sont révélés de mentalité inférieure. Quelques-uns, vraiment, étaient des dégénérés, ce qui démontre que même Hitler, accouplant un homme et une femme et les excitant un peu, n'a jamais pu produire un enfant normal !
Au moment où nous atteindrons l'An 2000, nous saurons si les gens de cette Terre doivent être éliminés comme de mauvaises herbes, et de nouveaux spécimens plantés. Mais si les femmes consentent à rester à la maison, à être des épouses et des mères, comme prévu, alors cette race particulière peut continuer et atteindre l'Âge d'Or. Cela dépend de vous, mesdames et femmes du M.L.F. — qui n'êtes pas des dames. Que choisirez-vous ? D'être classées comme mauvaises herbes ? Ou marcher vers l'Âge d'Or dans la stabilité de la famille ?
Chapitre Onze
Il me semble que, comme dans ce livre nous traitons de métaphysique, d'esprits, de fantômes, etc., cela vous plairait peut-être de connaître — sans trop de sérieux — l'Histoire du Chat de l'Aubergiste.
Cet aubergiste était un homme charmant et très respectueux de la loi. Il possédait depuis des années un bon vieux matou — je pense que c'était un chat roux tigré ou quelque chose du genre — qu'on voyait toujours assis près de la caisse. Ce chat mourut et son maître, qui lui était très attaché, en fut absolument désolé. "Je sais ce que je vais faire ! se dit-il. Je vais couper la queue du vieux Tom, la faire monter sous un globe de verre, et nous la garderons sur le bar, en souvenir de lui."
L'aubergiste avait un ami taxidermiste qui coupa la queue du vieux Tom, et le reste fut enterré.
Tom, le matou, avait mené une très bonne vie. Il avait prêté attention à toutes les conversations des gens qui venaient au bar et avait sympathisé avec les hommes qui avouaient que leur femme ne les comprenait pas, etc. Aussi, comme Tom avait été un si bon chat, il alla au paradis. Il arriva aux Grilles Perlées, frappa à la porte, et bien sûr ils furent ravis de l'accueillir. Mais... ce fut un choc, et quel choc ! Le Gardien de la Porte s'écria :
— Oh, bonté divine, Tom, tu n'as plus ta queue ! Nous ne pouvons pas t'admettre sans ta queue, c'est impossible, tu le comprends ?
Ce fut lui le plus surpris de découvrir, en se retournant, que sa queue n'était plus là ; sa mâchoire s'affaissa tellement, qu'elle faillit creuser un sillon dans les pâturages célestes. Mais le Gardien de la Porte lui dit :
— Voilà ce que tu vas faire, Tom ; tu vas retourner chercher ta queue, nous te la collerons, et ainsi tu pourras entrer au paradis. Mais fais vite, je t'attends.
Le chat de l'aubergiste jeta un coup d'œil à la montre qu'il portait à la patte gauche et vit qu'il était près de minuit. "Sapristi, faut que je me presse, parce que le Patron ferme à minuit et verrouille tout. Je ne dois pas perdre de temps."
Sans perdre une minute, il regagna la Terre et partit à toutes jambes le long du sentier menant à l'auberge. Il frappa très fort à la porte et l'auberge, bien sûr, était fermée. Il insista et frappa, cette fois, comme certains clients privilégiés avaient l'habitude de le faire. Après quelques instants la porte s'ouvrit et l'aubergiste parut.
— Oh, Tom, que fais-tu ici ? Nous t'avons enterré aujourd'hui ; tu ne peux pas reparaître ainsi. Tu es mort, ne le sais-tu pas ?
Le vieux Tom regarda l'aubergiste d'un air triste en disant :
— Patron, je sais qu'il est plus de minuit et qu'il est tard pour vous, mais je suis allé au Ciel et on m'a refusé l'entrée sous prétexte que je n'avais pas ma queue. Si vous pouviez me la rendre — ou même me l'attacher, si possible — je repartirais et ils me laisseraient entrer.
L'aubergiste se prit le menton à deux mains, comme il le faisait toujours quand il réfléchissait. Puis il jeta un coup d'œil sur la pendule (métaphoriquement parlant, bien sûr, parce que s'il avait jeté son œil sur l'horloge, il aurait pu le perdre et briser l'horloge du même coup), et dit :
— Tom, je suis vraiment navré, mais tu sais combien je suis respectueux des règlements — tu me connais — et la loi ne me permet pas de servir des ‘spirits’ après l'heure de fermeture (jeu de mots : en anglais le mot ‘spirit’ signifie aussi bien ‘alcool’ que ‘esprit’ — NdT).
Après cela, revenons aux choses sérieuses et attaquons le dernier chapitre de ce livre. Un gentleman d'un de ces anciens petits pays bordant la Méditerranée — Grèce ou Rome ou quelque part par là, je ne saurais dire pour le moment — ce gentleman donc se tenait debout sur sa caisse de savon. Son nom était Plinius Secundus et c'était un homme très intelligent, en vérité ; il devait l'être parce que son nom — Secundus — implique qu'il n'était pas le premier, mais le second. Vous avez probablement lu les publicités si alléchantes que font ces firmes de voitures à louer ; il y en a une, en particulier, qui annonce qu'ils sont les seconds et que de ce fait ils doivent travailler avec plus d'ardeur. Eh bien, Plinius Secundus, lui aussi, devait travailler avec plus d'ardeur pour être plus intelligent que Plinius Primus.
Il était debout sur sa caisse. J'ignore de quelle marque de savon il s'agissait parce que, dans ce temps-là, les gens qui s'occupaient de publicité ne mettaient pas tellement d'étiquettes sur les choses ; mais il se tenait là, dans un équilibre incertain, car la caisse était fragile et Plinius Secundus lui ne l'était pas. Ayant promené son regard sur l'assistance indifférente, il dit : "Amis", mais il n'attira aucun regard et pas la moindre réponse. Il ouvrit à nouveau la bouche et rugit :
— Amis, prêtez l'oreille !
Il estimait plus sage de demander aux gens de lui prêter l'oreille car, les connaissant, il savait fort bien qu'ils n'allaient pas se couper l'oreille et poursuivre leur route. Il espérait donc avoir trouvé le moyen de les faire écouter ce qu'il avait à leur dire.
Toujours aucune réponse de l'assistance. Il fit une autre pause, regardant la foule qui accourait de partout. Il tenta alors autre chose :
— Amis Romains, Grecs, Américains !
À ce moment, il s'arrêta confus, la bouche ouverte, s'étant soudainement souvenu avec un peu de honte que l'Amérique ne serait pas découverte avant quelques siècles. Son erreur n'ayant pas été remarquée, il reprit sa harangue.
Entre parenthèses, je suis quelqu'un de très aimable, vraiment, même si certains pensent que je suis un vieux ronchon, un vieux type à l'air dur. Je le sais, parce qu'ils m'écrivent et me le disent. Mais, quoi qu'il en soit, voici une traduction de ce qu'a dit Plinius Secundus. C'est une traduction à votre intention parce que, bien sûr, vous ne comprendriez pas son langage, et moi non plus !
"Il n'existe aucune loi contre l'ignorance des médecins. C'est sur leurs patients qu'ils apprennent leur métier, et ceci aux risques de ces derniers. Ils tuent et mutilent dans la plus totale impunité, et en cas de mort du patient, c'est lui qu'ils blâment et non pas leur traitement. Faisons quelque chose pour contrôler ces médecins qui n'obéissent pas au précepte selon lequel ils ne doivent faire aucun mal et doivent consoler le malade pendant que la Nature opère la guérison."
Vous arrive-t-il de réfléchir au chaos dans lequel est la médecine ? C'en est un, vous savez, elle est réellement dans un état déplorable. De nos jours, les docteurs dans leur ensemble consacrent environ neuf minutes à un malade — neuf minutes, depuis son entrée dans le cabinet jusqu'à sa sortie. Pas beaucoup de temps pour un contact personnel, pas beaucoup de temps pour apprendre à connaître le patient.
Oui. Tout cela est bien étrange. Les docteurs sont censés devoir aider ceux qui souffrent, mais de nos jours, après cinq mille ans d'histoire médicale, aucun docteur n'est capable de traiter un rhume de cerveau ; s'il est traité par le docteur, ce rhume est censé être guéri deux semaines plus tard ; mais si le patient est sage, ne voit pas le docteur et se contente de laisser faire la Nature, il peut fort bien être guéri en quatorze jours.
Avez-vous jamais songé à la façon dont le médecin, en général, évalue son client ? Le regardant pendant une bonne minute, il essaye de mesurer ce que peut savoir ce patient, parce que, il y a des années et des années et encore beaucoup d'années, Esculape le Sage en était venu à la conclusion que plus un malade sait de choses, moins il a confiance dans le médecin.
Si le monde n'avait pas fait fausse route, et si le règne de Kali n'avait pas tant progressé grâce à l'appui enthousiaste des adolescents et des femmes du M.L.F., la médecine aurait connu de très grands développements. On aurait, par exemple, la photographie de l'Aura, ce qui permettrait à toute personne qualifiée de diagnostiquer la maladie avant que celle-ci n'attaque le corps, et par l'application de vibrations appropriées, ou de fréquences, ou de cycles — appelez-les comme il vous plaira — le patient aurait pu être guéri avant de tomber malade, pour ainsi dire.
L'argent m'a manqué pour poursuivre de telles recherches. C'est un fait curieux, en vérité, de constater que n'importe quel avocat minable peut vous demander quarante dollars de l'heure pour le temps qu'il vous accorde — et les obtenir ; de même qu'une dactylo peut demander trois dollars pour taper une petite lettre. De même, les gens n'hésitent pas à payer un tas d'argent pour des cocktails, des distractions, etc., mais quand il s'agit d'aider la recherche — non, ils ‘donnent au bureau’ (expression signifiant que la personne a soi-disant déjà donné au bureau, lieu où les visites des organismes de collecte de dons pouvaient être plus fréquentes — NdT), ou quelque excuse de ce genre. Ainsi, la science de la lecture de l'Aura n'a pas été à même de progresser, comme je l'espérais. J'ai la capacité, à tout moment, de voir l'Aura de n'importe quelle personne, mais ce n'est pas VOUS qui la voyez. Ce n'est pas non plus votre docteur, n'est-ce pas ? Et j'avais travaillé à l'idée de rendre cette possibilité accessible à toute personne ayant l'équipement adéquat. Chacun aurait pu être à même de voir l'Aura humaine.
Quand on peut voir l'Aura, on peut voir les gens atteints de schizophrénie et comment ils sont partagés en deux. C'est comme d'avoir un de ces ballons longs, gonflables : vous le divisez soudainement au milieu et vous avez ainsi deux ballons. Ou bien on peut voir l'approche d'un cancer dans un organisme — à travers l'Aura, bien sûr — et alors en appliquant l'antidote approprié au moyen d'une vibration, d'une couleur, ou d'un son, le cancer peut être arrêté avant qu'il n'attaque le corps. Il y a tellement de choses qui auraient pu être faites pour aider le patient.
L'un des gros problèmes semble être que tout le monde de nos jours est assoiffé d'argent. Les jeunes écoliers ou étudiants de grandes écoles ne décident plus du choix de leur carrière — la loi, l'église ou la médecine — qu'en fonction de ce qui rapporte le plus d'argent, donne le plus de loisirs, et de la façon dont vont les choses actuellement avec la médecine, ce sont les dentistes qui semblent gagner le plus d'argent !
Ce qui était en réalité prévu pour cette partie du cycle de l'existence, c'était que les docteurs soient des gens entièrement dévoués à leur profession, des gens qui ne pensent pas à l'argent ; en fait, ce sont des ‘moines médicaux’ qui étaient prévus, des hommes et des femmes n'ayant d'autre but que celui d'aider leurs semblables. L'État aurait pourvu à tout ce dont ils auraient pu raisonnablement avoir besoin. De même, ils auraient été à l'abri de tout impôt et autres choses du même ordre, et puis, ils auraient été de garde et auraient fait des visites à domicile, aussi.
Vous êtes-vous déjà arrêté à penser au fait qu'un médecin fait attendre un patient pendant peut-être quatre heures, pour lui consacrer ensuite un total de neuf minutes de son temps ? Comment ce médecin peut-il alors connaître en profondeur les antécédents médicaux du malade ? Comment peut-il connaître les risques de maladies héréditaires de ce dernier ? Ce n'est pas une relation médecin-patient ; cela ressemble davantage à de la marchandise endommagée ramenée à l'usine pour être réparée. C'est aussi impersonnel que cela, et si le docteur redoute que ce patient n'excède les neuf minutes de l'ennui que représente pour lui chaque malade, alors il l'adresse à l'hôpital — tout comme on envoie un objet à la réparation où il attend sur une tablette qu'on s'occupe de lui. Tout le système médical est mauvais et, dans l'Âge d'Or à venir, il faudra que ce que j'ai suggéré prenne forme ; il faudra que les médecins soient des prêtres, ou qu'ils soient au moins rattachés à un Ordre religieux. Ce seront des gens dévoués qui seront disponibles à la demande avec des périodes de garde régulières, car si l'on ne peut demander à quelqu'un d'être là vingt-quatre heures par jour, on est en droit d'attendre qu'il soit de service plus de six — comme c'est le cas aujourd'hui.
L'une des choses effrayantes qui se produisent aujourd'hui c'est que les médecins ont plusieurs cabines d'examen. Le médecin a son cabinet à une extrémité d'un couloir où il peut y avoir quatre, cinq ou six cabines, chacune avec un patient à l'intérieur. Le médecin a une consultation très hâtive avec un patient, puis l'oriente vers une cabine. Pendant que celui-ci se déshabille ou se prépare, il visite rapidement toutes les autres cabines, et c'est vraiment une affaire de production de masse. C'est de la médecine à la chaîne qui évoque l'élevage des poules en batterie qui sont confinées dans des cages, étage après étage, rangée après rangée, où elles sont nourries et engraissées — la nourriture entrant par un bout et l'œuf sortant par l'autre. Eh bien, c'est à peu près pareil avec les malades. Les bons mots du médecin entrent par l'oreille et le paiement, qu'il vienne de l'assurance-maladie ou du patient, coule en un flot continu. Cela, décidément, n'est pas de la médecine.
Le docteur n'est pas toujours fidèle au serment qu'il a prêté. On le trouve souvent discutant à son Club des affaires de la vieille Mme Une telle, ou faisant des gorges chaudes avec ses amis de ce vieux type qui voulait bien, mais ne pouvait pas, et se demandant ce qui allait advenir de son mariage ? Vous savez ce que c'est !
Il me semble que, sitôt obtenu le droit d'ouvrir un cabinet, les docteurs ferment à tout jamais leurs manuels et ne se tiennent plus au courant de la médecine que grâce aux représentants pharmaceutiques qui vont d'un médecin à l'autre en bonimentant pour vendre leurs produits. Et ces représentants, bien sûr, vantent les qualités de ce qu'ils ont à vendre — sans jamais attirer l'attention du médecin sur les effets secondaires du produit, lesquels peuvent être dangereux. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Allemagne avec cette drogue qui, administrée aux femmes enceintes, a eu pour résultat de faire naître des bébés difformes, parfois sans bras ou sans jambes. On peut dire qu'il s'est agi là d'une expérience terrible et d'une insuffisance coupable dans l'étude du produit et de ses conséquences. Les tests de toute nouvelle drogue devraient porter sur de longues périodes de temps, et tant les médecins que les patients devraient faire preuve de prudence.
Il en est de même avec la ‘pilule’. Les femmes ont été tellement conditionnées par tout ce qu'on leur a dit — promesse qu'en prenant la pilule X ou Y elles pouvaient s'en donner à cœur joie sans avoir à payer l'addition — qu'elles y sont toutes venues. Eh bien, les tests pratiques sur les patientes montrent qu'il peut y avoir des effets secondaires graves : le cancer, la nausée, et tout ce genre de choses. Et les firmes pharmaceutiques sont retournées à leurs planches à dessin métaphoriques et essayent de mettre au point d'autres méthodes consistant à entraver la marche du sperme et à l'empêcher de ‘faire camarade’ avec un ovule glouton. On a essayé des dispositifs intra-utérins et autres procédés, mais ce n'est pas très satisfaisant de toute façon, et il n'est pas prouvé qu'ils ne risquent pas de provoquer le cancer.
Quand le temps en sera venu, il y aura une méthode infaillible de contrôle des naissances, car je n'ai pas prêché l'abstention, ne vous méprenez pas ! La véritable méthode sera une forme d'émetteur d'ultra-sons qui sera accordé avec la fréquence exacte de l'homme ou de la femme, et qui aura l'effet de mettre K.O. le sperme afin de le déviriliser ; en fait, sperme et ovule peuvent tous deux êtres neutralisés par les ultra-sons, si l'on sait comment procéder, et cela sans aucun ennui pour les deux partenaires. Mais ce procédé ne sera mis en œuvre qu'à l'Âge d'Or, s'il y a un Âge d'Or. Parce qu'avec les vandales d'aujourd'hui et la façon dont la Libération Féminine alimente le vandalisme, je ne sais pas...
La souffrance est une chose terrible, n'est-ce pas ? Et médecins et gens de laboratoires pharmaceutiques n'ont pas encore apporté quoi que ce soit de vraiment efficace qui permette de contrôler la douleur. Quelques cachets d'aspirine n'ont pas d'efficacité. Le Demerol n'est quelque chose que de très temporaire avec des effets secondaires possibles. On tombe ensuite dans les drogues du genre morphine — et leur danger d'accoutumance. Mais mon idée est que les chercheurs devraient, avant tout, considérer le fait que la douleur ne peut être ressentie que par des créatures douées d'un système nerveux, ce qui fait qu'il leur faudrait trouver le moyen d'établir une barrière entre le siège de la douleur et les nerfs récepteurs.
Mes expériences d'hôpital, en tant que patient, ne m'ont pas rempli d'admiration pour le monde médical. Je tombai soudainement très malade avec des douleurs franchement horribles, et nous étions en plein état de confusion parce qu'à l'hôpital le plus près il y avait une grève des techniciens ou des infirmières, ou quelque chose de ce genre, et les malades n'étaient pas acceptés. Mama San Ra'ab se mit alors en rapport avec le service d'ambulances.
J'ai dit précédemment que le Service d'Ambulances de Calgary n'a pas d'égal. Ce sont des hommes qui ont une formation et une courtoisie à toute épreuve et qui ont, de plus, beaucoup de considération pour les malades. Je ne louerai jamais assez ces hommes de Calgary. Je suis certain que Cléo et Teddy Rampa devraient embrasser chacun d'eux, le baiser d'un chat siamois apportant une bénédiction.
Très vite, on entendit le hurlement des sirènes qui s'arrêtèrent quand l'ambulance vint se garer devant la porte. Deux ambulanciers entrèrent rapidement en portant de gros sacs noirs. Ce n'étaient pas de simples ambulanciers, mais des paramédicaux — et ce sont les meilleurs de toute la bande. Après avoir posé quelques questions, ils ne se donnèrent pas la peine d'ouvrir leurs sacs, mais firent couler leur brancard près de mon lit. Ils m'y installèrent avec un soin infini, glissèrent le brancard dans l'ascenseur, et je me retrouvai dans la rue, placé dans l'ambulance, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mama San Rampa prit place à côté du chauffeur, et l'autre assistant resta près de moi. J'eus la chance d'avoir une belle ambulance, toute neuve, qui sentait encore un peu la peinture et le désinfectant.
Nous roulâmes à travers les rues de Calgary, et je ne vous dirai pas le nom de l'hôpital car c'est certainement le pire établissement d'Alberta. J'ai bien un nom qui me vient à l'esprit et qui conviendrait parfaitement à cet hôpital ; mais je craindrais de faire rougir mon Respectable Éditeur (est-ce qu'un Éditeur PEUT rougir ?) qui exigerait que je modifie ce nom.
L'ambulance ne tarda pas à entrer dans ce qui semblait une caverne obscure et effrayante. Dans la position où j'étais — sur le dos — j'avais l'impression de pénétrer dans une usine inachevée. Il y faisait atrocement froid. Mais dès que mes yeux se furent habitués à cette obscurité, les ambulanciers me sortirent de l'ambulance et me roulèrent le long d'un corridor terrifiant où chaque personne que je voyais me donnait l'impression de broyer du noir. "Mon Dieu, pensai-je, ils se sont trompés et m'ont amené au parloir des Pompes Funèbres."
Mama San Ra'ab disparut quelque part dans un minable petit bureau pour donner des détails me concernant. Puis, on me poussa dans la Section d'Urgence qui me parut être un long hall avec quelques barres de métal supportant des rideaux qui n'étaient pas toujours tirés ; puis je fus transféré dans une sorte de lit-cage dans le Département d'Urgence.
Connaissant mes difficultés, l'un des paramédicaux dit à l'infirmière :
— Il a besoin d'un monkey-bar.
Ce monkey-bar est une chose qui s'étend d'environ trois pieds (1 m) au-dessus de la tête du lit — et qui a une partie de métal triangulaire habillé de plastique et dépendant d'une courte chaîne. Le but de cet appareil est d'aider les paraplégiques comme moi à se soulever et à s'asseoir. J'en ai un depuis des années et j'ai toujours eu un de ces appareils à chacun de mes séjours dans les hôpitaux ; mais en entendant que j'en avais besoin, l'infirmière prit un air encore plus revêche et s'exclama :
— Ah bon ! Il a besoin d'un monkey-bar ? Eh bien, ICI il n'en aura pas !
Sur ces mots, elle sortit du petit compartiment. Les deux assistants me regardèrent d'un air plein de compassion et secouèrent la tête en disant :
— Elle est toujours ainsi !
Suivit alors la période d'attente. J'étais bloqué dans ce minuscule compartiment avec des lits de chaque côté. Je ne suis jamais parvenu à compter combien il y en avait, mais je pouvais entendre de nombreuses voix, chacun se voyant obligé de discuter de ses problèmes et se faisant répondre en public. Certains des rideaux qui servaient d'écran n'étaient pas tirés et, de toute façon, ils étaient ouverts en haut et en bas. Il n'y avait pas la moindre intimité.
Puis il y eut un incident terriblement drôle — drôle pour moi. Dans le lit voisin à ma droite se trouvait un vieil homme qu'on venait tout juste de ramener de la rue, et le docteur venu le voir s'exclama :
— Oh, mon Dieu, grand-père ! Encore VOUS ? Je vous avais pourtant bien dit de rester à l'écart de la boisson ; on vous ramassera bientôt mort, si vous continuez à boire.
On entendit une suite de grognements et de croassements, puis le vieil homme rugit :
— Je ne veux pas qu'on me guérisse de boire, sapristi ! Je veux seulement qu'on me soigne ces tremblements !
Le docteur haussa les épaules d'un air résigné — je pouvais tout voir très clairement — puis dit au bonhomme :
— Eh bien, je vais vous faire une injection qui vous remettra d'aplomb pour le moment et vous pourrez rentrer chez vous, mais NE REVENEZ PAS ICI UNE AUTRE FOIS.
Quelques minutes plus tard une infirmière harassée arriva dans le couloir, se précipita dans ma petite alcôve et, sans un mot — sans même contrôler qui j'étais et ce dont j'avais besoin — arracha ma couverture, baissa mon pyjama et plongea une aiguille dans ma fesse. Puis toujours à la même allure, elle retira vivement l'aiguille et disparut. Ce que je vous dis est absolument vrai. Depuis, je me suis souvent demandé si je n'avais pas reçu l'injection destinée à mon voisin, l'ivrogne. Je n'ai jamais su ce qu'on allait me faire, personne ne m'en a rien dit, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu une injection de QUELQUE CHOSE en plein dans le... Il peut y avoir des dames présentes, mais vous savez de quel endroit je veux parler.
Un peu plus tard, un garçon de salle apparut et, saisissant l'extrémité de ma couche, commença à me tirer.
— Où vais-je ? demandai-je.
Il me tira au long d'un très grand corridor.
— Vous le verrez quand vous y serez, dit-il. Remarquez que ce n'est pas mon service, hein, je fais ça pour vous aider. Je suis attaché à un autre département.
J'avais toujours cru, et on m'avait toujours dit que c'était un devoir pour le médecin ou pour les infirmières ou pour quiconque lié à un traitement, de dire au malade ce qu'on allait lui faire et pourquoi — parce que, après tout, l'injection d'un quelconque produit dans le postérieur d'un individu est tout de même quelque chose de sérieux, qui mériterait une explication.
Comme nous longions le corridor, une espèce d'ecclésiastique s'avança dans notre direction. En me voyant, son visage se figea comme celui d'un robot et il tourna la tête. Je n'étais pas une brebis de son troupeau, voyez-vous, aussi il détala dans une direction et je fus tiré dans une autre. Le lit-civière s'arrêta et une voix grinçante demanda : "C'est lui ?" Le garçon hocha la tête et s'en alla, me laissant à la porte de ce qui se révéla être la salle de radiographie.
Puis, un peu plus tard, quelqu'un vint, donna une petite poussée à mon lit — comme à un petit chariot à bagages — et j'entrai dans la salle de radio. Le lit fut amené contre la table et on me dit :
— Montez là-dessus.
J'essayai, ne parvenant à hisser que la moitié de mon corps sur la table. Je la regardai et me demandai ce que pouvait bien faire en un tel lieu une si jeune créature. Elle avait des bas blancs et sa mini-jupe était une micro-mini et s'arrêtait juste à l'endroit... vous savez... où j'avais reçu l'injection.
— Cela vous ennuierait, lui demandai-je, de me lever les jambes. Je ne peux pas le faire tout seul.
Elle se tourna, me regarda la bouche ouverte d'étonnement, puis répondit avec hauteur.
— Oh non ! Je suis une TECHNICIENNE ; je ne suis pas là pour vous aider !
Au prix d'une douleur extrême — une véritable agonie, même — je parvins à saisir mes chevilles de ma main droite et à me hisser complètement sur la table.
Sans un mot, la TECHNICIENNE actionna sa machine, tourna des boutons et débita les commandements rituels : "Aspirez — RETENEZ ! — expirez". Je restai sur ma table une dizaine de minutes pendant qu'on développait le film ; puis, sans un mot, quelqu'un poussa le lit contre la table.
— Revenez là, dit-elle.
Encore une fois, par un extrême effort, j'arrivai à me glisser sur le lit qu'elle poussa hors de la salle de radio et qui, en roulant, s'arrêta contre un mur.
Autre attente, puis quelqu'un qui passait par là regarda la carte fixée à mon lit, puis, sans un mot, me ramena dans le Département d'Urgence où on me poussa dans une alcôve, tout comme on pousse une vache dans sa stalle.
Trois ou quatre heures plus tard, un médecin venait me voir ; mais il n'était pas possible de faire quoi que ce soit pour moi vu qu'il n'avait aucun lit vacant, sauf dans la section des femmes. J'acceptai cette dernière solution, ce qui fut assez mal accueilli.
On me conseilla donc de rentrer chez moi, me disant que j'y serais beaucoup mieux ! Croyez que point n'était besoin de chercher à m'en convaincre.
Tout ce temps-là, Mama San Ra'ab l'avait passé dans une salle d'attente glacée sur un siège dur, se sentant, je suppose, comme une naufragée sur une île déserte ; mais on l'autorisa finalement à pénétrer dans le Département d'Urgence, et l'ambulance reçut l'ordre de me ramener chez moi. Petit voyage d'environ trois milles (5 km) — voyage complètement inutile qui coûta soixante-dix dollars, tarif imposé par la ville pour un appel d'urgence.
Je suis donc maintenant à la recherche d'un lieu de soins, autre que Calgary — de préférence dans une autre Province où le traitement médical soit à la fois moins choquant et moins coûteux.
Ceci m'amène à un autre point. Je crois que la médecine ne devrait être pratiquée que par des gens dévoués. Je crois également qu'il importerait d'éliminer des salles d'attente tous les tire-au-flanc qui adorent aller s'y asseoir, comme on irait dans un club, si ce n'est qu'aucun club ne pourrait être aussi inconfortable. Je crois, en outre, que les docteurs et les infirmières — oui, et les garçons de salle également — devraient avoir plus de considération pour les malades ; s'ils mettaient en pratique la Règle d'Or : ‘Fais aux autres ce que tu voudrais qu'il te soit fait’, ce ne serait pas un si mauvais monde, après tout, ne pensez-vous pas ?
Et que dire de ces départements d'urgence où les malades sont livrés aux regards indiscrets sans le moindre isolement ? J'ai, bien malgré moi, été exposé à entendre toute l'histoire d'un vieil homme occupant le lit à ma droite ; et, à ma gauche, celle d'une jeune femme qui avait eu des problèmes avec son mari, problèmes que par délicatesse j'appellerai des problèmes d'ordre sexuel. Elle avait été disons — déchirée. Et le docteur l'examinait presque publiquement, sans la moindre discrétion, lui donnant des conseils et lui posant les questions les plus intimes d'une voix tonitruante. J'imagine que la pauvre jeune femme était tout aussi embarrassée que moi.
Puis ce fut le retour à la maison, avec Mama San Ra'ab, Bouton d'Or Rouse, Cléo et Taddy. Puis la ‘demande’ d'un autre livre — le dix-septième qui aura pour titre ‘Je Crois’.
Affirmation qui me semble une excellente fin pour ce livre. Ne pensez-vous pas ?
FIN